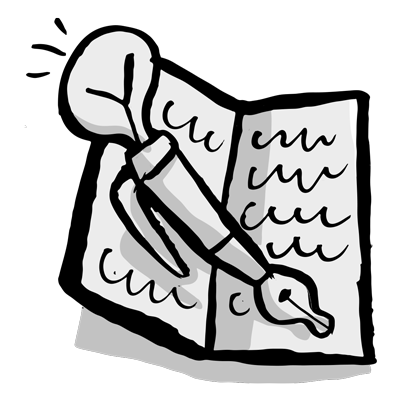Transition idéalisée du pouvoir politique et du mandat du ciel, révolution de palais, coups d’État, premier empereur d’une dynastie, révolution française, accomplissement d’un renouveau, révolutions républicaine, prolétarienne ou encore socialiste, le terme Ge ming, – équivalent de révolution en langue française – renvoie au renversement des systèmes existants. Par l’évocation de ces différents usages, c’est un peu de l’histoire de la Chine dont Zhou Sicheng nous donne un aperçu.
1. La « Révolution » en Chine ancienne : idéologues contre rebelles
Le terme « Ge ming » (革命), qui est généralement considéré, à la fois dans la littérature traduite et dans la vie quotidienne d’aujourd’hui, comme l’équivalent de « révolution » — c’est-à-dire, dans la tradition occidentale, le changement brutal et fondamental de pouvoir politique ou d’ordre social par une révolte massive — apparut assez tôt dans les anciennes écritures chinoises. Il fit pour la première fois son apparition dans l’un des plus célèbres classiques confucéens, le Yi Jing, aussi appelé Livre des Changements. Le public européen eut accès à la citation ci-dessous grâce à James Legge (1815-1897), missionnaire écossais et membre de la Société Missionnaire de Londres à Malacca et Hong Kong, et qui devint plus tard professeur à l’université d’Oxford :
Thang changed the appointment (of the line of Hsia to the throne), and Wu (that of the line of Shang), in accordance with (the will of) Heaven, and in response to (the wishes of) men. Great indeed is what takes place in a time of change
ou
Tang (de la dynastie Xia) et Wou (de la dynastie Shang) opérèrent des révolutions politiques en accord avec le Ciel et en réponse aux vœux des hommes. Grand, en vérité, est le temps de la révolution (Sacred Books of the East, vol. 16[1899]).
Dans ce paragraphe, les anciens confucéens décrivent une transition idéalisée du pouvoir politique mais également du mandat du Ciel, la transition entre des tyrans corrompus et des souverains sages (les rois Tang et Wou). Par conséquent, « Ge ming » signifie littéralement « changer le mandat du Ciel » ; ce genre de mandat était considéré indispensable à la légitimité de tout souverain. Des siècles plus tard, « Ge ming » ou « révolution » fut adopté à la fois par les élites au pouvoir et les élites intellectuelles pour décrire de nombreuses révolutions de palais, coups d’État ou même tout type de changement de régime, même ceux qui ne correspondaient pas à la forme extérieure de légitimité exigée par la philosophie politique du modèle confucéen.
Après la prise de la Bastille, le Duc de La Rochefoucauld-Liancourt rappela avec bienveillance au roi Louis XVI : « Non Sire, ce n’est pas une révolte. C’est une révolution ! ». Mais ceux qui participèrent aux révoltes de masse, en particulier aux soulèvements paysans contre les dirigeants des anciennes dynasties chinoises prirent simplement le nom de « rebelles », jamais de « révolutionnaires ». La force de cette habitude était si forte que même un révolutionnaire du début de la Chine moderne, Chen Shaobai (1869-1934), rappela un jour que jusqu’alors, lui et ses camarades croyaient tous que la rhétorique « révolutionnaire » signifiait « devenir le premier empereur d’une dynastie », alors que l’entreprise même du renversement de la dynastie mandchoue (ou Dynastie Qing, 1644-1911) – une opération toutefois plus noble et plus complexe – n’était rien d’autre qu’un « soulèvement » ou une « rébellion ».
En réalité, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, « Ge ming » ou « Kakumei » (en japonais), un terme emprunté à la langue chinoise, commença à être utilisé au Japon pour décrire la Révolution française et ensuite la Restauration Meiji de 1868. En 1895, le célèbre révolutionnaire et principal pionnier de la République de Chine, Sun Yat-sen (1866-1925) visita la ville japonaise de Kobe. Un jour, alors qu’il jetait un coup d’œil aux unes des journaux locaux, un reportage attira son attention : « Sun Yat-sen, le leader du Parti révolutionnaire (Ge ming) chinois est arrivé au Japon » ; Sun dit alors à ses camarades : « Ge ming vient du Livre des Changements, il désigne une mutation se conformant à la volonté de dieu et du peuple. Les japonais nous qualifient de « révolutionnaires », c’est une bonne chose, nous devrions faire de même et nous appeler « révolutionnaires » ! ». « Ge Ming », en tant que changement progressif de pouvoir politique et d’ordre social, comme équivalent de « révolution », fut depuis largement utilisé par la bourgeoisie révolutionnaire chinoise.
2. La « Révolution » au début de la Chine moderne : l’opposition entre le Saint et le Démon
En Chine, au moment même où les révolutionnaires bourgeois prirent « Ge ming » comme l’équivalent de « révolution » dans la tradition politique occidentale, « Ge ming » fut associé à deux significations contraires : l’une implique le progrès, des changements positifs, des évolutions ; l’autre la terreur, l’effusion de sang, les guerres et l’anarchisme. Deux camps furent alors clairement définis.
Pour Yat-sen et ses camarades du Parti révolutionnaire, la « révolution » ne devait jamais être confondue avec les soulèvements comme une période transitoire entre les anciennes dynasties ; elle n’inclut jamais le « changement de nom, d’uniforme, de titres et de bannières de loyauté ». Au contraire, la « révolution » se distinguait de toutes ces révoltes pré-modernes dans presque chaque aspect. La « révolution » avait pour but « d’accomplir un renouveau, le renouveau de la nationalité chinoise et du territoire national et d’expulser les barbares du nord (les Mandchous) et de les remplacer par un gouvernement national » (Zhang Taiyan, La Moralité de la Révolution, 1906). En un mot, leur but était de renverser la dynastie mandchoue et d’établir une république démocratique de Chine.
À l’inverse, les plus conservateurs, les constitutionnalistes et un groupe de royalistes, croyaient qu’une révolution verticale du haut vers le bas, menée par quelques dirigeants mandchous éclairés, représentait une meilleure option. Aussi, une série de mouvements sociaux mineurs et de réformes éducatives devait avoir la priorité sur des changements prématurés de pouvoir politique ou d’ordre social. À la place, la « révolution » n’amènerait rien d’autre que le désastre et la ruine. Comme le déclara Liang Qichao : « Je ferais tout mon possible pour m’assurer que nos compatriotes n’aient jamais à endurer le chaos et les catastrophes que les Français subirent en 1830 et 1848 ! » (Liang, Pourquoi la Chine souffre-t-elle d’une pauvreté et faiblesse chroniques ?, 1900). Cela ressemble à ce que dirait Edmund Burke.
En revanche, alors que les tentatives de réformes et la révolution de 1911 (menée par Sun Yat-sen et ses camarades) dégénérèrent très vite en un affrontement consternant et désespérant entre les différents seigneurs de guerre partout dans le pays, la vieille notion de dualité (entre réforme et révolution) disparut rapidement et une nouvelle émergea. Un mouvement nouveau et radical de révolution sociale pour rectifier la situation existante devint proposition pour tous les partis politiques. La « révolution républicaine » envisagée par le Parti nationaliste (KMT) et la « révolution prolétarienne » envisagée par le Parti Communiste, malgré leurs différents objectifs et contenus, avaient en commun leur appel à la « révolution ». (Wang Qisheng, Révolution et contre-révolution: la politique de la République de Chine sous l’angle de la culture sociale, 2010). D’un autre côté, pour les deux partis, les activités de leurs rivaux étaient toutes qualifiées de « contre-révolutionnaires », de crimes capitaux, hérésies, péchés originels, et entre ces deux pôles, entre le saint et le démon, il n’existait aucun juste milieu et aucune possibilité de compromis. Une nouvelle culture politique de la « révolution » fit son apparition et prévalut. Son écho se fit entendre jusqu’à la période de « la grande révolution culturelle prolétarienne » dans les années 1960.
3. Les « Révolutions » en Chine moderne : l’héritage de Mao ?
À partir des années 1930 et 1940, l’idéal « révolutionnaire » tel que conçu par Mao Zedong (1893-1976) prévalu pendant près d’un demi-siècle. Il n’existe aucun doute concernant le fait que Mao comprenait la révolution d’un point de vue marxiste, et celui-ci part du fait que la révolution doit être « prolétarienne », qu’elle fait partie d’une révolution prolétarienne globale. Dans l’un de ses premiers écrits, Mao définit la « révolution » comme « un soulèvement, un acte de violence au moyen duquel une classe renverse l’autre. Une révolution rurale est une révolution par laquelle la paysannerie renverse l’autorité féodale et celle de la classe dirigeante » (Mao, Rapport sur l’enquête menée dans le Hunan à propos du mouvement paysan, 1927). Cependant, il existe un composant du programme révolutionnaire de Mao qui est unique et qui doit être souligné ; Stuart Schram insinue que son idéal ne comprenait « pas seulement l’affirmation que les destinées de la Chine étaient entre les mains de sa génération mais aussi une certaine vision du monde ». Mao affirmait :
Toute l’histoire révolutionnaire montre que le développement complet de nouvelles forces productives n’est pas le prérequis à la transformation des anciennes relations de production. Notre révolution commença avec la propagande marxiste-léniniste, qui servit à créer une opinion publique nouvelle dans la société et à ainsi avancer la cause révolutionnaire. C’est seulement après le renversement de l’ancienne superstructure lors de la révolution qu’il fut possible de détruire les anciennes relations de production. Après que les anciennes relations de production aient été détruites et que de nouvelles furent établies, le chemin fut dégagé pour le développement de nouvelles forces sociales productives… C’est une règle générale : on ne peut résoudre le problème de la propriété et continuer à développer les forces productives à grande échelle tant que n’a pas été créée l’opinion publique et que l’on ne se s’est pas emparé du pouvoir politique.
Ce fut peut-être l’insistance de Mao sur la volonté, l’initiative et l’effort fait par l’homme dans la révolution qui mena à l’agitation et au chaos de la « grande révolution culturelle prolétarienne ». En ce sens, un groupe d’intellectuels des années 1990, dont Li Zehou (1930- ) et Liu Zaifu (1941- ) s’attelèrent à réévaluer la culture politique en rapport avec la « révolution ». Les résultats finaux de cette critique concluent à une profonde méfiance envers la révolution comme moyen de renversement du système existant et de l’autorité grâce à la violence du peuple et à des changements radicaux, ainsi qu’à la connexion potentielle entre les révolutions de Mao après 1949 et le sage autocrate, l’absolutisme de la tradition confucéenne. Leurs conclusions ont abouti à la publication d’un livre largement contesté ayant pour titre « Dire adieu aux Révolutions ». Ces écrivains sont convaincus que l’approche « révolutionnaire » ne peut être le seul moyen d’atteindre la modernité et préfèrent la Glorieuse Révolution d’Angleterre à la Révolution française.
Dans l’ensemble, la « révolution » n’est en aucun cas un mot tabou dans la Chine d’aujourd’hui. La Chine est généralement considérée comme ayant achevé la « nouvelle révolution démocratique » avant 1949, ce qui ouvrit la voie au grand bond entre l’ancien empire et la démocratie populaire sous la direction du Parti Communiste Chinois. Ensuite, la Chine organisa la « révolution socialiste », ce qui implique la création d’un système fondamentalement socialiste et basé sur l’édification d’une nation socialiste, bien qu’elle suive une trajectoire unique. Cette révolution socialiste peut être considérée comme le plus important et plus profond changement dans la société chinoise pour l’instant. En conséquence de cela, la réforme chinoise et son ouverture depuis les années 1970 sont également considérés comme une « deuxième révolution » (par Deng Xiaoping lui-même dans ce cas précis), une plus grande révolution qui mena au grand renouveau de la nation chinoise.
Pékin, le 25 Octobre 2017