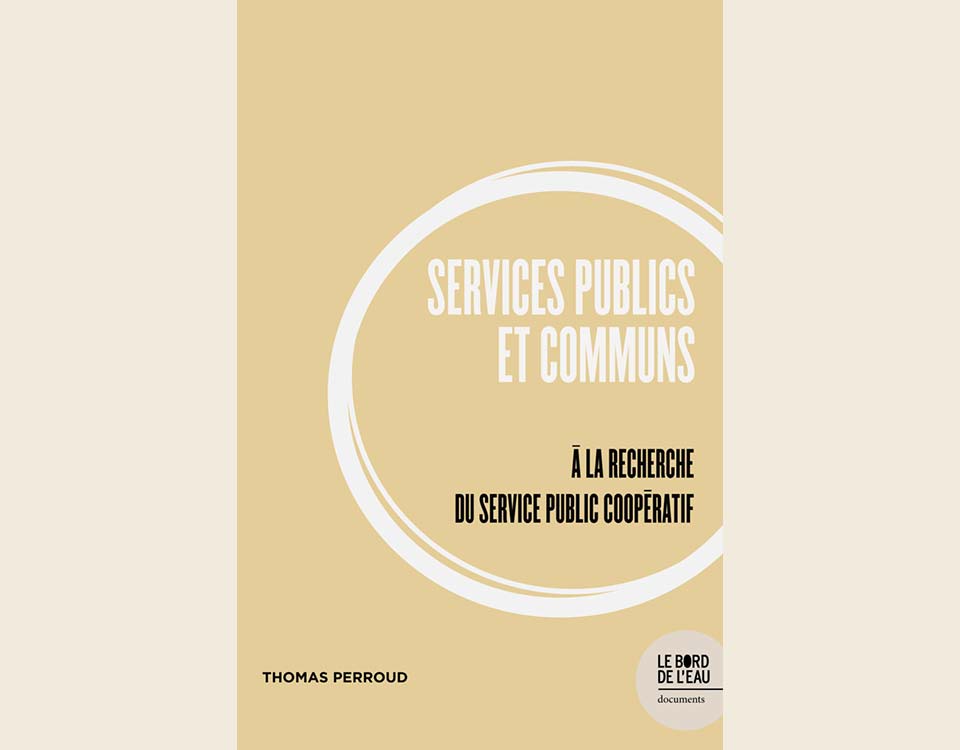Penser la fourniture des services publics à partir des communs implique de définir une nouvelle gouvernance démocratique et inclusive en phase avec la société. Pour cela, Thomas Perroud nous invite tout d’abord à nous éloigner de la conception historiquement étatiste, bourgeoise et conservatrice de la gestion des services publics en France, et propose de dépasser l’opposition entre public et privé en revenant sur les différentes définitions des communs. Ce projet politique, qu’Erik Olin Wright nomme les « utopies réelles », fait de la communauté des usagers et des agents son épicentre et de chacun de ses membres des citoyens. En plein renouvellement, la forme coopérative apparaît comme une des structures permettant de porter cette approche repensée de l’intérêt général et des services publics au-delà de leur gestion étatique et verticale ou de leur privatisation au service du capitalisme financiarisé.
Le scandale Orpea, celui des concessions d’autoroutes, les maltraitances dans les crèches privées, la privatisation des biens publics, d’un côté ; de l’autre, un secteur public dont la qualité s’effondre depuis l’hôpital jusqu’aux universités : le service public est aujourd’hui devenu maltraitant avec ses usagers et ses agents. Ce constat appelle à changer profondément la façon dont on pense dans ce pays la fourniture des services et le commun fournit aujourd’hui un modèle intéressant. Réfléchir au service public sous le prisme des communs c’est d’abord refuser l’alternative public privé telle qu’on l’a vécue partout depuis les années 1980 pour réfléchir à la gouvernance du service que l’on souhaite, une gouvernance plus proche de la société, à distance de l’État, et plus inclusive à la fois pour les usagers et les agents.
Comment pourrait-on organiser différemment les services publics, sur une base plus démocratique, plus horizontale ?
Pour fonder ce refus de l’alternative, il faut d’abord comprendre comment la gestion étatique des services publics nous a éloignés de la démocratie dans ces services. Si l’on regarde la façon dont le droit du service public s’est construit depuis la IIIe République, on constate qu’il s’agit d’un droit d’essence fondamentalement bourgeoise, dont l’objet, à travers notamment la concession de service public, a été de favoriser les intérêts des entreprises fournissant des services. Mon intuition est que le droit administratif a été central dans l’acceptation par la bourgeoisie française de la République puisque le commerce avec l’État devenait sans risque à travers le droit de la responsabilité publique et le droit des contrats publics, tous les deux basés sur la notion de service public.
J’ai essayé de renforcer cette conviction à travers des études de cas montrant comment l’État français a regardé les services publics différents : la pédagogie Freinet, les lycées autogérés, les psychothérapies institutionnelles, l’enseignement mutuel. Ce que j’essaye de montrer c’est que l’État a soit mis fin aux expériences de services publics horizontaux soit les a marginalisées. En aucun cas il n’a essayé de soutenir et généraliser ce modèle.
Le cas Freinet et les difficultés des services publics humanistes
Freinet était un instituteur de l’entre-deux-guerres, socialiste, dont l’idée était de réformer profondément l’école pour former les futurs citoyens et préparer l’avènement d’une société socialiste[1]. Son prestige à l’époque était très important. Aujourd’hui, il y a plus d’écoles Freinet à l’étranger qu’en France !
L’idée de Freinet était donc de démocratiser l’école en favorisant les relations horizontales, c’est-à-dire le travail du groupe et les réunions tous les matins pour favoriser le dialogue et les retours d’expérience. Freinet met en place une coopérative d’enfants dont le but est d’éditer un journal des élèves, qui a un objet pédagogique, mais aussi économique : financer les activités que l’instituteur met en place dans son école (cinéma, etc.). Freinet institue en outre un conseil des élèves, dont on peut trouver la description suivante : « le samedi soir, les élèves se réunissent. Le président, dont on comprend qu’il a été élu par ses camarades, s’assied à la place du maître. L’instituteur se tient au fond, dans une posture discrète et rassurante. Le secrétaire, qui est sans doute lui aussi élu, lit le compte rendu des travaux précédents. On examine la situation financière de la coopérative. Puis on discute de différentes questions. Le rituel est précis et régulier. Le champ des questions abordées est très large. On parle des problèmes financiers, disciplinaires, du travail que chacun a accompli pendant la semaine »[2]. La description donnée de ses conseils dans les ouvrages montre qu’il s’agit de gérer, dans le groupe, les questions de violence, de réguler les comportements.
À la suite d’un conflit avec le Maire du village, la presse conservatrice part en guerre contre l’instituteur, qui finit par être sanctionné. Freinet quitte le service public, ouvre son école dans le secteur privé. Cette histoire, avec d’autres que je développe dans le livre[3], vise à montrer le refus dans l’État français d’un service public inclusif, fût-il complètement minoritaire. Le modèle du service public en France reflète les valeurs dominantes d’ordre et de hiérarchie des groupes sociaux conservateurs, si bien d’ailleurs que le secteur privé ne fournit pas d’alternative pédagogique intéressante au service public.
Cet épisode met en évidence le refus de relations démocratiques dans le cadre du service public, ainsi que le refus d’un pluralisme des méthodes pédagogiques dans l’enseignement. D’autres cas que j’étudie, par exemple la psychothérapie institutionnelle, montrent que ces services psychiatriques horizontaux sont cantonnés au secteur privé. On perçoit cependant, avec des films comme l’Adamant de Nicolas Philibert, que le secteur public peut adopter cette philosophie mettant, finalement, l’humanisme au cœur du service public.
Les communs et l’horizon d’une nouvelle pensée des services publics
L’État français est donc peu accueillant pour les services publics différents. Que peut-on faire ? Quelle rencontre avec les communs ? Et d’abord qu’est-ce qu’un commun ?
Il y a un commun à partir du moment où il y a un groupe qui partage une ressource ou qui entreprend une œuvre, qui se donne une mission. Dans son sens le plus basique, une famille est un commun, une copropriété aussi. Son sens le plus élaboré est contenu dans les recherches d’Elinor Ostrom qui concerne la gestion par une communauté d’une ressource. Ostrom a cherché à s’opposer à la vision pessimiste de Garette Hardin qui avait publié un article célèbre sur la tragédie des communs. L’idée qui en est restée est que dans une communauté qui gère un bien en accès ouvert, chacun est incité à surexploiter la ressource, car le coût est partagé entre tous les membres. La ressource est donc épuisée. La tragédie du commun aboutit à promouvoir des politiques soit de privatisation soit d’étatisation de la ressource. Ostrom montre que, dans certaines conditions, il n’y a pas de tragédie et la communauté peut très bien gérer cette ressource de façon durable. L’objectif politique derrière les travaux d’Ostrom est évidemment d’éviter l’accaparement de la ressource par une personne privée ou par l’État.
Le commun est aussi devenu un slogan dans la doctrine juridique italienne, pour mettre en place une nouvelle forme de propriété. Dans cette doctrine, les biens communs sont devenus un moyen pour élaborer un régime juridique permettant de forcer les personnes privées qui gèrent des biens ou des services d’intérêt général à les gérer pour le bien public. On retrouve cette inspiration dans le premier projet de constitution chilienne, avorté malheureusement[4].
Il y a aussi tout un volet de recherche plus ouvertement politique, mais plus ambiguë aussi, qui tente de réhabiliter l’État, l’intervention de l’État, en le couvrant de la bannière du commun. À mon sens, le commun c’est tout autre chose que l’État, ça ne peut pas être une action verticale descendante aliénant les communautés, comme c’est le cas dans tout service public en France.
Le projet politique que porte le commun, c’est un projet dont le centre est la communauté. Comment une communauté peut-elle gérer un bien, un service de façon autonome ? La difficulté de la gouvernance des services publics tient à plusieurs éléments : il y a d’abord deux communautés (usagers et agents), dont les intérêts ne sont pas forcément alignés, et la communauté des usagers est souvent difficile à organiser : il peut s’agir d’une communauté fermée dans une école ou un hôpital psychiatrique, facile à organiser, ou d’une communauté complètement ouverte, comme une piscine par exemple. Il n’y a donc pas de modèle que l’on pourrait copier pour chaque service. J’ai donc essayé de regarder à l’étranger.
La floraison d’utopies à l’étranger
À la différence de la France où, à part quelques expériences minoritaires, l’innovation dans le sens de l’inclusivité est évacuée de l’État, il existe en Europe une floraison d’initiatives visant à produire des services publics autrement, en développant une relation différente à la société, ce que Erik Olin Wright a appelé les « utopies réelles »[5]. Il s’agit toujours d’impliquer davantage la société civile dans la définition et la gestion du service public.
L’exemple le plus intéressant est certainement l’Allemagne qui a connu à la suite de la crise financière de 2008 et de la catastrophe de Fukushima un changement profond de paradigme dans la gestion des services publics. Après avoir connu, au nom de l’absence d’alternative, une tendance forte vers la privatisation, l’ouverture à la concurrence et l’adoption de formes sociales privées plutôt que publiques pour la fourniture des services d’intérêt général, une nouvelle tendance a émergé, si bien que l’on a pu parler de retour de balancier vers l’élaboration d’une alternative transparente et populaire à la privatisation.
Le changement de paradigme induit par la catastrophe de Fukushima s’est aussi traduit dans la relation de la société civile aux services publics avec un essor de la forme coopérative. Le nombre de coopératives énergétiques, par exemple, est passé de 66 à 700 de 2011 à 2013, et ce secteur ne fait que refléter une tendance plus globale en faveur de cette forme sociale. La coopérative n’a ainsi plus l’image désuète qu’elle pouvait véhiculer jadis. Au contraire, ce choix correspond à la volonté de mettre en avant la participation des citoyens.
La coopérative est l’outil juridique central et le partenariat qu’elle met en place peut prendre deux formes : le partenariat municipalité-citoyen (public-citizen partnership) et le partenariat à plusieurs partenaires.
Le premier est un partenariat entre la municipalité et les citoyens dont l’objet est la formation d’une coopérative. Dans ce cadre, les citoyens s’engagent à remplacer ou à compléter l’action des services municipaux. Ce cas de figure apparaît le plus souvent quand une ville menace de mettre un terme à certains services. Ce partenariat permet d’assurer la pérennité du service, mais sous une autre forme et avec un rapport différent à la société civile. Un cas particulièrement intéressant est celui de la coopérative citoyenne : elle est possédée par les citoyens et la municipalité fournit certaines facilités comme des locaux par exemple. De multiples arrangements sont donc concevables entre la ville et les citoyens avec des niveaux d’engagements réciproques très divers. Ce partenariat implique cependant un tout autre rapport entre le service et les citoyens. Une recherche sur ces partenariats a mis en évidence que ce modèle de coopérative permet d’améliorer l’auto-organisation des citoyens et dynamise la participation, la solidarité et la cohésion sociale au niveau local[6].
Le second est le partenariat à plusieurs partenaires (multi-stakeholder partnership). Il permet de réunir ensemble des acteurs publics et privés, des entreprises, des citoyens, pour la réalisation d’un service. Le principe « une personne une voix » peut poser un défi à ce genre de coopérative, car les personnes publiques ont du mal à abandonner tout pouvoir sur un service qu’ils financent.
L’étude des exemples étrangers m’a donc amené à réfléchir à l’intérêt de la coopérative pour porter des services publics.
La coopérative de service public : une forme d’avenir ?
Ce que j’ai essayé de faire c’est donc de réfléchir à des structures pouvant porter ces services. Schématiquement, en France, ces structures sont de deux types : l’établissement public, qui est la forme juridique des services publics en France ; la société anonyme lorsque ces services sont privatisés ou l’association dans les secteurs non lucratifs. Curieusement, il n’y a pas en France d’étude sur la coopérative dans le domaine des services publics, alors même que cette forme présente des avantages : elle est démocratique puisque le capital est réparti de façon égalitaire entre tous les membres de la communauté qui disposent tous des mêmes droits de vote ; elle empêche d’utiliser le service comme une vache à lait puisque les bénéfices doivent être réinvestis.
La coopérative de service public est donc restée anecdotique en France. C’est la loi du 17 juillet 2001 créant les sociétés coopératives d’intérêt collectif qui officialise cette rencontre. Il s’agit d’une société commerciale, qui dispose donc d’un capital. L’objet de ces sociétés est la « production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif, qui présentent un caractère d’utilité sociale ». La loi ne définit pas ces notions d’intérêt collectif et d’utilité sociale. La communauté des bénéficiaires est circonscrite par la loi puisque les tiers non sociétaires ne peuvent bénéficier de l’activité de la coopérative. Et ne peuvent être sociétaires que les personnes, physiques ou morales, qui contribuent par tout moyen à l’activité de la coopérative (article 19 septies). C’est en ce sens que l’on parle d’intérêt collectif. L’objet de la coopérative est de servir ses membres et pas l’ensemble de la société. C’est en ce sens qu’elle se différencie d’un service public classique qui est en principe ouvert à tous. La loi prévoit deux types de sociétaires, de façon non limitative : les clients et les salariés. On voit donc bien ici les deux publics privilégiés que vise l’objet de cette coopérative.
Les règles de prise de décision à l’assemblée générale de ces coopératives tendent à respecter l’idéal démocratique d’une personne une voix. En tout cas, ces règles se démarquent nettement des règles de décisions dans les sociétés capitalistes classiques. La règle de principe est ainsi que « Chaque associé dispose d’une voix à l’assemblée générale » (article 19 octies). Il est possible cependant de répartir les sociétaires en collège et, dans ce cas, la loi privilégie la solution de collèges qui ont chacun autant de poids dans la prise de décision, mais elle précise tout de même que les statuts peuvent en disposer autrement. La loi interdit aux personnes publiques de dépasser 50 % du capital et des droits de vote, certainement pour éviter la nationalisation, qui aurait des conséquences démocratiques importantes en faisant rentrer la structure dans le secteur public.
La coopérative présente donc des intérêts certains dans le domaine du service public et pourrait constituer une forme intéressante pour organiser les communautés et leur permettre de porter des services d’intérêt général. Il s’agit en tout cas d’une forme qui permet d’éviter l’écueil autoritaire de la gestion étatique traditionnelle et l’écueil capitalistique des services publics privatisés.