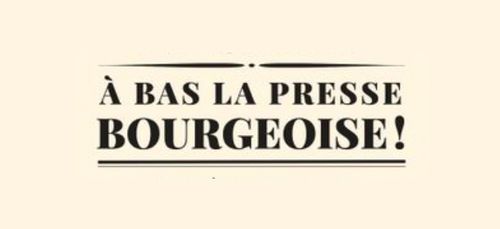La liberté de la presse a ceci de commun avec la République qu’elle est aujourd’hui défendue même par les forces politiques qui ont le plus férocement ferraillé contre elle dans un passé pas si lointain. A trop attribuer aux seuls libéraux les acquis de ce combat, on en oublierait presque que ce dernier avait aussi partie liée avec la lutte des classes. Ainsi, au moment de 1968, comme le montre cet extrait de l’ouvrage A bas la presse bourgeoise. Deux siècles de critique anticapitaliste des médias, de 1840 à nos jours paru chez Agone en 2022. La critique anticapitaliste des médias dans les années 1960 et 1970 peut apparaître comme un outil pour penser le présent des alternatives à imaginer. Nous remercions l’auteur et l’éditeur pour leur autorisation de reproduire cet extrait.
Contrairement à l’image qui en est souvent donnée, la critique des médias en 1968 ne se réduit pas à la dénonciation d’une télévision aux ordres de De Gaulle, même si ce mot d’ordre rallie les foules d’étudiants et de grévistes. Au sein de l’ORTF, le personnel mène une grève massive entre le 17 mai et le 23 juin, à laquelle se joignent les journalistes de télévision. Et pendant que les véhicules des actualités télévisées s’attirent les foudres des manifestants, la Maison de la radio, occupée par les grévistes, se transforme en quartier général de la mobilisation[1]. Pendant ce mouvement, c’est l’autonomie, conçue comme condition de l’impartialité de l’information, qui figure au premier rang des revendications. Mais il n’est pas uniquement question de maintenir l’État à distance: l’exigence d’autonomie est formulée au nom d’un service public intransigeant vis-à-vis de l’introduction de la publicité commerciale et de toute perspective de privatisation, même partielle[2].
Une presse qui n’est pas épargnée par les critiques
Si l’audiovisuel est au cœur des critiques pendant les événements de mai, la presse n’est pas épargnée: non seulement les grèves perturbent la parution et la diffusion des journaux, mais treize sociétés de rédacteurs sont créées entre mai et juin, soit autant qu’au cours des deux années précédentes[3]. Enfin, les grands journaux ont beau suivre l’évolution d’une opinion publique choquée par les violences policières[4], ils restent associés, par les groupes les plus militants, à une presse bourgeoise avec laquelle il faut rompre. D’où la multiplication des publications oscillant entre gauchisme, satire et contre-culture, qui caractérisent le mouvement et en prolongent l’esprit dans les années suivantes. Les fameuses affiches de l’«atelier populaire de l’ex-École des beaux-arts» témoignent de la vigueur des critiques que suscite la presse écrite aux côtés de l’ORTF : si certains murs proclament que «La police vous parle tous les soirs à 20 heures», d’autres assurent au passant que la presse est semblable à un flacon de poison sur lequel il est nécessaire de préciser «Ne pas avaler».
Ces slogans ne peuvent être réduits aux excès de la radicalisation des forces en présence. La condamnation sans nuance des grands journaux s’explique moins par un emballement du verbiage gauchiste que par la résurgence d’une critique sociale de la presse, assimilée à un canal d’information aux mains de la bourgeoisie. L’affiche «Toute la presse est toxique» l’illustre sans ambiguïté: une usine dont la cheminée est remplacée par un poing levé invite à lire «les tracts, les affiches, le journal mural» des grévistes. Ceux qui s’émeuvent d’un manque de nuance passent à côté de l’essentiel[5]. «Toute la presse est toxique» signifie avant tout que la presse, en tant qu’industrie capitaliste, ne peut pas échapper à une tendance de fond: pencher irrémédiablement du côté de l’ordre et des patrons. Une telle sentence n’est pas incompatible avec une analyse plus fine, qui n’a évidemment pas sa place dans un slogan par définition ramassé et tourné davantage vers l’action que vers la démonstration. La même remarque vaut pour les critiques sans concession qui continuent à fleurir après la vague de mai-juin 1968 et dont le journal du dessinateur Siné, L’Enragé, est un bon représentant: la couverture de son dixième numéro, en octobre de la même année, représente un lecteur dont le cerveau reçoit à travers un entonnoir le contenu des principaux quotidiens (de L’Humanité au Figaro en passant par France-Soir et Le Monde), et dont les oreilles laissent s’échapper des croix de Lorraine, symbole du mouvement gaulliste.
En 1968, c’est donc le système médiatique dans son ensemble qui est pris à partie. Cependant, toutes les critiques ne s’expriment pas avec la même ardeur. Le lien particulier que de Gaulle entretient avec la télévision attire les plus virulentes. Tandis que la radio publique jouit d’une plus grande latitude dans la couverture des événements[6], le verrouillage de l’information au sein du monopole télévisuel public valorise, par opposition, la liberté d’action et de ton des médias privés. Pendant que le journal télévisé de 20 heures est réduit au service minimum, les stations périphériques permettent aux Français de suivre au plus près le déroulement du conflit[7]. Pour autant, ces radios n’échappent pas aux critiques: sur une autre célèbre affiche, «RTL» et «Europe 1» sont inscrits sur les bras levés d’un de Gaulle au visage remplacé par un écran de télévision et dont le ventre arbore «ORTF». Quant à la presse écrite (dont les équipes ont été profondément rajeunies dans les années 1960[8]), une partie peut faire preuve, à l’égard des manifestants et des grévistes, de compréhension – voire de bienveillance, comme Le Monde, en pleine expansion[9]. C’est ce décalage flagrant entre l’audiovisuel public et le secteur privé qui préserve le capitalisme médiatique d’un assaut frontal. L’essentiel est ailleurs, dans la bataille contre le pouvoir gaulliste et, pour certains, dans les espoirs d’une révolution que la presse militante et subversive contribuerait à précipiter.
Un bilan ambivalent sur le plan médiatique
Sur le plan médiatique, le bilan de Mai 68 s’avère ambivalent. La grève de l’ORTF, tout d’abord, s’achève sans que rien, ou presque, ne soit obtenu. Les journalistes de la télévision, qui poursuivent leur mouvement jusqu’au 12 juillet, sont frappés par une vague de licenciements et de mutations punitives touchant près d’un gréviste parisien sur deux[10]. La perspective d’un service public audiovisuel affranchi du contrôle gouvernemental comme de l’emprise des capitaux privés s’efface derrière le rétablissement de l’ordre imposé par l’État. C’est bien «une certaine idée de la radio-télévision» qui est vaincue à ce moment-là, conclut Jean-Pierre Filiu dans son livre sur la grève de l’ORTF en mai 1968[11].
L’idéal d’un monopole garantissant un service public indépendant reste porté par la gauche. Le projet de loi déposé par le groupe communiste à l’Assemblée en mai 1970 décrit une nouvelle structure composée d’une Société nationale de radiodiffusion et de télévision française, dont le conseil d’administration comprendrait des représentants du gouvernement, du Parlement, du personnel et du public. Dans ce système, le gouvernement aurait la possibilité d’utiliser l’antenne à tout moment, mais le Parlement, les grandes centrales syndicales et les partis politiques pourraient y avoir régulièrement accès[12]. Hors du PCF, les projets manquent toutefois de précision et de cohérence[13].
De son côté, la presse, qui a connu de forts tirages pendant les événements, semble se renouveler dans un sens moins défavorable aux initiatives anticapitalistes ou, en tout cas, aux tentatives destinées à préserver l’indépendance des journalistes. La parution, en 1968, du livre de Jean Schwœbel, La Presse, le pouvoir et l’argent, popularise les idées portées par le mouvement des sociétés de rédacteurs. La filiation avec les projets issus de la Résistance est revendiquée: il s’agit, pour le président de la FFSJ (Fédération française des sociétés de journalistes), de faire aboutir ce qui a été interrompu autour de 1947. L’élaboration d’un statut particulier des entreprises de presse est remise à l’ordre du jour dans la mesure où c’est son abandon qui a permis aux spéculateurs de reprendre leurs positions, profitant des faiblesses d’une presse politique peu familière des logiques entrepreneuriales[14].
Le projet de la FFSJ n’a rien de révolutionnaire. Il ne s’agit ni de rétablir un système comparable à celui de la SNEP (Société nationale des entreprises de presse, impliquant une redistribution des biens saisis [voir l’article de Baptiste Giron dans ce dossier]), ni de nationaliser le secteur (au risque d’un contrôle étatique), ni même de généraliser une structure coopérative (qui noierait les journalistes dans la masse des ouvriers et employés des journaux). Pour Schwœbel, n’est viable que la participation collective des journalistes au capital de sociétés de presse à lucrativité limitée. Autrement dit un statut interdisant la distribution de dividendes importants aux actionnaires et octroyant aux sociétés de rédacteurs un droit de veto. Afin que ce système ne profite pas qu’aux entreprises les plus fortunées, une Fondation nationale de l’information (financée par l’État et par une taxe prélevée sur les journaux commerciaux) assurerait aux moins rentables l’accès au matériel de fabrication et d’impression. Pour le philosophe Paul Ricœur, préfacier du livre, ce dernier point est décisif :
La solution en cours au Monde, et ailleurs, aurait plus de chance de faire éclater l’ordre capitaliste si elle retenait quelque chose de la nationalisation ; si elle était couplée, comme le propose Jean Schwœbel, avec la création d’une Fondation nationale de l’information, indépendante de l’État mais soutenue par lui, qui mettrait des moyens ultra-modernes d’impression et de distribution à la disposition d’équipes de journalistes et soustrairait ainsi l’information aux lois du marché et du profit.[15]
Ricœur insiste sur ce point car, au moment où le livre de Schwœbel paraît, les sociétés de rédacteurs apparaissent comme une modalité penchant, selon le philosophe, du côté du «pouvoir capitaliste». Sans une franche prise de distance, l’émancipation de la presse serait incomplète. Cet appel à «retenir quelque chose de l’idée de nationalisation», dans la continuité des réflexions de Léon Blum et Jacques Kayser, se justifie par le caractère en apparence très réformiste du projet porté par la FFSJ. En effet, il s’agit de garantir le pluralisme de l’information sans remettre en cause ni la propriété privée des entreprises de presse ni leur caractère commercial, dont il faut simplement atténuer les effets délétères. Cette proposition modérée attire d’ailleurs la sympathie de quelques propriétaires ou directeurs de journaux – comme Hubert Beuve-Méry (au Monde) et Pierre-René Wolf (à Paris-Normandie)[16].
Une forte combativité du monde de la presse
En présentant les objectifs du mouvement des sociétés de rédacteurs, Jean Schwœbel est convaincu que l’émancipation de la presse, comme de la radio et de la télévision, est à portée de main. «Les temps sont proches où l’on trouvera totalement inadmissible que l’information soit contrôlée par des intérêts privés et pratiquement soumise à la loi de la publicité», assure-t-il[17]. La combativité d’une frange de la profession nourrit cet optimisme. Le nombre de sociétés de rédacteurs continue de croître : dépassant la trentaine après 1968, elles regroupent jusqu’à 2 000 adhérents, soit un journaliste sur cinq[18]. Celle du Figaro soulève tout particulièrement de nouveaux espoirs en remportant une grande victoire face à Jean Prouvost, qui détient, avec Ferdinand Béghin, la majorité du capital de la société propriétaire du titre. Après 1964 et la mort de Pierre Brisson, directeur de la publication depuis la Libération, Prouvost tente d’étendre son contrôle à la rédaction. Résistant à cette manœuvre, la société des rédacteurs du Figaro mène une grève en mai 1969. À l’issue des négociations, qui durent jusqu’en mai 1971, l’accord ne sert pas les intérêts de Prouvost: une société de gestion, distincte de la société propriétaire à sa botte, doit garantir l’indépendance de la rédaction[19].
Au lendemain de Mai 1968, le capitalisme de presse, à défaut de trembler, a quelques raisons d’être préoccupé. D’autant que, parmi les centaines de publications qui ont vu le jour, certaines (à la longévité variable) prolongent la lutte initiée dans les universités et les usines – Action, Les Cahiers de Mai, Rouge, etc. Dans le grand bouillonnement contestataire de l’après-mai, l’heure est à la provocation et à la satire (Charlie Hebdo naît en 1970, après l’interdiction de Hara-Kiri), mais aussi aux projets de transformation de l’information sur des bases anticapitalistes: le lancement de Libération, en 1973, se fait sans publicité ni actionnaires extérieurs, dans le but de donner la parole au peuple[20]. Au même moment, les partis de gauche semblent converger pour endiguer l’extension des pouvoirs du capital dans les médias. Fruit d’un compromis entre le PCF, le PS (qui a succédé à la SFIO en 1969) et les radicaux de gauche, le programme commun de 1972 tranche fermement sur cette question:
“Le droit à l’information est un droit de l’individu et une donnée de la démocratie.
Ce sont les journaux et la radio-télévision qui assurent pour l’essentiel l’information. Or il existe une contradiction entre le caractère public de l’information et le caractère de plus en plus privé de la propriété des moyens d’information. Ainsi l’ORTF, qui devait être au service de la nation, est un instrument de propagande entre les mains du pouvoir, lui-même au service des puissances d’argent.
Quant aux journaux, tant qu’un petit nombre de groupes financiers pourra contrôler les moyens d’expression comme les moyens de production, on ne saurait parler valablement de liberté de la presse.
Il faut donc soustraire l’information à la domination de l’argent”.[21]
Parmi les mesures annoncées, une modification du statut des NMPP (Nouvelles messageries de la presse française) doit mettre fin à «l’emprise du groupe Hachette». En outre, une série de dispositions (exonérations fiscales, aides financières, etc.) est censée pallier les difficultés que rencontrent les journaux d’information. Quant à la radio-télévision, son avenir est envisagé sous la forme d’un service public dont l’indépendance à l’égard du gouvernement sera garantie par un conseil d’administration «composé en majorité des représentants du Parlement, des personnels de la société, de représentants qualifiés des auditeurs et téléspectateurs». Signe de la volonté de rompre avec l’ouverture commerciale décidée en 1968, la publicité de marques (introduite sur la deuxième chaîne en 1971) sera supprimée au profit d’un financement reposant sur la redevance et diverses taxes – que devront payer notamment les stations périphériques[22]. Le programme a beau ne pas briller par sa radicalité – aucun statut particulier des entreprises de presse n’est évoqué, pas plus que la nationalisation de Hachette[23]–, il suffit à faire planer un inquiétant nuage au-dessus de la tête des magnats des médias.
Mais le fond de l’air ne reste pas rouge très longtemps. Les résistances à la concentration dans le secteur de la presse, comme la critique plus ou moins gauchisante des journaux bourgeois et la lutte pour faire de l’audiovisuel un service public indépendant du gouvernement et des capitaux privés, n’aboutissent à aucune réforme structurelle dans la décennie suivant Mai 68. Sous le septennat de Valéry Giscard d’Estaing, élu en mai 1974, le capitalisme de presse se renforce tandis que la réorganisation de l’audiovisuel obéit à une logique contraire aux principes défendus en la matière par les syndicats et la gauche.