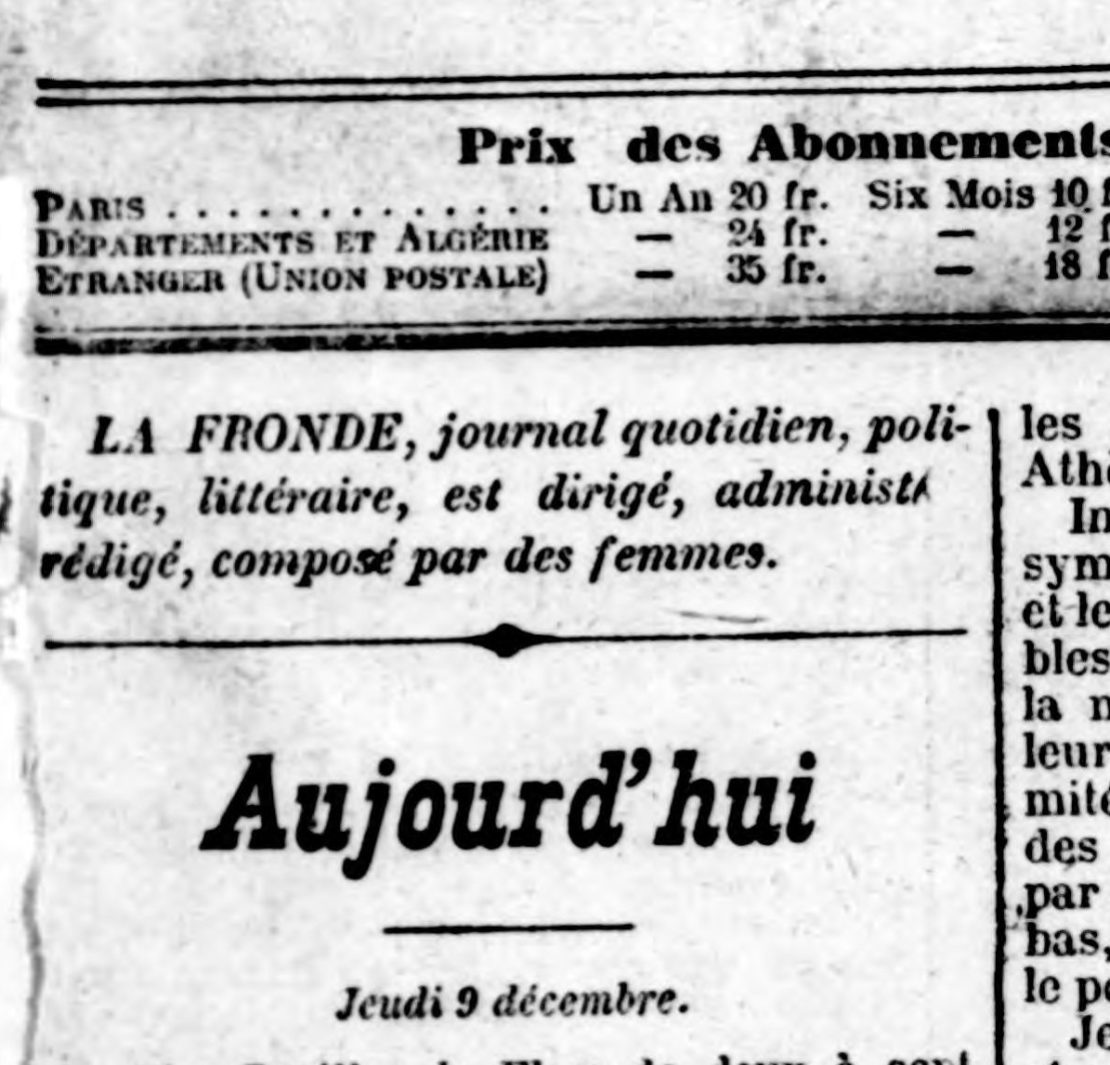Fondé par Marguerite Durand en 1897, La Fronde est le premier quotidien féministe dans le monde entièrement conçu et dirigé par des femmes, des journalistes aux typographes en passant par les imprimeurs et colporteurs. Dans un milieu médiatique essentiellement masculin et plus généralement dans un contexte sociétal peu enclin à défendre les droits des femmes, ce journal va permettre de relayer les idées féministe, les réflexions, critiques et revendications portées par des femmes. Quotidien jusqu’en septembre 1903, il devient un mensuel jusqu’en mars 1905 et parait de manière irrégulière par la suite.
Nous reproduisons ici deux articles du premier numéro paru le 9 décembre 1897 écrits par deux autrices – Marie-Anne de Bovet et Maria Pognon – aux parcours très différents; illustrant ainsi la diversité des courants féministes qui, défendant des positions parfois antagonistes sur le plan politique, ont pu converger pour porter en avant des exigences d’égalité des droits entre les femmes et les hommes.
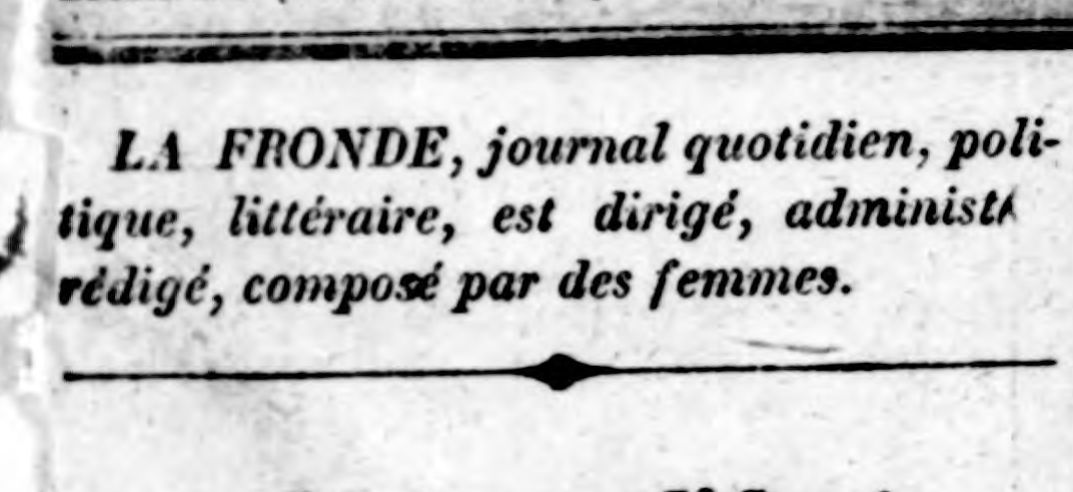
“Ménagères ou Courtisanes?” de Marie Anne de Bovet (La Fronde, 1897)
Cet article est le premier article de ce premier numéro. “Ménagères ou Courtisanes?”. Romancière, critique littéraire, chroniqueuse, femme de lettres mondaine qui fréquentait les salons, Marie Anne de Bovet (1855-19..) s’attaque, dans cet article, aux préjugés misogynes et défend les droits des femmes et l’intelligence féminine. Fille de militaire, elle prend parti pour les anti-Dreyfusards aux côtés des nationalistes pendant l’affaire Dreyfus.

Qui donc disait qu’une preuve de l’existence de Dieu assez forte pour dispenser d’en chercher d’autres est la rage où son seul nom jette ses détracteurs? Car on ne s’acharne point contre le néant, et la valeur de l’ennemi se mesure à l’âpreté de l’attaque.
Toutes proportions gardées, n’y aurait-il pas quelque peu de cela dans les colères soulevées par les femmes qui ont l’impertinence de faire œuvre de leur cerveau? Si l’on apprenait que des culs-de-jatte s’organisent en corps de ballet, on ne perdrait pas son temps à leur démontrer fort aigrement l’extravagance de leur dessein. Pourquoi alors, sous prétexte que la nature ne nous aurait point créées à des fins intellectuelles – on peut la faire parler, la nature… pas de danger qu’elle donne de démentis – s’épanche-t-on au sujet de celles qui, tant bien que mal, s’attachent à prouver le contraire, en réflexions plus ou moins désobligeantes, dont le parti pris de dénigrement, ne sortant de la niaiserie que pour tomber dans l’insolence, me semble être plutôt de quoi nous enorgueillir.
Pour combattre le goût de l’activité intellectuelle chez les femmes, on emploie tour à tour les injures ou les fadeurs. Celles-ci consistent en un certain nombre de clichés, tel: «la force de la femme, c’est sa faiblesse». Non, vraiment, il est des choses qu’il ne faudrait plus dire: elles ont trop servi – c’est comme: «il n’y a plus de Pyrénées», ou bien «l’argent ne fait pas le bonheur». Si on savait aussi ce que cela finit par être énervant, d’avoir les oreilles rebattues de notre charme et de notre beauté – surtout celles qui n’en ont pas.
Il y a encore nos trésors de charité, de dévouement, d’abnégation. Assez ingénieux, cela, parce que c’est pour nous en donner l’idée. A force de l’entendre répéter, nous finissons par le croire, et on en profite. Seulement il ne faudrait pas généraliser, ah! non…
Et d’ailleurs cela n’a rien à voir dans l’affaire, n’étant nullement incompatible avec des occupations quelconques.
Le répertoire de la galanterie française – cette galanterie que le monde nous envie – « est une sorte de crème à la vanille qui finit par donner mal au cœur. Plutôt encore les gros mots. Aussi l’autre jour, ouvrant une édition de luxe de Manon Lescaut, ornée d’une préface de Guy de Maupassant, ai-je pris plaisir à y trouver un très artistique retapage de cet autre thème également délabré, mais moins insipide.
Se fondant sur l’expérience des siècles qui a démontré l’incapacité cérébrale de la femme, l’ingrat écrivain dont elles sont les plus ferventes admiratrices – cela s’appelle tirer sur ses propres troupes – les confine exclusivement «dans deux rôles bien distincts et charmants tous les deux: l’amour et la maternité». – Pourquoi distincts? Vous allez voir. « Les Grecs comprenaient bien cette double mission. Celles qui devaient leur donner des enfants, saines et fortes, étaient enfermées dans la maison, toutes occupées du devoir sacré, de la sainte besogne d’enfanter et d’élever. Celles qui devaient leur donner de l’amour, charmantes, spirituelles et tendres, vivaient libres, entourées d’hommages et de soins».
Les maris auraient peut-être aimé parfois n’avoir pas à sortir de chez eux pour trouver de la tendresse, de l’esprit et du channe. Quant aux matrones, la captivité dans la gynécée et la pensée que leur époux portait ses galanteries ailleurs, cela semble une maigre rétribution pour leur besogne sacrée. Et s’il se trouvait des Grecques n’ayant point la vocation unique de moucher des marmots, sans cependant posséder les capacités physiques et morales – je veux dire immorales – indispensables à l’emploi des Aspasies, destinées a à ravir les yeux, à «ravir les yeux et à captiver l’esprit, à troubler les cœurs», celles-là, qu’en faisait-on? À Sparte, on les eût supprimées, peut-être, mais à Athènes?
Inutile de dire qu’à l’hétaïre vont les sympathies de l’auteur de Boule de Suif, et les nôtres aussi, tant il les peint aimables. «Les grands hommes vivaient dans la maison des courtisanes, écoutaient leurs conseils, trouvaient dans leur intimité cette grâce délicate…» – suivent des propos si obligeants que je les passe, par égards pour la pauvre matrone, là-bas, dans la gynécée, en train de moucher Alcibiade.
Je sais bien quelle «griserie sensuelle et poétique ces femmes ensorcelantes versaient de leurs lèvres et de leurs yeux»; mais je me demande quels conseils elles pouvaient donner à leurs illustres amants. Plutôt pernicieux, je le crains, si elles ressemblaient à Manon, puisque – voici les gros mots qui arrivent – «cette figure si plein de séduction, dans laquelle est incarné tout ce qu’il y a de plus gentil, de plus entraînant, de plus infâme dans l’être féminin, c’est la femme toute entière, telle qu’elle est et qu’elle sera toujours».
Plus de distinction entre celle de rue et celle de foyer: la femme tout court, l’espèce féminine. Et c’est à cet être infâme, variété matrone, que les Grecs confiaient l’éducation de leurs fils, à cet être infâme, variété hétaïre, que les philosophes et les capitaines auraient demandé conseil? Étrange.
« Ne retrouvons-nous pas en elle l’Evedu paradis perdu, l’éternelle et rusée et naïve tentatrice qui ne distingue jamais le bien du mal… » – Pardon: c’est justement pour apprendre cela qu’elle a mordu à la pomme, et c’est grâce à elle que ce lourdaud d’Adam a fait de même. On le lui a assez reproché, à cette pauvre femme.
«… Qui ne distingue jamais le bien du mal, et entraîne par la seule puissance de sa bouche le mâle faible et fort » – Ceci n’est pas très clair. – « Des Grieux, dès qu’il a rencontré cette fille, devient par la seule contagion de l’âme féminine, par le seul contact de cette nature dépravante, un fripon, un gredin, l’associé presque inconscient de cette inconsciente et délicieuse gredine ».
Eh bien! vraiment, si c’est cela, la femme, c’est un médiocre présent que le Père éternel a fait à l’homme pour l’accompagner dans la vie. Qu’on nous en débarrasse bien vite et que le monde finisse.
Pour en revenir à la question de métier, les deux qui nous sont offerts au choix présentent un inconvénient commun à tous les autres: l’encombrement. Dans la maternité, c’est-à-dire le mariage, la concurrence est terrible. Dans l’amour, infiniment plus rémunérateur, peut-être se trouve-t-il encore à prendre quelque places honorables. Mais notre époque embourgeoisée nourrit contre la profession de courtisane un préjugé absurde sans doute. Car enfin, si les filles d’Eve sont infâmes par essence – c’est la faute de ce scélérat de serpent – autant qu’elles aient le courage et l’agrément de leur état.
Ou bien serait-ce que l’homme veut se les persuader méprisables afin de se trouver soi-même, par comparaison, un parangon d’honneur? Il aurait tort. Se plaire en compagnie infâme est pire que l’être soi-même. Si le sens moral n’est rien, pourquoi traiter les Manon de drôlesses? S’il est quelque chose, que dire des Des Grieux ?
Parlons un peu raison. Selon ses goûts et ses moyens, un homme sera conseiller d’État ou marchand de marrons. Qu’on laisse aussi les femmes ordonner leur vie à leur guise et à leurs risques, le plus honnêtement possible. Quand on a démontré que le métier de portefaix convient mieux à l’homme, inapte par contre à celui de nourrice, on a découvert l’Amérique. Une femme intelligente est supérieure à un imbécile comme un homme d’esprit à une sotte, vérité également incontestable. Enfin l’amour ou la maternité, voire les deux, se peuvent cumuler avec d’autres fonctions. Que nous fassions des confitures ou de la littérature, de l’art ou des enfants, de la médecine ou des potins, il y en aura toujours qui seront belles et coquettes ou le contraire, qui seront amoureuses, qui auront des vertus et même, puisqu’on y tient, des vices. Quant à la valeur intellectuelle, elle se jauge à une mesure unique. Si ce qu’une femme écrit est bon, on le lit, sinon on le laisse. C’est une épreuve très simple et très sûre, qui épargne bien des flots d’encre et de lieux communs.

“Féminisme” de Maria Pognon.
Publié en deuxième page de ce premier numéro, cet article de Maria Pognon (1844-1925) est signé au titre de Présidente de la Ligue Française pour les Droits des Femmes (LFDF), fonction qu’elle a exercée de 1892 à 1903. Célèbre féministe française sous la IIIe République, suffragiste, pacifiste, libre-penseuse et franc-maçonne, elle est également l’une des fondatrices du Conseil national des femmes françaises (CNFF) en 1901. Elle plaide ici pour l’égalité complète des deux sexes devant la loi.
 Féminisme est un mot créé tout récemment, vers 1802, pour indiquer l’action commune des individus des deux sexes revendiquant, pour la femme, des Droits égaux à ceux de l’homme.
Féminisme est un mot créé tout récemment, vers 1802, pour indiquer l’action commune des individus des deux sexes revendiquant, pour la femme, des Droits égaux à ceux de l’homme.
On objecte que la femme n’est pas l’égale de l’homme, qu’elle ne peut exécuter les mêmes travaux etc., etc.
Tous les hommes sont-ils égaux en capacités intellectuelles, tous ont-ils la même force de biceps? Non, n’est-ce pas?
Et cependant tous, sans distinction, jouissent des mêmes droits; le robuste et le malingre sont trouvés également bons pour aller témoigner d’un décès, d’un mariage, d’une naissance. Les femmes ont été, jusqu’à ce jour, déclarées incapables d’accomplir cet acte civil, bien qu’en général, elles soient les seuls vrais témoins des naissances et des décès.
La Chambre des députés et le Sénat viennent heureusement d’adopter un nouveau texte de loi, acceptant le témoignage de tous les citoyens, âgés de vingt et un ans, au moins, sans distinction de sexe.
Le Sénat, voulant se monter plus libéral que la Chambre, a même étendu ce droit de témoignage aux actes notariés.
C’est une première réforme qui en présage d’autres.
Les féministes demandent ensuite pour la femme le droit d’être tutrices. Les femmes doivent comprendre, à quel point il est dur pour une mère mourante, de ne pouvoir confier ses enfants orphelins à une sœur, à une parente qui les aime !
Quant aux hommes, s’il leur faut confier la tutelle de leurs filles à un homme, en trouvent-ils beaucoup qui leur inspirent, à cet égard, une confiance sans bornes?
J’en serais étonnée.
Mais, nous dit-on, la femme mariée ne peut exercer la tutelle, puisqu’elle est elle-même mineure et incapable de gérer sa propre fortune.
C’est bien là ce que nous ne voulons pas supporter plus longtemps, nous prétendons que la femme française n’est ni plus sotte, ni plus incapable que ses sœurs d’Angleterre, de Russie, de Turquie, d’Amérique, d’Australie, etc. lesquelles jouissent de leur propre fortune et la gèrent à leur gré; c’est faire injure à la Française que de la dépouiller du droit d’administrer ses biens, lorsqu’elle a le bonheur d’en posséder.
Quant à la femme qui travaille pour gagner sa vie, que dire d’une loi qui autorise le mari à toucher le produit de son travail?
Que penser d’un gouvernement, qui s’intitule républicain, et qui conserve dans son code des articles aussi injustes?
Nous voulons pour la mère des Droits égaux à ceux du père, nous ne pouvons admettre qu’un enfant puisse être envoyé en correction, embarqué, etc. sans le consentement maternel.
Enfin, nous nous préoccupons, par-dessus tout, de la situation économique de la femme.
C’est parce qu’il lui est impossible de vivre honorablement de son travail qu’elle est contrainte de se vendre et c’est parce que les hommes se trouvent bien de ce régime qu’ils n’ont jamais aidé les femmes à sortir de leur triste condition.
Aujourd’hui les travailleurs s’aperçoivent que la concurrence faite par ces mêmes femmes est désastreuse, ils se plaignent des salaires dérisoires dont elles se contentent.
À qui la faute? Qui donc leur tend la main pour les aider à améliorer leur situation?
Lorsque l’État a créé ses Ecoles de filles, il a demandé aux Institutrices les mêmes diplômes qu’aux Instituteurs, il leur impose le même travail et il les paie moins cher. Pourquoi? Au nom de quelle justice.
Lorsque ce même État a pris des femmes dans les Postes et Télégraphes, il leur a confié la même besogne qu’aux hommes, mais il leur a attribué un salaire inférieur. Pourquoi les hommes n’ont-ils rien dit?
Parce qu’ils n’ont pas compris que ce mauvais exemple venant de haut, serait suivi avec empressement, parce que le manque d’équité envers les femmes ne troublait pas leur conscience; leur intérêt seul leur fait adopter actuellement, dans les congrès ouvriers, notre
formule À travail égal, salaire égal. Ils adoptent d’autant plus volontiers qu’ils savent parfaitement qu’à salaire égal, on renverra les femmes malgré leurs capacités, pour ne garder que les hommes qui sont électeurs, tandis que les femmes ne sont rien dans la vie publique.
Le cas s’est déjà présenté, des industriels très satisfaits de leurs ateliers de femmes, se sont aperçus, à la veille des élections, qu’ils perdaient ainsi un nombre considérable de voix, et malgré la différence des salaires, ils n’ont pas hésité à renvoyer les femmes pour augmenter les chances de leur succès électoral.
Voilà pourquoi nous demandons pour la femme les Droits politiques; c’est pour qu’on s’occupe d’elle, de ses besoins, de sa misère profonde!
Le jour où les candidats voudront obtenir les votes des femmes, ils s’apercevront qu’elles font de longues journées de travail pour gagner 1 fr. et 1 fr. 50; indignés de cet état de choses, ils lutteront pour elles et leur salaire s’élèvera comme s’est élevé celui des hommes.
En avant donc pour la bonne cause, nous voulons et nous obtiendrons :
L’Egalite complète des deux sexes devant la loi.
Comment ? En modifiant complètement l’éducation des jeunes filles, en multipliant les réunions, les conférences, en organisant des Congrès pour la propagande de nos idées, en instruisant l’opinion publique par notre journal La Fronde, auquel tous les féministes doivent souhaiter:
Longue et heureuse vie !