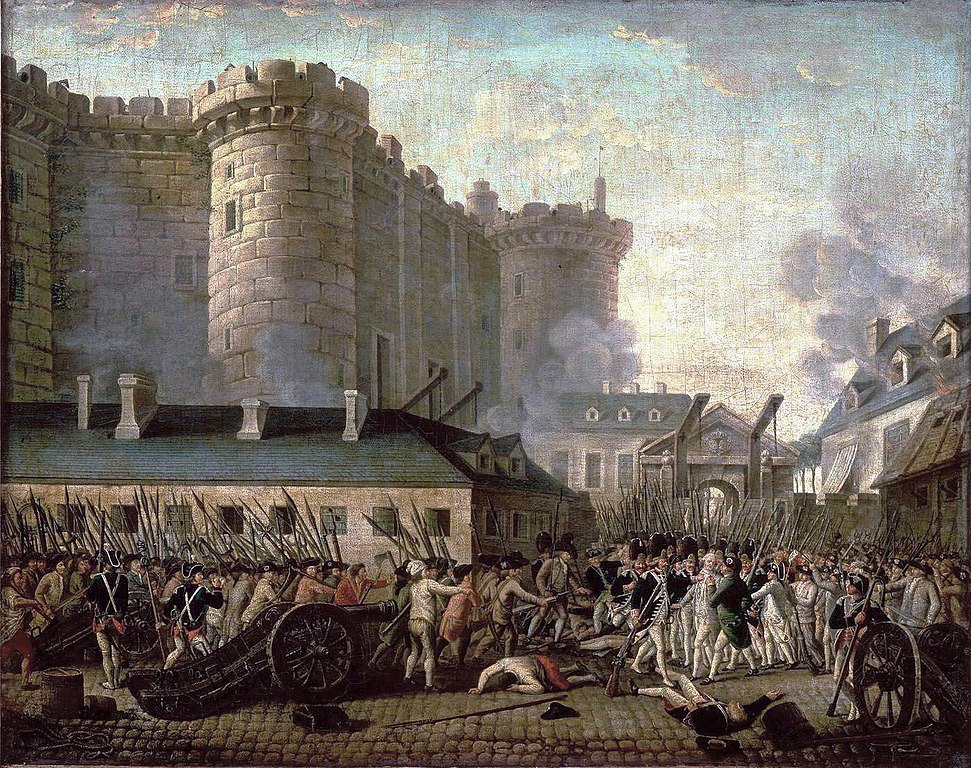Lire la partie I de cet article.
Jacobins et Girondins
Comprendrait-on mieux l’assimilation de la centralisation et du jacobinisme en disant que les milliers de sociétés populaires créées en l’an II comptèrent parmi les principaux relais de la volonté du gouvernement révolutionnaire et des mesures de salut public qu’il imposait ? Prudence. Prudence, car une des grandes confusions de l’histoire de la Révolution procède de l’assimilation Jacobins-Montagnards, quand il y a manifestement inadéquation entre les deux notions. Que les Jacobins aient constitué, en l’an II, un groupe de pression majeur, par l’ampleur de leur réseau et de l’activisme de leurs membres, il est permis de l’affirmer. Que bien des députés Montagnards aient été Jacobins, on peut le dire également. Pour autant, ce ne sont pas les Jacobins qui font la majorité à la Convention nationale, là où sont adoptées les lois et là où le « gouvernement révolutionnaire » doit rendre des comptes : c’est, à cette date, la mouvance parlementaire montagnarde. Or, d’une part, tous les députés Montagnards ne sont pas Jacobins et, d’autre part, il y a parfois, pour bien des Montagnards-Jacobins, plus qu’une nuance entre les discours qu’ils tiennent à la barre de la rue Saint-Honoré et ceux qu’ils prononcent devant la représentation nationale. Ajoutons, en outre, que quelques-uns des principaux rouages du « gouvernement révolutionnaire » (celui-là même que l’on nommait naguère « dictature jacobine de salut public »), tel le tribunal révolutionnaire, tel aussi le Comité de Salut public ou les représentants du peuple en mission, ont été créés en mars-avril 1793, à une époque où la Convention était encore dominée par les… Girondins, qui avaient en revanche déjà quitté le club des… Jacobins. Au fond, si l’on se tient à l’Assemblée nationale, là où se décide l’organisation des pouvoirs, la distinction la plus efficiente, à défaut sans doute d’être parfaitement satisfaisante, oppose donc « Montagnards » (qui sont souvent, mais pas toujours, Jacobins) et « Girondins », bien plus que le seul couple « Jacobins » et « Girondins ». Il est acquis, en revanche, que les questions de centralisation et de décentralisation ne constituent pas le substrat théorique réel de leur affrontement, chacune de ces deux mouvances parlementaires se réclamant de l’unité et de l’indivisibilité de la République, loin de toute velléité fédéraliste, quoiqu’en disent des légendes tenaces. Pour l’essentiel, la distinction entre ces deux courants du républicanisme révolutionnaire s’est principalement construite autour de l’acceptation, au moins provisoire (Montagnards, Montagnards-Jacobins), ou du refus (Girondins), du poids du mouvement populaire parisien dans la vie politique nationale, et non autour de l’acceptation ou du refus de Paris comme lieu unique de la fabrique la loi commune de la République.
Jacobinisme et centralisation: une assimilation abusive
Oui mais la loi du 14 frimaire an II (4 décembre 1793) instituant le gouvernement révolutionnaire, me direz-vous ? N’a-t-elle pas tout de même fait tomber une centralisation oppressive sur le pays ? Cela nous éloigne quelque peu de l’objet de notre discussion, le jacobinisme, mais pas suffisamment non plus pour ne pas en dire un mot. À cette date, en décembre 1793, un état d’exception (plutôt qu’un État d’exception), mettant en jeu des politiques d’exception se met en place, « jusqu’au retour de la paix ». Il sursoit à l’application de la Constitution ordinaire, celle de juin 1793, ratifiée en août par voie référendaire, sans pour autant que toutes les lois ordinaires et tous les principes constitutionnels soient abandonnés. Le décret de frimaire an II affirme le principe de la « centralité législative » : le centre unique de l’impulsion du gouvernement sera la Convention nationale – et non les Jacobins, donc, ce qui devrait aller de soi. Au sein de la Convention, la coordination de l’action politique est attribuée à deux comités : le Comité de Salut public, en charge du suivi de la politique intérieure et extérieure, et le Comité de Sûreté générale, assurant la surveillance intérieure de la République. Leurs membres auront à rendre des comptes à la représentation nationale (ils le feront), puisqu’ils tiennent d’elles chacune de leurs fonctions. Alors que les résistances à la Révolution se multiplient, alors que la guerre civile a débuté au-dedans depuis le printemps et l’été 1793 (soulèvement de l’Ouest, révoltes de Lyon, Marseille, Toulon, Bordeaux…), alors que les défaites extérieures se succèdent les unes aux autres, alors que de nombreux dysfonctionnements ont été observés dans la circulation de la loi et son application sur le terrain, alors enfin que, durant l’été et l’automne, le mouvement populaire a cherché à faire pression sur la Convention pour que celle-ci mette la « terreur à l’ordre du jour », le pouvoir législatif veut reprendre la main. C’est cette volonté de s’imposer à tous les autres pouvoirs et contre-pouvoirs, y compris sans-culottes, qui conduit, de fait, à la mise en œuvre d’une centralisation renforcée. On remarquera cependant que, loin de répondre à une « idée jacobine », le principe d’une réaffirmation du « centre » était en fait en germes depuis 1792, comme réponse aux problèmes rencontrés par le fil conducteur des pouvoirs entre Paris et la province, des problèmes largement constatés par les révolutionnaires, à commencer par les Girondins, qui n’analysaient pas autrement la situation avant leur chute.
Pour que les lois révolutionnaires (effort de guerre, justice extraordinaire, suspects) soient mieux appliquées, plusieurs pouvoirs se voient chargés de tâches d’exécution et de surveillance : les districts (un échelon administratif situé entre les communes et les départements, disparu dès 1795), ainsi que les municipalités et les comités de surveillance, créés au printemps 1793. Des agents nationaux représentant le gouvernement sont par ailleurs établis auprès de chaque échelon territorial. Ajoutons qu’en décembre 1793, les sociétés populaires, donc les clubs jacobins, se voient chargées de missions quasi-officielles de surveillance de l’action de l’administration publique. Elles sont également autorisées à délivrer des certificats de civisme, indispensables pour accéder à certains emplois publics. Des clubs politiques s’immisçant dans les affaires de l’État, à la demande de l’État ? Ne revoilà-t-il pas, finalement, notre fameuse centralisation jacobine ? Sa substance même ? Ou pis, quelque-chose d’inquiétant préfigurant les partis uniques de l’époque contemporaine ? D’aucuns historiens, il est vrai, n’ont pas hésité à écrire que c’est par l’intermédiaire de toutes ces « sociétés populaires » que « la Terreur » se serait appesantie sur la nation française.
Sans nier l’ampleur des traumatismes, des violences et de la répression qui caractérisent cette période à nulle autre pareille, force-nous est néanmoins d’admettre que, sur le strict plan de l’organisation politique, la réalité demeure autrement plus nuancée que ce que de semblables conclusions laissent entendre. D’abord parce que les sociétés populaires n’ont jamais été de quelconques organes légaux de pouvoir. Certes, il est manifeste qu’en ville, en 1793-1794, et au vrai dès avant le temps de l’exception politique, clubs jacobins et pouvoirs institutionnels sont souvent entrés en opposition, parfois brutale, les sociétés populaires s’immisçant, ou essayant de s’immiscer, dans les affaires communales ou départementales, empiétant, ou tâchant d’empiéter, sur les domaines d’actions réservées aux autorités constituées. Le cas de Lyon, où le Club Central, devenu progressivement le bastion de révolutionnaires radicaux, s’oppose à une municipalité tenue majoritairement par des « Rollandins » (Girondins) en est un exemple resté célèbre. Dans le monde rural (85% de la population) la réalité est cependant tout autre. D’une part, tous les villages, loin s’en faut, ne possèdent pas de société populaire. Lorsqu’un club existe, il est le plus souvent l’expression du vœu d’une localité majoritairement révolutionnaire, et il demeure fréquemment inféodé au pouvoir municipal. En outre, bien des localités savent se ménager des marges d’action autonome, même au plus fort de « la Terreur », grâce à la mise en œuvre de stratégies d’amortissement des injonctions émises par le pouvoir central. En se pliant aux demandes les plus urgentes du gouvernement révolutionnaire, celles surtout qui regardent l’effort de guerre (priorité des priorités du moment), ces localités obtiennent tacitement, en retour, de la part des représentants du pouvoir central, la latitude d’appliquer à leur manière, ou de ne pas appliquer du tout, d’autres lois votées à Paris. Par là, comme par leur propension à faire remonter la voix et les attentes du local, les relais du gouvernement révolutionnaire dans les départements ne répondent donc que très imparfaitement à la figure d’agents aveugles de la centralisation politique. Même en l’an II, l’unilatéralisme cède le pas devant des logiques d’interactions et de dialogues, qui rendent la centralisation toute théorique. Paradoxalement, la vie municipale atteint son apogée séculaire en 1793-1794, dès lors qu’on prend la mesure de ce mouvement à l’aune du nombre de délibérations adoptées par les localités. Mais cela était-il vraiment si peu conforme aux principes des Montagnards, voire même des Jacobins ? Saint-Just, l’un des théoriciens du gouvernement révolutionnaire et orateur assidu à la tribune du club de la rue Saint-Honoré, n’avait-il pas déclaré, en mai 1793, que l’administration municipale « est pour ainsi dire étrangère au gouvernement », car « c’est le peuple en famille qui règle ses affaires » ?
Ajoutons enfin que des lois ne relevant pas de « l’extraordinaire » continuent d’être adoptées par la Convention nationale. Or, il n’est pas rare qu’elles confèrent à l’échelon municipal l’autonomie de gestion auquel celui-ci aspire profondément. Certaines de ces lois touchent pourtant à l’essentiel aux yeux des républicains, comme c’est le cas, par exemple, pour l’instruction publique. Deux semaines seulement après la loi du 14 frimaire sur le gouvernement révolutionnaire, les députés adoptent ainsi la première véritable législation scolaire de l’histoire de la République française. Celle-ci vise à la création d’écoles primaires gratuites, publiques et obligatoires, capables de former les futurs citoyens et les futures citoyennes de la patrie. Or, la Convention en confie l’administration et la surveillance aux municipalités, ce qui favorise, de fait, la nomination de très nombreux instituteurs (20 000 peut-être, selon les estimations). Concluons en soulignant qu’en ces années 1793-1794, celles-là même qui fixent toutes les mémoires contraires de la Révolution, les sociétés populaires font à bien des égards offices de refuge de la vie démocratique. Alors que la Constitution est suspendue et que toutes les opérations électorales sont reportées, les clubs jacobins sont ces lieux où l’on vote et où l’on élit encore (choix du président et des secrétaires de la société), l’endroit où l’on pétitionne, aussi, et plus que jamais même, à destination des Jacobins de Paris ou de la Convention nationale.
Si le réseau jacobin est finalement emporté à son tour, à l’automne 1794, au lendemain de la chute de Robespierre et de ses proches, cela ne doit rien à la volonté des vainqueurs du jour, les « thermidoriens », d’œuvrer à une quelconque forme de décentralisation. Tout au contraire, la Constitution qu’il rédigent dans la foulée, celle du Directoire (1795-1799), est la plus centralisatrice que la Révolution ait connu. L’enjeu, en démantelant l’univers jacobin, est plutôt, pour eux, de dépopulariser la Révolution, de dépolitiser les classes populaires. Parce qu’ils souhaitent bâtir une « République sans révolution », dirigée par les « meilleurs » et les plus « capables », c’est-à-dire les propriétaires (ou la classe bourgeoise comme on l’aurait écrit jadis), ils rétablissent une citoyenneté à deux vitesses, passant par le suffrage censitaire. Or, le mouvement jacobin tient malgré lui son rôle dans la justification théorique de ce nouveau partage du politique : trop ignorants, pas assez maîtres de leur raison, dit-on, les humbles se seraient laissés abuser par les responsables du « système de la Terreur », ces Jacobins de la rue Saint-Honorée qui disposaient entre leurs mains d’un redoutable réseau militant pour enrôler les foules dans leurs turpitudes vandales. À des fins stratégiques, 1793 devint l’expression d’une forme de folie collective, dirigée autant que voulue par des monstres, des tyrans avides de sang (Robespierre et les siens). Les sociétés populaires auraient été l’instrument de leur scélératesse. La faute à Robespierre et la faute aux Jacobins. Il en allait de la légitimité de leur propre action, de leur propre maintien au pouvoir. L’équation se trouva ainsi posée. Elle était promise à une belle destinée. Par-delà ces considérations et ces discours construits a posteriori, il va de soi que la mise à l’écart du mouvement populaire et le rétablissement d’une forme de « citoyenneté passive » pour les classes populaires impliquaient nécessairement la destruction de ce qui fut, deux années durant, de l’été 1792 à l’été 1794, le principal levier de l’immixtion des simples citoyens dans l’espace public révolutionnaire et de leur participation active à la vie politique, locale ou nationale. Le Consulat puis l’Empire, après 1799, ne feront que prolonger ces dynamiques, en marquant le franchissement d’un palier supplémentaire dans la centralisation (c’est l’époque des premiers préfets). Mais que l’on sache, l’actualité ne conduit que rarement à des analyses déplorant le poids de l’État directorial ou bonapartiste dans notre présent. Et l’on mesure ici à quel point, comme dit le vieux dicton, l’histoire est d’abord écrite par ses vainqueurs.
Pour poursuivre : https://www.youtube.com/watch?v=VGx376-37Yo