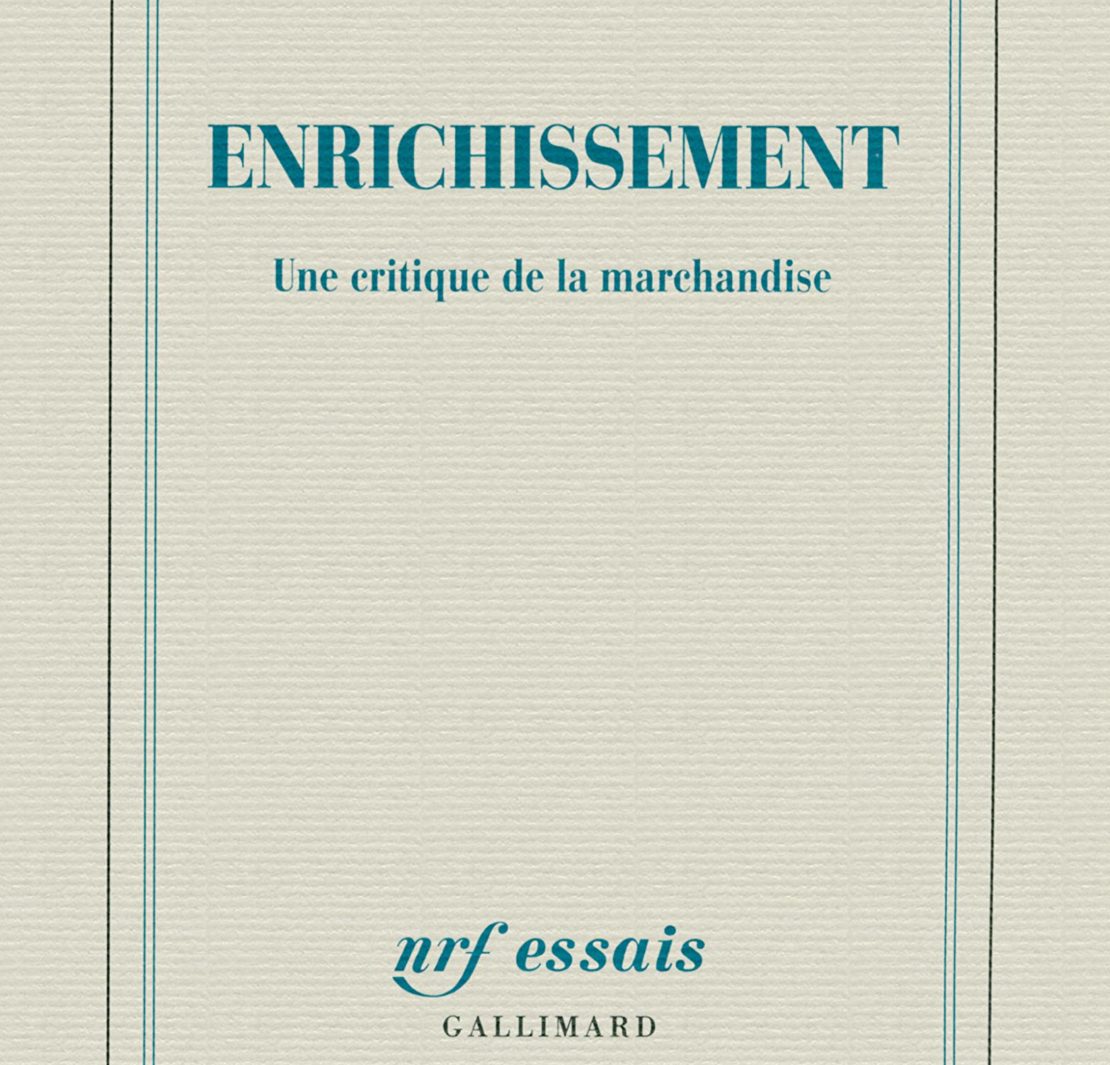Dans leur ouvrage, Enrichissement. Une critique de la marchandise (Paris, Gallimard, 2017, 663 p.), Luc Boltanski et Arnaud Esquerre analysent les transformations du capitalisme qui connaîtrait un déplacement de l’économie productive vers une économie de l’enrichissement qu’ils cherchent à caractériser. Une analyse brillante contribuant à modifier les perceptions du monde social, mais qui soulève des interrogations.
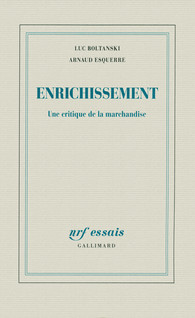 Luc Boltanski et Arnaud Esquerre proposent une analyse stimulante des transformations du capitalisme, une théorie ambitieuse des « structures de la marchandise », ainsi que des considérations de théorie sociologique relatives aux conditions de l’échange, qu’on peut ne pas partager, mais qui ne seront pas discutées ici. C’est en sociologues, prenant souvent appui sur les problématiques de leur sociologie, qu’ils entreprennent de décrypter les évolutions des économies contemporaines, en ignorant assez superbement les travaux de la plupart des économistes sur ces sujets.
Luc Boltanski et Arnaud Esquerre proposent une analyse stimulante des transformations du capitalisme, une théorie ambitieuse des « structures de la marchandise », ainsi que des considérations de théorie sociologique relatives aux conditions de l’échange, qu’on peut ne pas partager, mais qui ne seront pas discutées ici. C’est en sociologues, prenant souvent appui sur les problématiques de leur sociologie, qu’ils entreprennent de décrypter les évolutions des économies contemporaines, en ignorant assez superbement les travaux de la plupart des économistes sur ces sujets.
D’une économie productive à une économie de l’enrichissement
Selon eux, le capitalisme (industriel) s’est tourné vers de nouveaux domaines d’activité pour surmonter diverses contradictions : « chute du taux de retour sur le capital » (affirmé sans appuis empiriques) ; intensification des conflits entre travail et capital ; partage de la valeur ajoutée jugée trop favorable aux salariés. Il y aurait « déplacement d’une économie productive vers une économie de l’enrichissement » (p. 294), en association avec le développement de l’économie financière et numérique – et autres services –, qui n’est pas pris en compte dans l’ouvrage.
L’opposition entre une « économie productive » et une « économie de l’enrichissement » est quelque peu paradoxale dans la mesure où toutes deux, et pas seulement la seconde, sont fondées sur « l’enrichissement des choses » (p. 70). Ce qui est désigné comme économie de l’enrichissement repose en fait sur un type particulier d’enrichissement (p. 71), que l’ouvrage cherche d’ailleurs à caractériser.
L’économie de l’enrichissement est décrite comme une « nébuleuse » regroupant l’industrie du luxe (montres, bijoux, maroquinerie, parfums, vêtements griffés, automobiles, alimentation, vins et alcools haut de gamme, hôtellerie, haute gastronomie), le secteur de la mode, le tourisme (visites de villages restaurés, tourisme culturel, œnotourisme, écotourisme), l’art contemporain (art plastique, peinture, architecture) et les activités culturelles (musées, festivals, expositions, fêtes folkloriques).
Cette économie est développée par un ensemble hétérogène d’acteurs indépendants les uns des autres : milieux d’affaires, acteurs de la mode, « tendanceurs », designers, créateurs, artistes, professionnels de la culture, experts, journalistes, artisans d’art, historiens, romanciers, anthropologues …
Elle est structurée par diverses évolutions. D’abord, un processus de patrimonialisation qui « consiste en la mise en forme d’un objet, comme enraciné dans un espace (le terroir) où il serait depuis son origine, possédant ainsi une force mémorielle qu’il faudrait faire survivre » (p. 407). Des objets divers se trouvent ainsi enracinés dans le temps et dans l’espace (local ou national). Ils prennent de ce fait une valeur nouvelle et méritent attention respect et protection. Ce processus est à l’origine de la mise en valeur des « plus beaux villages », de la transformation de sites industriels en lieux culturels, de l’exploitation de châteaux familiaux, de l’activation d’héritages dormants (la châtaigne, les races bovines) ou plus ou moins inventés (la coutellerie de Laguiole), de la mise en place de « journées portes ouvertes » ou de musées d’ethnologie folklorique.
La culture mise au service d’une économie orientée en direction des riches
En second lieu, la culture, dont la conception a été élargie, est mise au service de l’économie. Du fait d’initiatives multiples, notamment politiques, la « culture » intègre en effet désormais les arts industriels et populaires, aussi bien que la mode, le design, la bande dessinée, la chanson et les arts de la rue. Le patrimoine industriel se trouve ainsi intégré au patrimoine historique. La mise au service de l’économie s’observe par exemple avec la muséification comme stratégie du développement touristique, ou avec l’artification qui rapproche certaines marques de luxe et des artistes reconnus. Tel dirigeant d’un grand groupe de l’industrie du luxe crée un espace d’exposition de sa collection personnelle d’art contemporain. Des artistes de renom sont sollicités pour concevoir les étiquettes de grands vins. Le monde de l’art et de la culture génère des profits importants et de nouvelles formes d’exploitation, avec la contribution involontaire de certains artistes et de « faiseurs d’histoire » – historiens, notamment de l’art et de la littérature, critiques, anthropologues, romanciers – qui produisent le passé et jouent ainsi un rôle considérable dans la mise en valeur des biens de l’économie de l’enrichissement. Ils sont secondés par de nombreux acteurs – conservateurs de musée, artistes et artisans d’art maîtrisant des savoir-faire traditionnels – en charge de la conservation du passé et des « traditions ».
Certains médias jouent leur partition dans ce concert d’initiatives dispersées, non orchestrées, mais convergentes. La publicité pour les biens de luxe est devenue indispensable à la survie de certaines entreprises de presse. Dans l’indistinction des contenus rédactionnels et de la publicité, elles publient des suppléments consacrés à la photographie, à « l’art de vivre », au tourisme, à la gastronomie, aux tendances et aux modes, financés par des publicités pour les marques du luxe.
C’est donc un milieu complexe et composite qui concourt à faire le lien entre les marques et la culture, c’est-à-dire à soutenir la culture avec l’argent des marques et à renforcer le pouvoir des marques en les faisant bénéficier du prestige de la culture (p. 353).
Luc Boltanski et Arnaud Esquerre soutiennent que cette économie est orientée en direction des riches. Ces derniers seraient intéressés non seulement par les profits esthétiques, hédonistes ou de distinction, mais aussi par les perspectives de plus-value des biens à forte marge proposés par les industries du luxe. Ce capitalisme enrichit ainsi collectivement les riches, c’est-à-dire non seulement les vendeurs, mais aussi les acheteurs (p. 498). Il favorise la reconstitution d’une classe patrimoniale protégée de la présence des pauvres (p. 453).
Une main-d’œuvre formée et abondante subissant les contraintes de l’auto-exploitation
Cette transformation du capitalisme a été également favorisée par l’augmentation du nombre des diplômés littéraires et des anciens élèves des écoles d’art. C’est grâce à leur capital culturel que les professionnels de la culture jouent un rôle central dans l’économie de l’enrichissement. L’expansion du système d’enseignement a créé une main-d’œuvre formée, abondante, dispersée, démunie d’organisation et rétive à la mobilisation, vivant ou survivant dans la crainte du chômage, prête à accepter les emplois temporaires, saisonniers, instables, mal rémunérés, générés par l’expansion du tourisme et des activités culturelles. Ces agents subissent les contraintes de l’auto-exploitation. Ils ont souvent plusieurs employeurs. Les frais de production sont fréquemment à leur charge. Certains travaillent chez eux, sans limitation du temps de travail, ni de distinction entre le travail et la vie à côté. Une partie de la chaine de valeur se trouve ainsi ignorée et n’est pas rémunérée. Ces acteurs s’adossent à une culture pour donner du sens aux biens de « l’économie de l’enrichissement”. Ils les inscrivent dans une perspective historique, culturelle, artistique, anthropologique, ethnologique ou géographique et les enrichissent par leurs reportages, analyses, commentaires, récits, défilés, expositions, catalogues ou installations. Plasticiens, cuisiniers, designers, coiffeurs, photographes, musiciens, concepteurs de vêtements, de bijoux, de parfums, ils vivent difficilement de leur statut de créateur. Leur réputation est le fragile capital symbolique qui les fait exister et qui leur semble souvent une rétribution suffisante dans l’attente de jours financièrement moins difficiles.
Une théorie originale de la marchandise
Luc Boltanski et Arnaud Esquerre articulent leur analyse des transformations du capitalisme à une théorie originale de la marchandise. Ils avancent l’hypothèse que l’économie de l’enrichissement s’accompagne d’une « diversification des structures » (apparition de nouvelles formes de biens marchands) et d’une « extension du cosmos » (extension du nombre des objets susceptibles de faire l’objet de transactions) de la marchandise. Dans le cours d’une marchandisation élargie, de nouveaux gisements de richesse sont créés par l’exploitation des différences et des déplacements qui s’instaurent entre plusieurs formes et états de la marchandise. Ainsi des biens standards ou démodés deviennent des objets de collection qui peuvent se transformer à leur tour en placements financiers.
Ils distinguent quatre formes. La forme standard est celle des objets industriels courants, destinés à l’usage. Leur valeur est justifiée par les coûts de fabrication, la qualité, la durabilité et la technicité. Leur prix diminue avec le temps et ils finissent en déchets voués à la destruction ou au recyclage.
La forme collection résulte d’œuvres originales (par exemple des peintures d’artistes contemporains), mais aussi de la transformation d’un objet marchand, éventuellement trivial (boites d’allumettes), en chose dont la quête sans finalité pratique mérite des sacrifices. Il faut par exemple du temps et de l’argent pour les réunir. Cette extension de la marchandisation vers des choses déjà là qui n’ont pas à être produites suppose la mise en place d’argumentaires très différents de ceux sur lesquels repose le faire-valoir de la production standard. L’objet est enrichi par des présentations narratives d’artistes, d’historiens ou d’anthropologues. Sa valeur est attestée par des dispositifs d’évaluation institutionnalisés au sein desquels interagissent des agents d’État, conservateurs, historiens et critiques, associés à des musées et à des universités, relativement indifférents aux considérations économiques, et différents de ceux qui prennent part aux transactions. Ainsi, la cote d’un peintre dépend des travaux érudits qui lui sont consacrés par des experts et des universitaires, des comptes rendus des journalistes, des expositions organisées par des conservateurs ou des achats par des musées publics. Ces acteurs qui contribuent à la mise en valeur interviennent du fait de leur compétence intellectuelle et ils ne sont généralement pas économiquement intéressés aux transactions et spéculations qu’ils contribuent pourtant involontairement à stimuler.
La forme tendance est le produit d’une économie fondée sur la mise en valeur de la dernière différence (ce qui est à la dernière mode). Est « tendance » un acteur qui est porteur des signes de la tendance, mais sont « tendance » les signes portés par les acteurs tendance qui sont des personnes dont la proximité enrichit la chose proposée. Cette production repose sur l’exploitation marchande des hiérarchies sociales qui engendrent des manques. Ainsi, les personnes soucieuses de culture aiment se rendre sur les lieux fréquentés dans un passé plus ou moins lointain par les artistes ou les intellectuels. De même, les personnes de rang social intermédiaire cherchent à copier le style de vie et les consommations des gens fortunés pour se distinguer de ceux qui occupent des positions inférieures dans l’espace social. Ces derniers les copieront à leur tour mettant fin au cycle de diffusion-vulgarisation.
La forme actif (par exemple un placement financier dans une œuvre d’art ou un grand vin) résulte d’un investissement et d’un pari sur la durabilité, la liquidité, la transportabilité, les garanties sur l’avenir et le prix futur possible d’un bien. Elle s’articule de manière privilégiée avec la forme collection dont les objets deviennent source de plus-value (exemple d’une collection d’œuvres d’art qui devient une source d’enrichissement financier pour le collectionneur).
Un ouvrage modifiant les perceptions du monde social, mais soulevant des interrogations
La capacité à modifier les perceptions du monde social est un bon test de la valeur d’un travail sociologique. De ce point de vue, on observe que la restauration participative d’un château, l’édification d’un fac-similé d’une grotte préhistorique, l’annonce de découvertes archéologiques, l’ouverture d’un musée dans une ville ou l’obtention ou la perte du label Les plus beaux villages de France prennent une signification nouvelle après la lecture de l’ouvrage. Demeurent toutefois plusieurs interrogations.
On peut tout d’abord questionner le poids morphologique et économique de cette économie. Les auteurs ne fournissent pas d’informations sur ce point en arguant de l’absence de cadre comptable unifié. Mais on peut se demander si le ou les secteurs économiques analysés dans l’ouvrage peuvent significativement aider à surmonter les contradictions du capitalisme, à commencer par le chômage de masse, comme les auteurs le suggèrent. On s’interroge également sur la réalité sociale du regroupement proposé dans l’ouvrage. Les auteurs soulignent eux-mêmes l’absence de construction sociale de leur conglomérat (absence de dispositifs catégoriels ou de cadre comptable commun; secteurs, activités, statuts et professions dispersés p. 322). Ils soutiennent même que les institutions s’emploient à maintenir séparées, sinon ces activités, au moins les représentations qu’elles en donnent (p. 323).
Il y a là un problème de théorie sociologique soulevé de longue date. Le sociologue peut-il décréter l’existence de réalités sociales en l’absence d’objectivations instituées dans la réalité et, a fortiori ici, contre l’organisation même du monde social. Au-delà de la querelle théorique, on peut se demander si la collection de voitures anciennes, la fréquentation touristique des villages « traditionnels », des sites culturels, des festivals de jazz, de la bande dessinée ou du cinéma, la visite ou la location des salles de châteaux, l’achat d’un couteau, même de collection, ou d’un jean délavé, relèvent de la même économie que la consommation de biens de luxe comme les vêtements des grands couturiers, les séjours dans les palaces internationaux, les yachts amarrés dans les ports de la Côte d’Azur ou les collections de tableaux des maîtres de l’art contemporain.
Ainsi, l’économie de l’enrichissement est décrite comme une réorientation en direction des riches. C’est une évidence pour l’industrie du luxe, mais cela semble plus discutable si la proposition est étendue à l’ensemble des activités regroupées par l’ouvrage. Les activités culturelles mobilisent par exemple des catégories sociales bien au-delà des plus « riches ». N’est-ce pas plutôt du côté de l’augmentation du nombre des individus porteurs de capital culturel, notamment des professionnels de la culture en recherche de publics de vacanciers et de retraités cultivés ou soucieux de le devenir, qu’il faut chercher des éléments d’explication de la vitalité de ces secteurs ? De ce point de vue, on peut douter que le principe unificateur de l’économie de l’enrichissement soit, ou soit seulement, « l’ancrage dans le passé » et « l’exploitation de la tradition » (p. 103). Cette forme de mise en valeur est absente ou de portée secondaire pour une partie des secteurs analysés dans l’ouvrage, à commencer par certaines activités de l’industrie du luxe ou de la mode. On peut en revanche se demander si l’incorporation de capital culturel dans beaucoup des biens pris en compte dans l’ouvrage ne serait pas un principe commun plus pertinent. L’économie de l’enrichissement brillamment analysée par les deux sociologues serait alors, pour l’essentiel, une économie de l’enrichissement culturel.