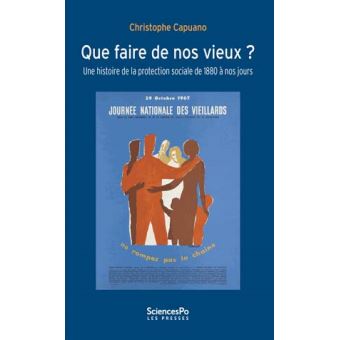Présentée comme une problématique contemporaine, la question de la perte d’autonomie est en réalité l’objet d’intenses débats dès la IIIe République. Du choix de recourir à l’assistance aux échecs répétés de l’instauration d’un nouveau « risque » et/ou une nouvelle branche de la sécurité sociale, les réponses apportées n’ont pas été, et ne sont pas, à la hauteur des besoins. Christophe Capuano revient sur cette histoire et sur les raisons de ces échecs. Il nous invite à faire le choix de société de la solidarité publique assurantielle pour construire une réponse progressiste au « risque » de la dépendance.
La perte d’autonomie des personnes âgées et sa prise en charge sont aujourd’hui très présentes dans l’actualité pour annoncer une hypothétique explosion des coûts liée à la dépendance, pour exprimer les souffrances des aidants professionnels ou familiaux ou bien encore pour discuter la création d’un 5e risque de Sécurité sociale.
La perte d’autonomie: une problématique ancienne
Présentée comme une problématique contemporaine, la question est en réalité bien plus ancienne. En 1900, en effet, les incapacités à effectuer certaines activités apparaissent en moyenne vers 60 ans, en raison d’une couverture médicale incomplète de la société et de conditions de travail pénibles liées à la seconde industrialisation ; or, à cette date, 12,7 % de la population française a atteint cet âge. Les années 1880 jusqu’au début du vingtième siècle constituent donc une période d’intenses échanges d’idées et de débats pour trouver une solution à l’« invalidité » des gens âgés, incapables de travailler pour gagner leur vie.
Des options mutualistes et assurantielles, publiques ou privées, sont discutées dès cette époque, mais c’est finalement la voie assistantielle qui est retenue par les parlementaires républicains pour des raisons budgétaires. Cela prend la forme de la loi d’assistance du 14 juillet 1905 destinée aux « vieillards » de plus de 70 ans, aux « infirmes » et « incurables » sans ressource. Le dispositif adopté s’adresse seulement aux populations pauvres et il est fondé sur le principe de subsidiarité : il n’intervient qu’à la condition d’une absence de descendants ou si ceux-ci ne peuvent assurer leur obligation alimentaire envers leurs ascendants (article 205 du Code civil). Ce principe entraîne une forte mobilisation de familles elles-mêmes peu aisées. Par ailleurs, les sommes versées sont considérées comme des avances récupérables sur une éventuelle succession après décès. Tout cela doit garantir une limitation des dépenses publiques. D’autres raisons plus secondaires expliquent aussi ce choix de l’assistance comme le patriotisme en contexte de tensions internationales – se démarquer du système assurantiel bismarckien – et l’inscription dans la continuité de l’héritage républicain de la Révolution française.
Les insuffisances de l’assistance
Cette assistance prend surtout la forme d’un versement de prestations en espèces, le placement en hospices étant censé être réservé aux populations en perte d’autonomie. L’objectif est de détourner un maximum d’assistés des établissements dont les places gratuites sont à la fois onéreuses et saturées. Le montant insuffisant des prestations versées (dix francs mensuels en moyenne en 1910) permet cependant difficilement de subsister et empêche le recul du nombre d’entrées en hospices pour des raisons sociales ; pire, la dégradation de la conjoncture économique durant l’entre-deux-guerres accentue le phénomène.
Les pouvoirs publics décident par conséquent d’adopter en 1930 une nouvelle disposition pour les assistés qui sont en perte d’autonomie, mais souhaitent rester à leur domicile : la majoration spéciale d’aide à la tierce personne. Il s’agit, de fait, d’une première reconnaissance de la dépendance dans ce besoin de tierce personne pour vivre au quotidien. L’objectif est de retenir, pour des raisons financières, ces populations, le plus longtemps possible hors des établissements, au sein desquels n’existe d’ailleurs aucun dispositif de soin ou d’accompagnement spécifique. La mesure, qui ne fait pas de distinction entre les âges, cible par conséquent les « grands infirmes » auxquels sont assimilés les gens âgés en perte d’autonomie. Elle est versée en espèces avec un montant calculé en journées d’hospices et doit permettre de rémunérer une éventuelle tierce personne.
Dans les faits, le dispositif montre vite ses limites : en l’absence de services à la personne et de politiques de l’habitat, la mesure est insuffisante pour assurer le maintien à domicile. L’argent versé dont l’usage n’est pas contrôlé sert de complément de ressources ou à compenser la perte de salaire d’un aidant familial. Avec la crise des années 1930, les familles qui soutiennent leurs proches âgés se trouvent elles-mêmes en grande difficulté et le placement en hospice devient l’ultime solution. Cette dernière se révèle dramatique sous l’Occupation lorsque ces établissements ne peuvent assurer un approvisionnement suffisant à leurs pensionnaires, avec une forte hausse de la mortalité.
La politique du handicap: de l’assimilation à l’exclusion des personnes âgées dépendantes
De 1930 à 1997, le principe de la non-discrimination selon l’âge des bénéficiaires est retenu. Les prestations sont ouvertes, selon des critères de ressources, à toute personne ayant un taux d’incapacité de 80 %. Les gens âgés avec moyennes ou fortes incapacités sont alors assimilés à la catégorie des « grands infirmes » puis à celle des « handicapés » à partir de la loi d’orientation sur le handicap de juin 1975. Si l’assistance prend le nom d’aide sociale à partir de 1953, la forme du dispositif, toujours versé en espèces, évolue, elle aussi, au cours du temps : en 1952, son montant est relevé pour atteindre 80 % de celui de l’assurance invalidité. En 1975, dans le cadre de la politique du handicap qui accorde de nouveaux droits fondés sur la solidarité nationale, la majoration spéciale se transforme en une allocation compensatrice tierce personne (ACTP). Son versement n’entraîne plus la mise en jeu de l’obligation alimentaire ni la récupération sur succession après décès, ce qui en fait une prestation attractive.
Officiellement affecté, son usage est, dans les faits, assez libre : rémunération possible d’une tierce-personne et à partir de 1982, d’une auxiliaire de vie, complément de ressources, appareillage du logement. À l’inverse, la politique de la vieillesse se borne depuis 1962 à fournir un service en nature de 30 heures d’aide-ménagères par mois, dans le cadre de l’aide sociale et entraîne une récupération sur héritage. Les bénéficiaires du dispositif de l’ACTP âgés de 60 ans au moins augmentent par conséquent très nettement de 1984 à 1994 (de 86 000 à 188 000) tandis que celui des bénéficiaires de l’aide-ménagère dans le cadre de l’aide sociale légale recule (144 000 à 92 000).
Les choses changent en 1997 lorsque les gens âgés de plus de 60 ans sont exclus de la politique du handicap pour être cloisonnés dans une catégorie particulière « les personnes âgées dépendantes ». Cette segmentation en fonction de l’âge qui rompt avec une pratique de plusieurs décennies s’explique une nouvelle fois par des raisons financières : les conseils généraux qui sont devenus les principaux financeurs du dispositif à partir des lois de décentralisation de 1982 et 1983 voient l’augmentation du nombre de bénéficiaires âgés de l’ACTP et des coûts associés comme une prétendue dérive de la loi de 1975. L’argument est historiquement faux, mais il est relayé par le Sénat et la Cour des comptes. Il aboutit à l’adoption de la loi du 24 janvier 1997 sur la prestation spécifique dépendance (PSD) pour laquelle le principe de récupération sur succession après décès est rétabli, ce qui impacte les personnes âgées et leurs familles. Ce principe est supprimé avec l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) en 2001, mais la segmentation avec les handicapés adultes n’est pas remise en cause. Par ailleurs, les gens âgés doivent désormais contribuer financièrement à leur plan d’aide et les familles sont mises à contribution notamment en cas de placement en EHPAD. Ces établissements souffrent pourtant eux-mêmes d’un manque de personnel en nombre suffisant comme l’a tragiquement révélé la canicule de l’été 2003 : 19 % des 14 802 décès ont eu lieu en EHPAD et ce pourcentage atteint 24 % pour les plus de 75 ans selon des études de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et de l’Institut national de veille sanitaire (Invs)[1]. Au total, 63 % des personnes sont mortes en institution, souvent les plus fragiles.
La couverture du «risque» dépendance: un choix de société non adopté à ce jour
Malgré la progressive prise de conscience par les pouvoirs publics d’un « risque » dépendance susceptible de toucher une part importante de la population, sa prise en charge continue de relever de l’aide sociale alors qu’un nombre croissant de pays se tourne, pour le couvrir, vers un système assurantiel. Comment l’expliquer ? Plusieurs tentatives ont pourtant eu lieu pour en faire un nouveau risque et/ou une nouvelle branche de la Sécurité sociale en se fondant sur l’article L. 111-2 du Code de la Sécurité sociale disposant que « des lois pourront étendre le champ d’application de l’organisation de Sécurité sociale à des catégories nouvelles de bénéficiaires et à des risques ou prestations non prévus par le présent Code ». La couverture de la perte d’autonomie aurait donc pu conduire à une extension des compétences de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) et/ou de la Caisse nationale des travailleurs salariés (CNAMTS). En 1994 par exemple, Simone Veil, alors ministre de la Santé, a souhaité faire sortir ces dernières de l’aide sociale tout en maîtrisant les coûts. Elle était séduite par le choix allemand d’assurance publique obligatoire – la dépendance est assimilée aux soins de longue durée – qui permettrait de couvrir les classes moyennes et serait éventuellement gérée par l’assurance vieillesse. Elle s’est pourtant heurtée à l’hostilité de la Direction de la Sécurité sociale cherchant à limiter le déficit du régime général, mais aussi au refus du gouvernement d’augmenter les prélèvements sociaux en période pré-électorale.
Si la conjoncture défavorable, dans un contexte de « crise » de l’État-providence, a pu jouer, il faut y voir aussi une tendance de fond expliquant les échecs à répétition de ce projet, véritable serpent de mer des années 1990-2000. Cela tient surtout à la frilosité affichée des pouvoirs publics face une hausse démographique de la dépendance qui entraînerait une explosion des coûts ; or tant les études en économie de la santé qu’en épidémiologie montrent que ces prévisions catastrophistes sont surévaluées : lorsque les incapacités paraissent, elles le font de plus en plus tardivement, après 75 ans, même si les inégalités de classe sont très prégnantes[2]. La solution se trouverait dans des assurances privées que chacun devrait contracter. Sans développer l’iniquité qu’un tel système peut entraîner, il faut cependant rappeler que seule une solidarité publique assurantielle permettrait de couvrir le « risque » dépendance quel que soit l’âge et à hauteur des besoins de chacun. Pour les situations de dépendance lourde, elle pourrait prendre la forme d’une assurance publique avec une nouvelle branche de la Sécurité sociale ou d’une assurance mutualisée et obligatoire, encadrée par les pouvoirs publics. Pour la dépendance légère, le financement public se ferait sous conditions de ressources[3]. Il s’agit d’un choix de société.
Pour aller plus loin :
- Patrice Bourdelais, L’âge de la vieillesse, Paris, Odile Jacob, 1993, 448 p.
- Axelle Brodiez, Combattre la pauvreté. Vulnérabilités sociales et sanitaires de 1880 à nos jours, Paris, éditions du CNRS, 2013, 328 p.
- Christophe Capuano, Que faire de nos vieux ? Une histoire de la protection sociale de 1880 à nos jours, Paris, Presses de Sciences po, mai 2018, 352 p.
- Christophe Capuano, Florence Weber (dir.), « Dossier handicap et dépendance : perspectives historiennes », Revue d’histoire de la protection sociale, n°8, 2015 [En ligne].
- Elise Feller, Une histoire de la vieillesse, 1900-1960.Du vieillard au retraité, Paris, Seli arslan, 2005.
Christophe Capuano a présenté son livre dans l’émission de Jean Lebrun, La Marche de l’Histoire, le lundi 21 mai 2018.
Que faire de nos vieux ? Une histoire de la protection sociale de 1880 à nos jours (Presses de Sciences po, mai 2018).