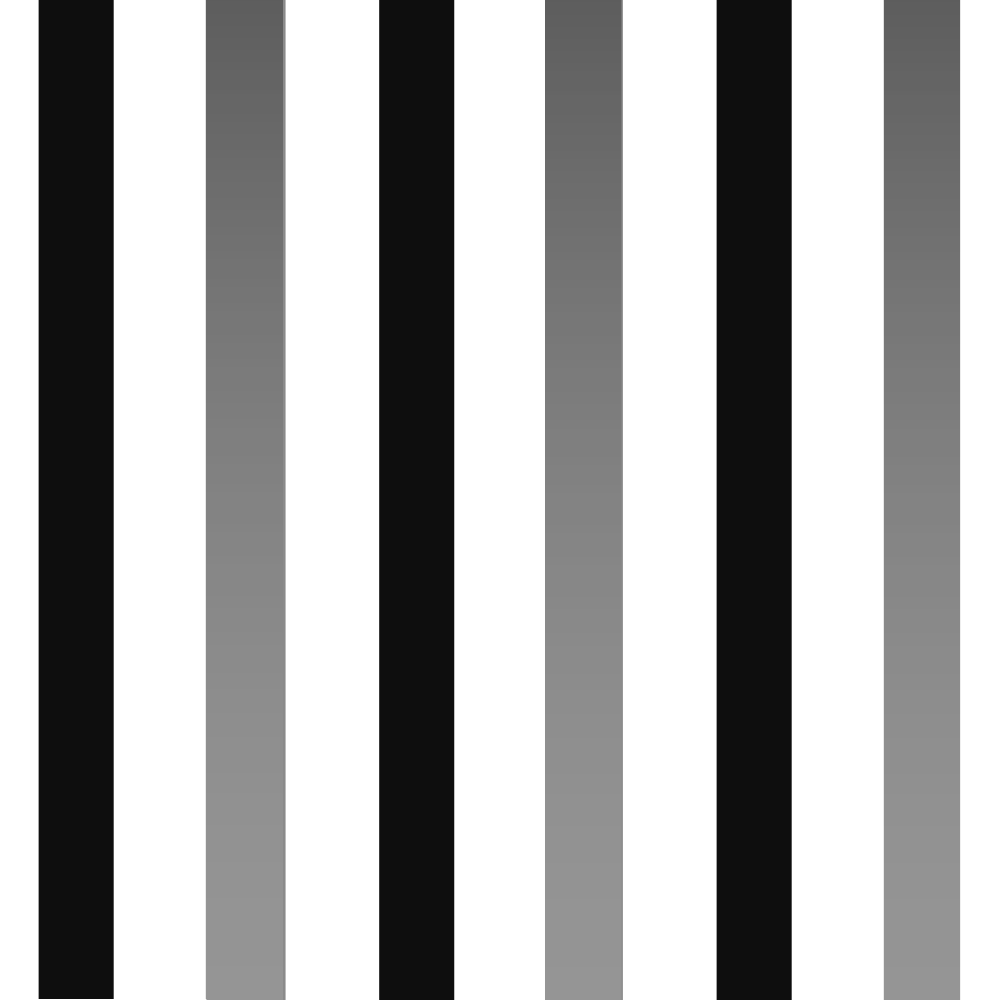Jean Quétier
Agrégé de philosophie.
Le travail n’est pas que souffrance et aliénation, il est urgent d’en faire, selon les mots de Marx, le « premier besoin vital ». Expression de la créativité et de l’intelligence, activité de façonnement du monde, vecteur de socialisation, tous ces aspects font du travail l’une des facettes essentielles de notre humanité. Il est urgent de le libérer des entraves que le capitalisme lui impose.
Dans la Critique du programme de Gotha, Marx affirmait que le communisme allait permettre au travail de devenir « le premier besoin vital »[1]. La formule peut surprendre sous la plume d’un théoricien de l’aliénation et de l’exploitation. Elle peut presque paraître choquante quand on songe à la souffrance et au mal-être dont est le travail est synonyme sous le mode de production capitaliste. Pourtant, le travail n’est pas condamné à n’être que l’une des facettes de la domination, il est aussi un vecteur décisif d’émancipation, dont les potentialités sont aujourd’hui le plus souvent entravées. Contrairement à ce que suggère le récit biblique,[2] qui le présente comme une malédiction imposée à l’humanité en punition de ses péchés, le travail ne doit pas être compris comme le contraire de la liberté.
Lieu de créativité humaine
Le travail est d’abord le lieu où se manifeste la créativité humaine sous toutes ses formes. L’être humain transforme la nature, il façonne le monde pour en faire un environnement propice à la satisfaction de besoins multiples. C’est d’abord par la production que l’humanité dépasse ce qu’il y a de purement animal en elle. Le travail compris comme habileté technique et comme inventivité est ainsi au cœur d’une anthropologie progressiste qui remonte au moins au mythe grec de Prométhée. Soucieux de pallier l’étourderie de son frère Épiméthée, qui avait été chargé par les dieux de conférer aux êtres vivants diverses qualités (vitesse, poils touffus, peaux épaisses…) et qui, dans la précipitation, avait oublié l’espèce humaine, Prométhée, « ne sachant quel moyen de salut trouver pour l’homme, se décide à dérober l’habileté artiste d’Héphaïstos et d’Athéna et, en même temps, le feu […], puis, cela fait, il en fit présent à l’homme. C’est ainsi que l’homme fut mis en possession des arts utiles à la vie »[3]. L’être humain n’est pas pourvu de qualités figées, données une fois pour toutes, il est doté d’une intelligence qui ouvre la voie à un progrès de toute l’espèce. Dans le même sens, le rationalisme moderne verra ainsi dans le travail le moyen de donner corps aux avancées des sciences et des techniques et de rendre l’existence humaine plus commode. Une ambition souvent résumée par la formule de Descartes, nous invitant à « nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature »[4].
Rôle formateur
Mais si le travail est émancipateur, ce n’est pas seulement parce que la société bénéficie, par son intermédiaire, des fruits de la production. Pour celui qui l’accomplit, le processus de travail joue également un véritable rôle formateur en permettant à l’être humain de se retrouver lui-même dans le monde qui l’entoure. Par le travail, l’être humain ne se contente pas de consommer les objets qu’il trouve autour de lui, il leur imprime sa marque et leur donne une forme nouvelle. Le potier qui façonne l’argile pour en faire une assiette ne voit pas en elle un objet purement extérieur et indifférent, contrairement à celui qui ne fait que manger dedans, tout simplement parce qu’il y a mis du sien. Hegel voit ainsi dans le travail l’opération qui permet à la conscience de se découvrir elle-même dans un autre qu’elle[5]. Ou encore, pour reprendre une formule de jeunesse de Marx, les produits du travail humain devraient jouer le rôle de « miroirs »[6] reflétant notre essence – une reconnaissance précisément entravée par la manière dont le capitalisme organise le travail.
Mobilisation de l’intelligence
Le travail est une activité qui mobilise l’intelligence, il n’est jamais pure application de normes prescrites. Même celui qu’on présente comme un simple exécutant est toujours amené à résoudre des problèmes, à adapter les consignes à la situation qui se présente à lui dans ce qu’elle a d’imprévu. Pour le dire dans les termes de l’ergonome Alain Wisner, il existe un écart irréductible entre « travail prescrit » et « travail réel »[7]. Il est donc nécessaire de prendre le contre-pied du modèle tayloriste, celui d’une organisation du travail fondée sur le principe du « one best way », de l’unique bonne façon de produire dictée d’en haut aux opérateurs par le bureau des méthodes. La frontière qui sépare exécutants et décisionnaires n’est jamais aussi nette que ces derniers voudraient le faire croire, elle est en grande partie instituée artificiellement pour empêcher les travailleurs de prendre conscience du savoir qu’ils possèdent sur leur propre travail. C’est ce qu’a cherché à montrer Ivar Oddone dans son enquête menée dans les années 1970 auprès des ouvriers de la Fiat de Turin[8]. Ce psychologue du travail et son équipe ont mis en place la méthode dite de « l’instruction au sosie », consistant à demander aux travailleurs de prescrire à des sosies imaginaires ce qu’ils devraient faire s’ils devaient se faire passer pour eux à leur poste de travail. Elle permet de mettre en évidence les solutions collectives mises en œuvre par les travailleurs, notamment dans le cadre syndical, pour faire un meilleur travail que celui dicté par le bureau des méthodes. Ce savoir ouvrier constitue un véritable « plan », un ensemble de prescriptions permettant aux travailleurs de développer leur conscience de classe. Le travail, malgré toutes les contraintes qui pèsent sur lui, n’est donc jamais pure passivité. Il est toujours, comme le dit Yves Schwartz[9], le lieu d’un arbitrage entre usage de soi par soi et usage de soi par les autres, d’un débat de normes. Le travail est une activité de « renormalisation », de transformation des normes antécédentes, de bricolage de solutions innovantes. L’étude menée auprès des ouvrières de l’usine de téléviseurs Thomson à Angers dans les années 1970 a ainsi pu montrer que même le travail à la chaîne le plus répétitif ne se déroulait jamais exactement de la même manière, que les gestes des opératrices ne suivaient pas à la lettre les prescriptions du bureau des méthodes et qu’elles parvenaient à élaborer des solutions pour gagner du temps ou se gêner le moins possible les unes les autres.[10]
Vecteur de socialisation
Le travail est aussi, par excellence, un vecteur de socialisation, une activité qui fait sortir l’individu de l’intimité de la vie privée pour le faire accéder à la sphère publique. Comme le montre par exemple Christophe Dejours, le travail est un lieu central dans la formation de l’identité individuelle et collective, laquelle ne saurait se constituer sans la médiation d’une activité socialement valorisée, extérieure à la sphère domestique.[11] Le travail crée du lien social, il permet la « coopération des égoïsmes dans la concorde »[12], il conduit à agir en commun avec des individus dont nous ne sommes pas proches, avec lesquels parfois on ne s’entend pas. Et l’action collective rendue possible par le travail est irréductible à la simple juxtaposition d’actions individuelles : le travail est le lieu où se réalise une œuvre commune, où s’expriment les « puissances de la coopération »[13], pour reprendre une formule de Franck Fischbach. Cette dimension coopérative est évidemment prise pour cible par les logiques concurrentielles mises en place par le capital, qui cherche à défaire la solidarité que le travail crée entre les salariés.
L’importance du sentiment du travail bien fait
On peut en tirer la conclusion suivante : si de nombreux salariés souffrent dans leur travail, c’est notamment parce que les conditions ne sont pas réunies pour qu’ils puissent réaliser un travail bien fait, un travail dont ils puissent être fiers. Une situation que l’on peut désigner, avec Yves Clot, par la notion d’ « activité empêchée »[14]. L’une des fractures essentielles qui traversent le monde du travail aujourd’hui, c’est le conflit sur la qualité du travail, sur la bonne manière d’exercer un métier. À cet égard, comment ne pas voir que les exigences du capital constituent un obstacle majeur ? Les travailleurs qu’on force à mal produire ne peuvent plus se reconnaître dans ce qu’ils font. C’est le cas des salariés de l’usine Lu d’Evry dont parle Yves Clot dans Le Travail à cœur : dans les années qui ont précédé la fermeture du site, les odeurs avaient changé, le beurre qui servait à fabriquer les biscuits avait été remplacé par de l’oléine de beurre et les salariés avaient pris conscience de réaliser des produits de mauvaise qualité. C’est donc le travail, au moins autant que le travailleur, qu’il est urgent de soigner et de sortir des ornières du capital. Les propositions en ce sens ne manquent pas. L’émancipation n’est pas synonyme d’une « fin du travail » ou d’une libération à l’égard de la production et des efforts qu’elle nécessite – comme le disait déjà Marx, le fait de surmonter des obstacles peut « être en soi une activation de la liberté »[15]. C’est bien plutôt le marché de l’emploi qui est pathogène et qui empêche les salariés de prendre enfin du plaisir au travail[16].
Mots clés
Créativité, intelligence, émancipation, socialisation, lien social, reconnaissance, qualité, fierté, plaisir, formateur, progrès, sciences et techniques, solutions collectives, renormalisation, solutions innovantes, identité individuelle, identité collective, œuvre commune, coopération, Mythe de Prométhée, Descartes, Marx, Platon, Hegel, Alain Wisner, Ivar Oddone, Yves Schwartz, Franck Fischbach, Christophe Dejours, Louis Durrive
[1] Karl Marx, Critique du programme de Gotha, Les éditions sociales, GEME, Paris, 2008, p. 60.
[2] Genèse 3:17-19.
[3] Platon, Protagoras, 321c-d, Les Belles lettres, Paris, 2002, p. 39.
[4] Descartes, Discours de la méthode, Sixième Partie, GF, Paris, 2000, p. 99.
[5] Hegel, Phénoménologie de l’esprit, IV, A, GF, Paris, 2012.
[6] Karl Marx, « Notes de lecture », in Œuvres, II, Gallimard-Pléiade, Paris, p. 33.
[7] Alain Wisner, Réflexions sur l’ergonomie, Octares, Toulouse, 1995.
[8] Ivar Oddone, Alessandra Re, Gianni Briante, Redécouvrir l’expérience du travail, Les éditions sociales, Paris, 2015.
[9] Yves Schwartz, Expérience et connaissance du travail, Les éditions sociales, Paris, 2012.
[10] Yves Schwartz, Louis Durrive (dir.), Travail et ergologie, Octares, Toulouse, 2003, p. 21 sqq.
[11] Christophe Dejours, « Entre souffrance et réappropriation, le sens du travail », Politis, n°7, 1994.
[12] Christophe Dejours, Travail vivant, Tome 2, Payot, Paris, 2009, p. 98.
[13] Franck Fischbach, Le Sens du social, Lux, Montréal, 2015.
[14] Yves Clot, Le travail à cœur, La Découverte, Paris, 2010.
[15] Karl Marx, Manuscrits de 1857-1858 – Grundrisse, Tome II, Éditions sociales, Paris, 1980, p. 101.
[16] Bernard Friot, Émanciper le travail, La Dispute, Paris, 2014.