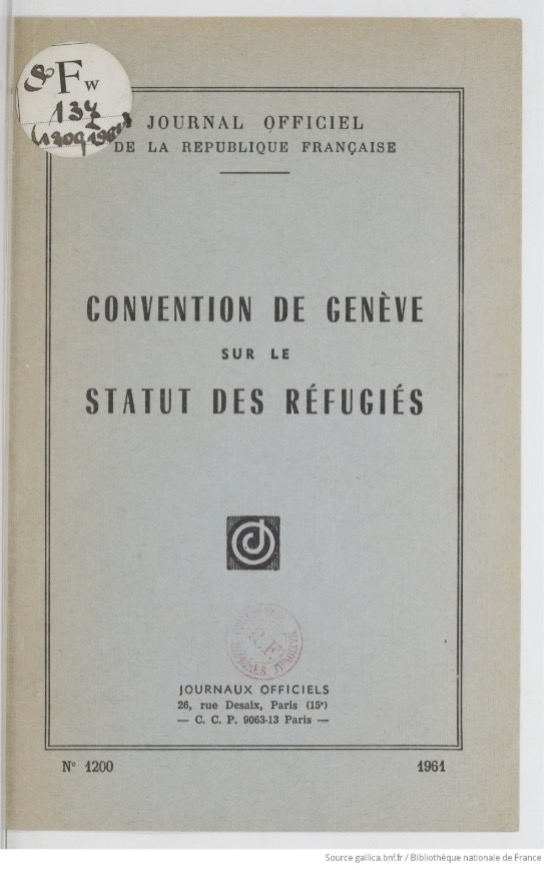Billet du 15 mai 2025
Dans mon billet du 13 mars 2025, je m’interrogeais sur les différentes façons de désigner les personnes qui migrent. Dans ce champ sémantique et social de la langue française, on trouve de nombreuses expressions linguistiques qui renvoient à différents statuts et à différentes définitions. Revenons sur certaines d’entre elles.
Réfugié
La caractérisation de « réfugié » est définie et encadrée juridiquement par la Convention de Genève du 28 juillet 1951, « La Convention internationale relative au statut des réfugiés », signée aujourd’hui par 145 États. En 46 articles, elle définit les droits et obligations des personnes et des États à leur endroit.
Cette Convention faisait suite à une première reconnaissance d’un statut de réfugié, au sortir de la Première Guerre mondiale. Ce fut la création d’un passeport, le passeport Nansen en 1921, qui attestait de l’identité de réfugié apatride.

On soulignera que l’expression « réfugié climatique » de plus en plus employée dans les media et par les politiques depuis des années de dérèglement climatique ne correspond en fait à aucun statut juridique ; la Convention de Genève n’ayant pas prévu en 1951 une telle cause aux déplacements massifs de populations. Seuls des accords de gré à gré entre États existent, comme celui passé entre l’Australie et les îles Tuvalu menacées de submersion.
Sans-papiers
À la différence de « réfugié », l’expression « sans-papiers » n’est pas une catégorie de nature juridique, elle n’est pas encadrée par le droit, qu’il soit international ou national. Ce n’est pas non plus une catégorie administrative, contrairement à « clandestin » ou « illégal ».
C’est une auto-désignation fabriquée par les personnes immigrées elles-mêmes, au fil des différentes réformes du droit des étrangers. Par sa connotation négative, cette expression renvoie à l’expérience quotidienne de vivre et de travailler sans papiers officiels (titre de séjour, contrat de travail) ; c’est-à-dire d’être exposé en permanence au risque et à la peur du contrôle de police, de l’arrestation, de l’expulsion et de l’OQTF (Obligation de quitter le territoire français).
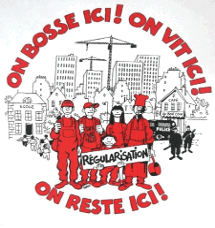
Selon le Musée de l’immigration, l’usage du terme « sans-papiers » se généralise à partir des années 1970, en particulier lors de la mobilisation contre les circulaires Marcellin-Fontanet (1972-1973) qui lient contrat de travail et titre de séjour (Mustapha Harzoune, 2022).
À l’instar de l’expression « sans-papiers » en français, les créations collectives de mots pour se désigner soi-même, pour désigner la situation migratoire ou pour rendre compte du voyage se rencontrent aussi dans les langues des migrants eux-mêmes. Elles y sont nombreuses ; examinons en quelques-unes afin de comprendre à quoi elles réfèrent.
Harraga, le brûleur
En arabe marocain, le « harraga » renvoie au champ sémantique de l’illégalité. Le « harraga » c’est celui qui commet des infractions, par exemple, traverser illégalement les frontières. Le mot « harraga » venant du verbe « brûler », celui qui traverse en se mettant en danger, est désigné en arabe marocain comme un « brûleur de frontière ».
Cette création endogène désigne, non pas l’arrivée dans un pays, comme on va le voir en arabe soudanais, mais le parcours migratoire qui précède celle-ci. L’accent y est mis sur le danger du voyage, avec des formulations imagées puissantes comme « le brûleur de frontières ».
Sarokh, la fusée
En arabe soudanais, « sarokh » a pour sens premier « la fusée ». Dans un usage populaire de cette langue, il désigne par une forme de métaphore une personne particulière : le nouvel arrivant qui débarque dans un pays qu’il ne connait pas, dont il n’a pas encore l’expérience, souvent l’Allemagne ou la France.
Est « sarokh » celui qui a traversé une frontière, souvent de façon illégale et qui, à la manière d’une fusée, atterrit dans un pays étranger ; ce que montrent ces extraits d’entretiens auprès de migrants en France (extraits de MIGRalect, site qui rassemble les parlers de la migration).
«Lui c’est un sarokh, il vient d’arriver en France» (en arabe soudanais) (campements parisiens, 2018).
«Lui est sarokh, c’est un bébé» (en arabe soudanais) (Lieu de vie, Calais, mai 2022)
Cette désignation métaphorique du migrant insiste sur l’arrivée dans un pays inconnu, sur cette toute première expérience de l’étranger. Dans un vocabulaire de type administratif, on parlerait en français de « primo-arrivant ».
Makina, la machine
En arabe soudanais, et par opposition à celui qui vient d’arriver, « makina » désigne l’immigré qui est installé depuis un certain temps, qui est expérimenté dans l’exil, qui peut prodiguer des conseils au sarokh. Par extension, le terme évoque les personnes expérimentées, y compris bénévoles et associatifs qui connaissent bien la situation et le terrain, qui savent tout.
La différence entre « sarokh » et « makina » peut évoluer dans le temps : ainsi à Calais, des exilés (sarokh) ayant séjourné plus de 6 mois deviennent des « makina ».
Kawman, celui qui a réussi
En wolof (Sénégal, Gambie, Mauritanie), le mot « kaywan » est formé du wolof « kaw » qui signifie le haut du globe, et de l’anglais « man ». Ce mot composé désigne celui qui a réussi son parcours migratoire en Europe et qui revient au pays auréolé de succès, y compris financier, et de gloire.
Cette désignation vise donc, non pas le voyage du harrara, l’arrivée du sarokh ou du makina, mais l’aboutissement réel ou fantasmé du parcours migratoire : le retour au pays réussi par le kayman.
Des mots pour le dire
Nommer des personnes, des évènements ou des lieux relève d’un processus de catégorisation du monde. Ce dernier est variable, à la fois selon les langues, et surtout selon les points de vue et les expériences des êtres humains concernés.
En français, la langue du pays dit d’accueil, de nombreux mots existent qui relèvent du domaine juridique ou administratif, comme migrant, émigrant, immigré, demandeur d’asile, exilé, expatrié, réfugié, clandestin, illégal, étranger en situation irrégulière. À l’exception notable de l’auto-désignation « sans-papiers », l’expérience française de la migration se déploie essentiellement à travers la mise en mots des lois, circulaires ou décrets qui encadrent et régissent la vie des migrants.
Les expériences vécues par ceux-ci, expériences du départ, du voyage, de l’arrivée, du retour au pays, constituent un tout autre point de vue sur le monde et, partant, génère de tout autres mots. Aussi, on ne dispose pas de mot français pour désigner un parcours migratoire réussi, quand le wolof a inventé « kayman ». Et même si les récits de migrants font rarement état d’un retour heureux (David Lagarde, Cybergeo, 2022), du moins la possibilité ou le rêve d’une telle issue a-t-elle été codifiée dans un mot nouveau. Et cette nomination, comme toute opération de nomination, confère au migrant kayman une forme de réalité et d’objectivité.