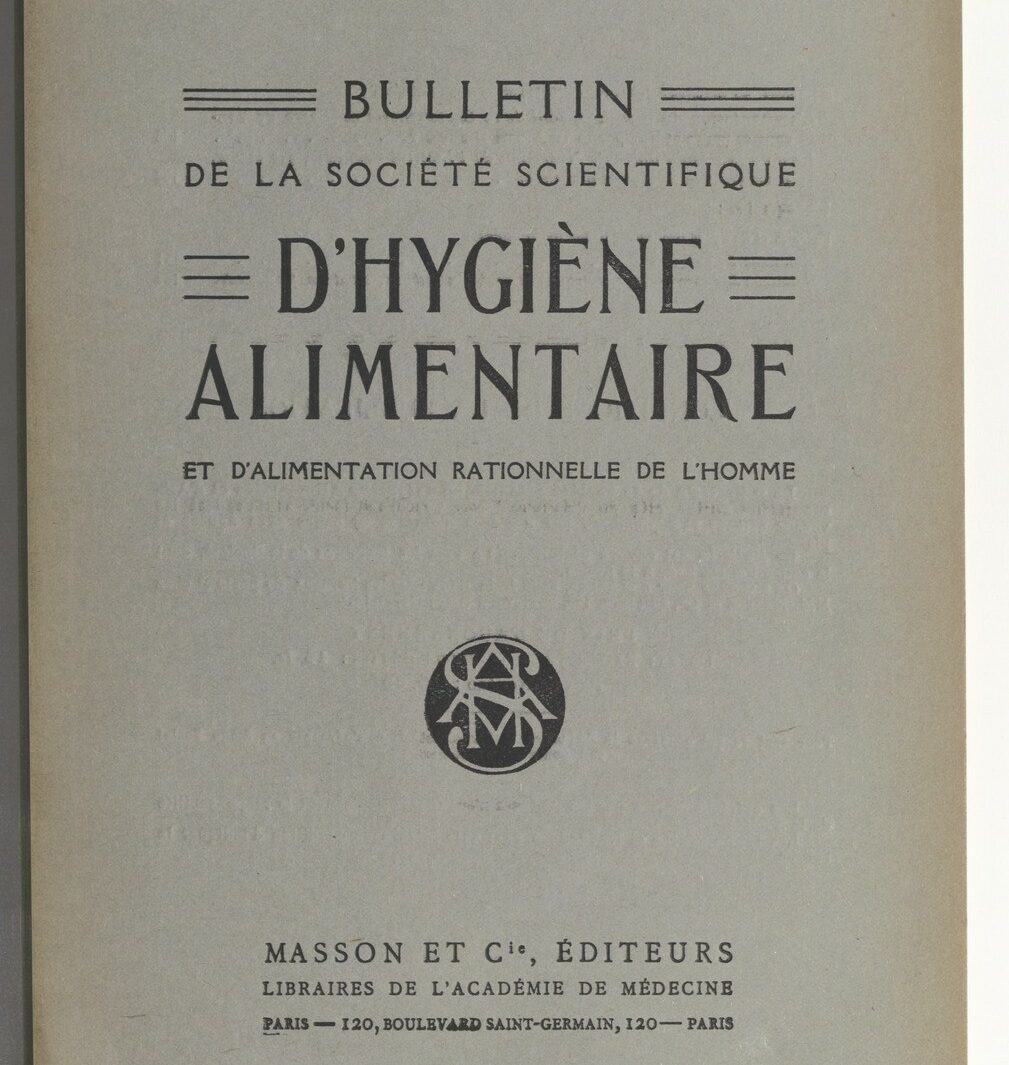Dans cet article, Martin Bruegel montre que l’enjeu de l’alimentation participe des luttes sociales pour définir la figure légitime du « consommateur ». Au début du 20e siècle, cherchant dans la malnutrition ouvrière un ferment de la tuberculose, des réformateurs sociaux s’attellent à promouvoir de nouvelles normes pour changer les pratiques alimentaires populaires jugées irresponsables. L’efficacité supérieure mise en exergue de ces normes repose sur la détermination du juste coût économique des calories, nécessaires à la reproduction de la force de travail. Si la campagne n’a eu à l’époque que peu d’effets concrets, cet exemple illustre pourtant bien ce que la production d’un tel modèle abstrait de consommateur doit à sa mise en conformité avec l’économie de marché, et le type de rationalité qu’elle requiert.
La campagne pour “l’alimentation rationnelle” du début du vingtième siècle est une des premières instances où la figure du “consommateur” devient pour ainsi dire un protagoniste – un argument en tous les cas – dans un mouvement qui vise à réformer les pratiques de consommation des classes populaires françaises[1]. Le but ostensible de cette initiative, portée par la Société scientifique d’hygiène alimentaire et de l’alimentation rationnelle (SSHA) composée surtout de médecins et de savants en sciences naturelles et bien connectée politiquement dès sa fondation en 1904, est d’assurer une bonne santé aux femmes et hommes d’origine modeste. Cet objectif hygiénique découle plus prosaïquement – ou se double étroitement – d’une préoccupation avec l’optimisation de la force de travail des ouvrières et ouvriers.
Toute une métrique comptable mise au point par des physiologistes vers les années 1880 sous-tend le projet d’une modification durable de la consommation alimentaire ouvrière. La calorie, unité énergétique, en est l’opérateur central : elle permet de mesurer la valeur énergétique des aliments, d’exprimer les besoins métaboliques des travailleurs et, en conséquence, de mettre un prix sur l’entretien du corps. L’équation qui détermine la combinaison la moins chère d’aliments requis pour nourrir adéquatement un être vivant – toutes espèces confondues – revient à la gestion du “capital-santé” individuel. Cette notion a de quoi surprendre en 1900. Mais elle situe le contenu et le contexte du projet de réforme. La consommation alimentaire, activité quotidienne dont les dépenses sont, à plus de la moitié des budgets ouvriers, de loin leur poste le plus important, devient ainsi le levier pour inculquer des dispositions cognitives valorisées dans une économie capitaliste. Il identifie concomitamment le type d’individu qu’elle requiert : le consommateur calculateur et prévisible.
Le “consommateur”
La figure du “consommateur” a pris forme au seuil du 20e siècle. Bien sûr, les gens ont toujours consommé les produits de première nécessité – nourriture, logement, vêtements, combustible – et c’était leur travail qui leur permettait de les acquérir. Ces activités sont concrètes et satisfont immédiatement à un besoin en détruisant, instantanément ou à plus long terme par usure, la substance de la chose utilisée. Les consommateurs sont alors les clients ouvriers qui sirotent un verre sur la terrasse d’un café situé dans le quartier Sainte-Marguerite à Paris et qui, selon L’Humanité de 1904, finissent par se battre contre une bande de jeunes bourgeois. Ou encore les 50,000 abonnés au gaz en Seine-et-Oise qui, en 1909, refusent de payer les factures jugées trop chères, ferment les robinets d’approvisionnement et s’illuminent à la chandelle et aux lampes à pétrole pour contraindre la compagnie à baisser le prix (le maire de Juvisy porte d’ailleurs l’étendard de la protestation en accrochant des lampions à sa résidence et l’hôtel de ville).
Le “consommateur”, au contraire, est un type abstrait. En apesanteur historique et sociale, il est fécond comme catégorie théorique parce qu’il répond aux principes qui sous-tendent la description idéalisée d’un individu évoluant dans une économie de marché : esprit de mesure, attention à l’épargne, prise en compte du temps, utilisation de dispositifs de prévoyance. Cette représentation conceptuelle est intimement liée à l’économie néoclassique de la deuxième moitié du dix-neuvième siècle. Mais elle déborde du champ académique et s’invite dans le monde réel. Elle prend alors la forme d’un idéal auquel confronter les comportements réels. Le “consommateur” incarne dans ce cas les qualités personnelles considérées comme nécessaires à la réussite capitaliste. Modèle lui aussi, il s’immisce dans l’expérience quotidienne où il permet de désigner – et stigmatiser – les écarts de conduite qui expliqueraient l’insuccès personnel mais aussi le coût que ce dernier infligerait à la société. Bref, il fonctionne comme un critère de jugement et une maquette pour guider des conduites. Dès lors, il est un enjeu des luttes sociales. La fabrication du “consommateur” en tant qu’agent économique ne va pas de soi.
Définir un problème public : de la tuberculose à l’alimentation
Le recours dans la discussion publique à la figure du consommateur doit beaucoup à la tuberculose, première maladie infectieuse en 1900. La découverte, en 1882, de la bactérie responsable de la contagion tuberculeuse n’enlève rien à la conviction des experts que l’encombrement des logements, le surmenage et la malnutrition favorisent son incidence. Cette étiologie environnementale – le milieu prépare le terrain à la maladie – permet au gouvernement d’envisager (mais de mettre en pratique timidement) des politiques d’assainissement des quartiers insalubres et de l’aménagement du temps de travail afin d’améliorer la situation sanitaire de la population. Mais comment définir la malnutrition, chiffrer son ampleur et, en l’absence d’une surveillance des prix alimentaires, combattre ses ravages ?
C’est là où trois médecins membres de la SSHA interviennent en 1904. Le doyen Louis Landouzy et ses deux assistants, les frères Henri et Marcel Labbé, lancent une enquête sur les habitudes alimentaires d’une centaine de patients tuberculeux (ou soupçonnés de l’être) à l’hôpital Laënnec à Paris. Leur intention est de découvrir “s’il ne se trouve pas à la base de l’alimentation ouvrière parisienne, un certain nombre de fautes commises contre la physiologie de la nutrition”[2]. La question suggère la réponse, mais il est vrai que l’investigation livre des données précises. Les chercheurs peuvent comparer leurs résultats empiriques à une norme métabolique du nombre de calories nécessaires par unité de poids. L’établissement de cette norme est une des prouesses récentes des recherches internationales sur les besoins énergétiques d’une personne au repos ou au travail.
L’équipe présente ses résultats au Congrès international de la tuberculose en octobre 1905. Elle ne laisse planer aucun doute sur les conclusions et ce d’autant plus que l’investigation omet d’inclure les conditions de travail ou d’habitat dans le questionnaire concernant les modes de vie des enquêtés. “L’alimentation prise par les travailleurs hommes et femmes”, déclarent-ils, “est insuffisante en qualité comme en quantité”. Les appétits l’emportent sur la raison. “Des appréciations irréfléchies et fantaisistes plutôt […] que les appréciations sur la valeur nutritive” guideraient les consommations alimentaires. Les goûts des ouvriers pour la viande et les boissons alcooliques et “le caprice des femmes” pour les salades et légumes verts les exposent à la maladie.
L’annonce suscite un fort écho médiatique. Les commentaires dans la grande presse dérivent aisément vers une inférence abusive. L’étendue limitée de l’échantillon ne fait pas obstacle à des généralisations qui anathématisent “le peuple [qui] a une alimentation généralement insuffisante, insalubre et dispendieuse. Il en résulte un état de déchéance qui favorise l’éclosion de la tuberculose”. Voici comment rendre la victime coupable de son sort.
Reste un détail saillant mais ignoré. L’enquête de Landouzy et al. montre que les ouvriers parisiens absorbent assez de calories selon la théorie physiologique : entre 2400 et 4800 kcal par jour. Mais elle signale aussi qu’ils les paient cher. Seul le portrait des femmes travaillant dans la haute-couture reste en-deçà de la recommandation nutritionnelle d’environ 2000 kcal par jour, dont le coût théorique s’avère de surcroît plus élevé que la somme réellement dépensée pour l’alimentation. Le problème que ces trois médecins définissent est donc moins nutritionnel qu’économique car une augmentation des salaires, surtout des ouvrières, améliorerait à coup sûr la qualité de l’alimentation. Il n’en est rien. La pathologie devient la justification d’une campagne de domestication des classes populaires : l’éducation du consommateur promet la santé mais cible le porte-monnaie. La gymnastique budgétaire s’exercera à revenu constant.
Le “catéchisme de l’alimentation rationnelle”
Si, selon les médecins, l’ignorance est à l’origine de “l’absurdité de l’alimentation populaire”, l’information semble la solution. La fondation de la SSHA profite à la publicité autour de l’investigation sur la centaine d’ouvriers et d’employés parisiens. Son programme contient un volet pédagogique visant à enseigner “les moyens par lesquels la classe des travailleurs pourra trouver pour le prix minimum le maximum d’aliments substantiels et sains”. L’efficacité est le maître-mot. En mettant un prix sur la calorie selon sa provenance, il devient possible d’établir le panier alimentaire optimal. “Le choix des denrées résulte d’un calcul”, écrit Landouzy, “et l’institution d’un menu doit être un problème, au cours duquel se multiplient les règles d’arithmétique. […] Le rendement économique de la substance doit être le vrai guide pour la composition harmonieuse des diverses denrées entre elles suivant les règles physiologiques”. La formule consiste ainsi à établir l’équilibre entre besoins énergétiques et ressources monétaires sous contrainte de préceptes nutritionnels. Exit la saveur des aliments.
La nouvelle représentation de l’aliment en calories et macronutriments nécessite cependant un apprentissage de la part des profanes. En d’autres mots, les prosélytes de la campagne pour “l’alimentation rationnelle” ont besoin de supports didactiques. Des tableaux d’éducation alimentaire voient le jour pour familiariser le public avec le nouveau langage de la nutrition et l’instruire quant aux valeurs énergétiques des aliments. Leur place serait à l’entrée des lieux de restauration, près de l’ardoise listant le menu (à ce propos, notons que le restaurant Natura-Vigor propose des “menus rationnels” pour souligner l’assise scientifique du végétarisme). L’idée de cette classification est d’inciter les consommateurs à substituer aux aliments chers des produits roboratifs et achetés à meilleur marché. Ainsi les onéreuses viandes et la charcuterie se remplacent avantageusement par le hareng, le maquereau et surtout les légumineuses, tous plus abordables. Le sucre et le saindoux se placent bien avant les légumes verts et les fruits qui eux, fournissent des calories couteuses.
L’éducation du consommateur consiste non seulement en une initiation cognitive et un entrainement en calcul mental pour repenser des gestes coutumiers, elle requiert aussi de nouveaux instruments de mesure pour les rendre possibles. L’habitude d’acheter et de cuisiner par unité – une tête de chou-fleur, une botte de carotte, un poulet, un panier de fruits ou de pommes de terre – doit faire place à l’achat au poids. La SSHA pousse donc à l’introduction de balances dans deux espaces largement féminins, les marchés et les cuisines. Assurément, “le consommateur” est bien souvent une consommatrice. L’enseignement ménager avec ses manuels et flyers se mue en véhicule pour former les femmes du peuple à l’alimentation rationnelle avec des leçons sur le choix des aliments (“de tous les aliments, les plus avantageux sont le pain, les légumes secs, puis le sucre et le saindoux”) et la comptabilité domestique.
“L’amour propre du prolétaire”
“L’alimentation rationnelle” rencontre un succès inégal. La SSHA reconnait en 1912 que le public reste assez indifférent à ses efforts de propagande. La raison ? La campagne souffre d’un point aveugle : l’équation à deux variables met en jeu le panier alimentaire et son coût pour optimiser conjointement santé et budget mais néglige de prendre en compte le prix que les ménages populaires consentent à payer pour assouvir leurs préférences gustatives. Un observateur y met le doigt en remarquant que “le prolétaire a son amour-propre”. C’est bien là une pierre d’achoppement. La distance sociale qui sépare les experts des milieux dont ils veulent réformer les pratiques se traduit en ignorance des préoccupations, des servitudes ordinaires mais aussi des prédilections des classes modestes. Les ouvriers ne sont pas des répliques du consommateur abstrait. Ils manifestent des goûts pour la diversité alimentaire, pour la viande et le vin plutôt que les lentilles et le sucre. Cette culture culinaire ne le cède pas à la faveur des avantages pécuniaires. Les promoteurs concèdent d’ailleurs que l’adhésion des individus et des ménages privés aux principes scientifiques de l’alimentation rationnelle viendra après leur utilisation comme outil de gestion dans des collectivités où la liberté de choix est restreinte et l’intendance stricte (armée, prisons, hôpitaux, cantines industrielles). Ou en temps de guerre et rationnement.
L’épisode de l’alimentation rationnelle du début du 20e siècle devrait nous mettre la puce à l’oreille. Chaque recours à la figure du “consommateur” dans les discussions publiques prêche une manière d’être au monde, en l’occurrence celle qui saurait “optimiser son budget”. Il permet aussi de détourner le regard d’un principe antagonique à l’espace capitaliste, la justice sociale.