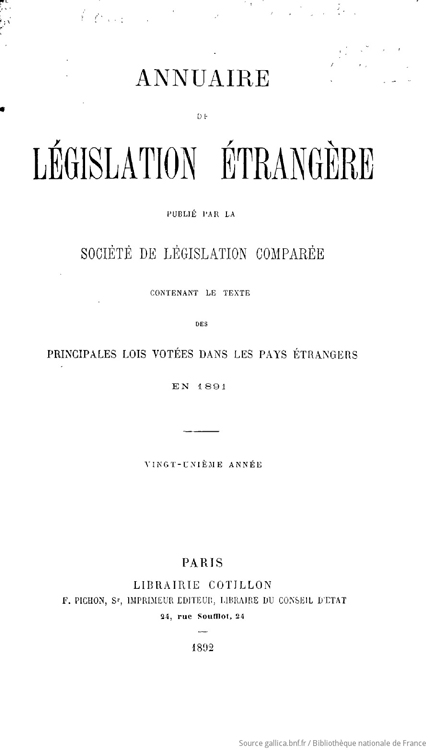En Angleterre, le principe de la gratuité de l’enseignement élémentaire est clairement affirmé dans l’article 26 de l’Education Act de 1918. Auparavant, les parlementaires anglais cherchaient à développer le nombre des écoles, sans toucher au système déjà en place et remettre brusquement en cause les intérêts acquis. L’Elementary education Act de 1870 autorisait le conseil scolaire (School board) à établir des écoles gratuites, dans les localités où les habitants étaient trop pauvres, sous réserve de respecter les règles et conditions fixées par le Département de l’éducation. L’Elementary education Act de 1880 pose le principe de l’instruction obligatoire dans toute l’étendue de l’Angleterre et du pays de Galles sans reconnaître son corolaire, la gratuité de l’enseignement. Mais peu de poursuites ont été engagées contre les parents qui ne respectaient pas cette obligation, car bien souvent, on ne pouvait leur reprocher que leur pauvreté[1]. L’Elementary education act de 1891, sans poser le principe de l’instruction gratuite, augmente le montant des subventions accordées précédemment par l’État de manière à ce que dans la plupart des écoles, les parents n’aient plus à payer de rétribution scolaire. Dans les débats parlementaires qui ont conduit à l’adoption de cette loi de 1891, on retrouve les principaux arguments des partisans ou opposants de la gratuité de l’instruction obligatoire qu’Alcide Darras résume dans la présentation et le commentaire de cette loi qu’il rédige pour l’Annuaire de législation étrangère.
Un objet que l’on obtient gratuitement perd par là même de sa valeur
Pour les conservateurs, « il était dangereux de ne point laisser à l’initiative individuelle des parents le soin d’assurer l’instruction de leurs enfants; puis, un objet que l’on obtient gratuitement perd par là même de sa valeur; c’est donc un faux calcul de penser que la gratuité de l’instruction produit une assiduité plus grande, l’exemple des États-Unis d’Amérique le prouve: l’instruction y est gratuite, et cependant l’assiduité y est moins grande qu’en Angleterre; on ne sait pas d’ailleurs jusqu’où peut conduire le raisonnement de ceux qui se montrent partisans du bill; logiquement, il faudra en arriver à nourrir et à vêtir ceux que l’on force les parents à envoyer aux écoles : c’est du pire socialisme; on prétendit parfois aussi que le vote de la loi aurait pour conséquence la ruine des écoles volontaires, c’est-à-dire de celles qui ne sont pas placées sous la surveillance des School boards, et que par suite le projet allait à l’encontre du développement de l’instruction, puisque le premier objet de toute instruction est de faire connaître aux enfants les principes de la religion.
Ce dernier grief, accueilli comme de bon augure par certains libéraux, était repoussé par le Gouvernement: les écoles volontaires furent, en Angleterre, les pionniers de l’instruction lorsque l’instruction publique n’existait pas encore; il ne faut pas qu’une mesure prise pour amener un développement de l’instruction se retourne contre ceux auxquels l’Angleterre doit ses premières écoles; les écoles volontaires n’ont rien à craindre, puisque le projet les met sur la même ligne que les autres écoles; au surplus, les parents qui envoient leurs enfants dans ces écoles le font par principe; ils ne les enverront pas dans d’autres, parce que celles-ci seraient gratuites, alors qu’on continuerait à percevoir une légère rétribution dans les écoles volontaires.
Cette déclaration du gouvernement, confirmée par un grand nombre de députés conservateurs, paraît reposer sur une appréciation exacte des faits; aussi, ne faut-il pas s’étonner que certains députés, adversaires des écoles volontaires, aient demandé, sans succès d’ailleurs, que celles-ci ne soient pas admises à prendre part au partage des fonds que le parlement serait appelé à voter en exécution de la loi nouvelle; la Chambre des communes a rejeté dans cet ordre d’idées, par 159 voix contre 90, un amendement qui tendait à déclarer que, pour les écoles qui ne seraient pas placées sous la surveillance d’un conseil scolaire, elles ne pourraient prendre part au partage des fonds votés par le parlement que si au moins un sixième des dépenses totales était couvert par des souscriptions volontaires.
La gratuité de l’instruction : un complément nécessaire de l’instruction obligatoire
Quant aux autres arguments produits par les adversaires du projet, il y fut répondu de la manière suivante : la gratuité de l’instruction est un complément nécessaire de l’instruction obligatoire; celle-ci manque de sanction effective tant que les parents peuvent expliquer par leur pauvreté leur négligence à envoyer leurs enfants à l’école.
Ce motif se retrouve dans les discours de tous ceux qui se sont montrés favorables au projet; il est, au contraire, certaines considérations qui ont été présentées par quelques défenseurs du bill, et qui ont été rejetées par d’autres défenseurs : c’est ainsi que, pour quelques-uns, les frais de l’instruction doivent être mis à la charge de l’État, parce que c’est dans l’intérêt de l’État qu’une instruction est donnée aux enfants.
Certains partisans de la gratuité mirent aussi en avant une idée qui d’ailleurs fut repoussée par d’autres députés partageant la même opinion : on prétendit que l’instruction devait être gratuite, parce que l’État devait une compensation aux parents qui, envoyant leurs enfants à l’école, se trouvaient privés des salaires que ceux-ci auraient pu gagner s’ils avaient été employés dans des usines ou dans des ateliers.
Mais un point sur lequel se montrèrent d’accord tous les amis de la réforme était que le vote du projet aurait pour conséquence d’augmenter le nombre des enfants fréquentant les écoles. Si, a-t-on dit, en Amérique, l’assiduité dans les écoles est moins grande qu’en Angleterre, bien que l’instruction y soit gratuite, c’est que, sauf dans un ou deux États particuliers, l’obligation n’existe pas, et que, là où elle existe, elle n’est pas sanctionnée d’une manière très énergique. Au surplus, dans les villes d’Angleterre où, comme à Birmingham et à Manchester, on a établi des écoles gratuites, il s’est produit un accroissement très sensible du nombre total des élèves; il en a été de même à Berlin où dans les quinze ans qui ont suivi l’établissement de la gratuité de l’instruction, il a été permis de constater que le nombre des écoles a triplé et celui des élèves a quadruplé.
On ne peut craindre que la gratuité de l’instruction ait pour conséquence logique de mettre à la charge de l’État les frais pour nourriture et entretien des enfants envoyés dans les écoles; c’est qu’en effet la nourriture et les vêtements sont une nécessité de l’existence, et qu’il n’en est pas de même de l’instruction.
Il est d’ailleurs inexact de prétendre que les parents doivent être peu portés à apprécier une instruction pour laquelle ils n’ont rien payé; c’est qu’en effet il est bon de constater que, même après le vote de la loi nouvelle, les parents continueront véritablement encore à payer les frais d’instruction de leurs enfants. Seulement, le mode de paiement est changé, au mieux des intérêts des parents : les subventions parlementaires seront prélevées sur le produit des impôts, et, de cette façon, les parents, au lieu d’être obligés de payer, comme à l’heure actuelle, les rétributions scolaires dans un nombre restreint d’années et à un moment où ils sont, d’autre part, surchargés de dépenses pour élever et nourrir leurs enfants, pourront échelonner sur toute leur vie le paiement des frais mis à leur charge.
On a aussi fait valoir, en faveur de la loi nouvelle, une considération qu’il nous faut indiquer pour être complet : on a dit que la gratuité aurait pour avantage de supprimer la perte de temps qu’occasionne la perception des rétributions scolaires faite durant les classes.
Telles sont, en résumé, les discussions auxquelles a donné lieu le principe même de la loi.
Quel sera l’effet de sa mise en vigueur? Ainsi que nous l’avons déjà dit, celle-ci n’aura pas pour conséquence de rendre gratuite l’instruction primaire dans toutes les écoles d’Angleterre et du pays de Galles, mais ce résultat sera atteint dans un grand nombre d’entre elles, tout au moins dans celles qui sont appelées à recevoir une subvention (10 shillings par chaque élève présent) égale ou même supérieure au montant des rétributions scolaires, précédemment payées par les parents des élèves ; il était difficile, on le conçoit aisément, de prévoir exactement le nombre des écoles dans lesquelles ce résultat serait atteint. Certains orateurs ont pensé qu’il en serait ainsi dans les deux tiers des écoles, d’autres dans les quatre cinquièmes, d’autres dans 83 % des écoles, d’autres au profit de 89%des élèves. On doit observer, d’ailleurs, que les subventions accordées aux écoles publiques, par application de la loi nouvelle, ne seront pas les seules qu’elles recevront ; indépendamment des 2 millions de livres sterling environ qui leur sont attribuées de ce chef, il leur sera payé une somme de plus de 3 millions, ainsi que cela se pratiquait antérieurement au vote de la loi nouvelle.
C’est intentionnellement que le législateur anglais n’a pas réalisé d’une manière absolue, la gratuité de l’instruction primaire dans les écoles publiques; il n’a pas voulu que, grâce aux mesures prises, toutes les écoles publiques fussent placées sur une même ligne; il a voulu que les parents, désireux d’éviter à leurs enfants certaines fréquentations et de leur donner une instruction un peu plus soignée, pussent trouver certaines écoles publiques, remplissant ces conditions, et ne soient pas forcés, comme en France, par exemple, de s’adresser à des écoles privées. Quelques membres de l’opposition auraient voulu, au contraire, que l’instruction fût véritablement gratuite dans toutes les écoles publiques.