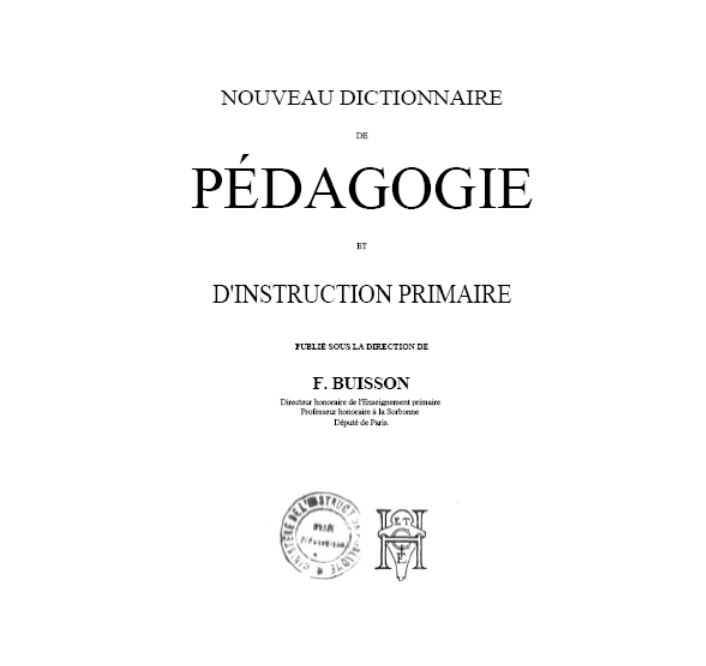L’œuvre révolutionnaire en matière d’éducation fut, dans ces premières années, ambitieuse et progressiste. En pratique, elle fut un échec. Comme le résume Françoise Mayeur, dans son livre, Histoire de l’enseignement et de l’éducation (Paris, Perrin, 2004, p. 56), « la volonté fut immense, autant que les contradictions et le dédain des faits. Les moyens en hommes et en argent firent défaut, dans une nation en proie aux ennemis de l’intérieur et de l’extérieur. Même si elle ne fut pas couronnée de succès, l’obstination à se préoccuper de l’éducation, obstination qui est presque obsession, montre l’effort des hommes de la Révolution pour se projeter dans l’avenir et assurer, par les bases qu’ils croyaient les plus sûres, l’entrée de la France dans une ère nouvelle ». Cette volonté ne restera pas sans lendemain si l’on s’intéresse « à la constance avec laquelle, au cours du XIXe siècle, la Révolution fut prise comme point de référence, positif ou négatif, dans la sphère de l’instruction ».
Nous reproduisons ici un extrait du tableau général de l’histoire de l’enseignement public en France rédigé par Maurice Pellisson et publié dans Nouveau dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson (1911) dont l’Institut Français de pédagogie a mis en ligne une version numérique. Il recense et résume les différents projets étudiés dans cette période et les décrets adoptés. Les liens hypertextes qui renvoient soit vers d’autres articles de ce dictionnaire, soit vers les textes cités comme les notes de bas de pages ont été ajoutés par la rédaction de Silo.
 Les cahiers de 1789, même ceux du clergé et de la noblesse, réclament la réorganisation sur un plan d’ensemble de l’instruction publique. Les cahiers du clergé de Rodez et de Saumur demandent « qu’il soit fait un plan d’éducation nationale pour la jeunesse » ; ceux de Lyon, que l’éducation soit confiée « à un corps enseignant dont les membres ne soient amovibles que pour cause de négligence, d’inconduite ou d’incapacité ; qu’elle ne soit plus dirigée d’après des principes arbitraires, et que tous les instituteurs publics soient tenus de se conformer à un plan uniforme adopté par les États généraux ». Les cahiers de la noblesse de Lyon insistent pour qu’on imprime à l’éducation des deux sexes « un caractère national ». Ceux de Paris demandent « que l’éducation publique soit perfectionnée et étendue à toutes les classes de citoyens ». Ceux de Blois, « qu’il soit établi un conseil composé des gens de lettres les plus éclairés de la capitale et des provinces et de citoyens des divers ordres, pour former un plan d’éducation nationale à l’usage de toutes les classes de la société et pour rédiger des traités élémentaires ».
Les cahiers de 1789, même ceux du clergé et de la noblesse, réclament la réorganisation sur un plan d’ensemble de l’instruction publique. Les cahiers du clergé de Rodez et de Saumur demandent « qu’il soit fait un plan d’éducation nationale pour la jeunesse » ; ceux de Lyon, que l’éducation soit confiée « à un corps enseignant dont les membres ne soient amovibles que pour cause de négligence, d’inconduite ou d’incapacité ; qu’elle ne soit plus dirigée d’après des principes arbitraires, et que tous les instituteurs publics soient tenus de se conformer à un plan uniforme adopté par les États généraux ». Les cahiers de la noblesse de Lyon insistent pour qu’on imprime à l’éducation des deux sexes « un caractère national ». Ceux de Paris demandent « que l’éducation publique soit perfectionnée et étendue à toutes les classes de citoyens ». Ceux de Blois, « qu’il soit établi un conseil composé des gens de lettres les plus éclairés de la capitale et des provinces et de citoyens des divers ordres, pour former un plan d’éducation nationale à l’usage de toutes les classes de la société et pour rédiger des traités élémentaires ».
Ainsi les idées qui se dégagent des cahiers de 1789 sont : l’organisation d’un système d’éducation destiné à former des citoyens ; l’extension de l’enseignement aux deux sexes et à toutes les classes ; la création d’un corps enseignant fort analogue à ce qu’a été plus tard l’Université ; une agence centrale présidant à l’exécution du plan dans toute l’étendue du royaume.
De nombreux projets de réforme s’élaboraient dans l’Assemblée et hors de l’Assemblée. Deux de ces derniers projets méritent surtout l’attention : celui que rédigea l’oratorien Daunou, et les quatre discours publiés par Cabanis après la mort de Mirabeau, sous le nom de celui-ci. Quant à l’Assemblée, – qui venait de voter la constitution, dont une disposition portait « qu’il serait créé une instruction publique, commune à tous les citoyens, gratuite à l’égard des parties d’enseignement indispensables à tous les hommes »[1], – elle entendit les 10, 11 et 19 septembre 1791 un grand rapport et un projet de décret sur l’instruction publique, fait par Talleyrand-Périgord, ancien évêque d’Autun, au nom du Comité de constitution, mais elle ne statua rien.
L’Assemblée législative eut moins de temps encore que la Constituante pour travailler à la solution du problème. Elle eut un Comité spécial chargé d’étudier les questions d’instruction publique : Condorcet, rapporteur de ce comité, présenta, les 20 et 21 avril 1792, un rapport et un projet de décret sur l’organisation générale de l’instruction publique ; une seconde lecture du projet eut lieu le 25 mai, et Condorcet présenta en même temps un aperçu des frais que coûterait le nouveau plan d’instruction publique ; la discussion fut ajournée. À la suite d’un autre rapport du Comité d’instruction publique, sur les congrégations séculières, fait le 10 février par Gaudin, la Législative vota, le 18 août 1792, un décret supprimant toutes ces congrégations et ordonnant la vente de leurs biens, à la réserve des bâtiments et jardins à l’usage des collèges.
La Convention, dont la session dura un peu plus de trois ans, du 21 septembre 1792 au 4 brumaire an IV (26 octobre 1795), discuta l’un après l’autre sept projets différents, dont trois furent mis successivement à exécution :
1° Le Comité d’instruction publique[2] prit d’abord pour base de son travail le plan de Condorcet, légué à la Convention par la Législative, et rédigea (novembre 1792) un projet de décret sur les écoles primaires[3] (condensé le 30 mai 1793 par le Comité de salut public en cinq articles[4]), ainsi qu’un tableau de l’enseignement public divisé en quatre degrés (28 mai 1793) ;
2° Le Comité, partiellement renouvelé, présenta ensuite, après l’adoption de la constitution républicaine du 24 juin 1793[5], un projet de décret pour l’établissement de l’éducation nationale, œuvre de Sieyès ; ce projet[6] (26 juin 1793), qui n’admettait qu’une seule espèce d’écoles, celles du degré élémentaire, appelées « écoles nationales », et laissait à l’industrie privée les autres degrés d’instruction, fut rejeté par la Convention le 1er juillet ;
3° Une Commission d’instruction publique de six membres, nommée le 3 juillet et dont la composition fut modifiée à plusieurs reprises, reçut alors le mandat de présenter d’urgence un projet de décret sur l’éducation et l’instruction publiques. La Commission offrit d’abord à la Convention (13 juillet) le projet de Lepeletier Saint-Fargeau, rédigé six mois auparavant, et qui substituait aux écoles primaires des maisons d’éducation commune ; le principe de ce projet, qui mettait l’entretien des enfants de cinq à onze ou douze ans à la charge de la République, fut adopté en principe (13 août[7]), mais à la condition que l’envoi des enfants aux maisons communes serait facultatif et non obligatoire. Au-dessus des maisons d’éducation commune, la Commission conservait les degrés supérieurs d’enseignement du plan de Condorcet (deux degrés selon un premier projet, du 29 juillet[8] ; trois degrés selon le projet du 15 septembre[9]). Le plan définitif[10] de la Commission (augmentée de quatre membres le 16 septembre) fut présenté par Romme le 1er octobre ;
4° Le Comité d’instruction publique, entièrement renouvelé, et auquel avait été réunie la Commission (15 du premier mois de l’an 2°, 6 octobre), adopta le plan qu’avait présenté la Commission le 1er octobre, et chargea Romme de le défendre à la tribune. Le 28 du premier mois, la Convention rapporta le décret du 13 août[11] relatif aux maisons communes, qui n’avait d’ailleurs reçu aucun commencement d’exécution. Les degrés successifs d’instruction étaient appelés, dans le projet Romme, premières écoles de l’enfance (écoles primaires du plan de Condorcet), secondes écoles de l’enfance (écoles secondaires de Condorcet), écoles de l’adolescence ou troisièmes écoles (instituts de Condorcet) : le projet prévoyait en outre des écoles spéciales, pour l’acquisition des connaissances « relatives aux besoins de la société tout entière ». Une série de dispositions concernant les « premières écoles » furent votées du 30 du premier mois au 9 brumaire[12] ;
5° La Convention ayant décidé une révision des décrets votés sur les premières écoles, un nouveau projet, le projet Bouquier, surgit au sein du Comité, substituant un enseignement dit « libre » (mais dont les instituteurs devaient être néanmoins salariés par la République) au projet de Condorcet repris par Romme. La Convention accorda la priorité au projet Bouquier, dont la partie relative au premier degré d’instruction fut votée et forma le décret du 29 frimaire an II[13]. Ce décret est la première des diverses législations scolaires discutées par la Convention qui ait été appliquée ; les dispositions en furent exécutées, en ce qui concerne la partie financière tout au moins, pendant quatre trimestres, de germinal an II à la fin de ventôse an III. Quant à. la partie du projet Bouquier relative au dernier degré d’instruction, elle ne vint pas en discussion ;
6° Après le 9 thermidor, Sieyès étant redevenu l’inspirateur de la majorité, son projet du 26 juin 1793 fut repris par le Comité d’instruction publique, encore une fois renouvelé : le rapporteur, Lakanal, en fit le décret du 27 brumaire an III[14] sur les écoles primaires, qui entra en vigueur à partir de germinal an III et subsista jusqu’à la fin de la session conventionnelle ; mais cette fois, au lieu de se borner à l’unique degré d’instruction représenté par les « écoles nationales » du projet du 26 juin 1793 (écoles primaires du décret du 27 brumaire an III), le Comité y ajouta un second degré, les écoles centrales (projet du 26 frimaire an III[15], voté le 7 ventôse an III[16])
7° Après l’écrasement définitif du parti montagnard en prairial an III, les thermidoriens unis aux girondins firent une nouvelle constitution (constitution de l’an III[17]). Au nombre des lois organiques de cette constitution devait se trouver une loi sur l’instruction publique ; Daunou, au nom de la Commission des Onze, en présenta une première ébauche le 6 messidor an III[18] ; le projet, remanié par le Comité d’instruction publique, fut adopté sous sa forme définitive le 3 brumaire an IV : cette loi conservait les écoles primaires et les écoles centrales, en y ajoutant des écoles spéciales et un Institut national des sciences et des arts. Mais l’instruction primaire n’était plus ni obligatoire ni gratuite ; l’instituteur ne recevait de la République qu’un local pour son école, mais point de traitement.
En dehors des écoles prévues dans les différents plans d’instruction publique, la Convention créa ou réorganisa un certain nombre d’établissements consacrés à divers enseignements particuliers ; les principaux sont : le Muséum d’histoire naturelle (décret du 10 juin 1793), l’Observatoire, dont les astronomes prirent le titre de professeurs (décret du 31 août 1793), l’Institut national de musique, devenu ensuite le Conservatoire national de musique (décrets du 18 brumaire an II et du 16 thermidor an III), l’École centrale des travaux publics, devenue ensuite l’École polytechnique (décrets du 21 ventôse an II et du 7 vendémiaire an III), le Conservatoire des arts et métiers (8 vendémiaire an (III), l’École normale temporaire (décrets du 9 brumaire an III et du 7 floréal an III), les Écoles de santé (décret du 14 frimaire an III), les institutions de sourds-muets de Paris et de Bordeaux (décret du 16 nivôse an III), l’École des langues orientales vivantes (10 germinal an III), le Cabinet des antiques (20 prairial an III), le Bureau des longitudes (7 messidor an III), l’Institut des aveugles travailleurs (10 thermidor an III), les Écoles de services publics (30 vendémiaire an IV).
Pendant les quatre années du Directoire (an IV-an VIII), il ne fut rien innové dans les institutions scolaires, qui restèrent telles que les avait fixées la loi du 3 brumaire an IV. Les projets discutés au Conseil des Cinq-Cents en l’an VI et en l’an VII n’aboutirent pas. Il faut mentionner seulement les arrêtés du Directoire du 27 brumaire an VI[19], « pour faire prospérer l’instruction publique », et du 17 pluviôse an VI[20], pour la surveillance des écoles privées, ainsi que l’arrêté du 15 vendémiaire an VII du ministre de l’intérieur François de Neufchâteau, instituant un Conseil d’instruction publique.