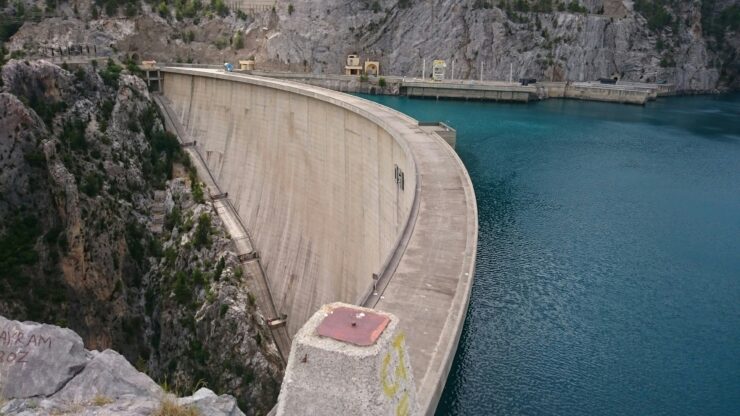Syndicats

Le syndicalisme dispose-t-il de la possibilité de se tenir à l’écart de la lutte pour le pouvoir ? Sous peine de se désarmer et de se rendre impuissant, il est placé devant l’obligation d’intervenir en évaluant ce que le pouvoir accomplit et en formulant des propositions. Ainsi, si l’« apolitisme syndical » revient de manière récurrente, une approche critique de l’histoire incline à le considérer comme un leurre. René Mouriaux aborde la question « sensible » des rapports du syndicalisme avec les titulaires du pouvoir d’État, en particulier avec les partis politiques et s’interroge sur les principaux facteurs de l’apolitisme syndical en France ainsi que sur sa spécificité par rapport à ses voisins européens et au syndicalisme états-unien.

Comment (re)politiser l’entreprise ? Dans cet article, Aymeric Seassau rappelle que le lieu de travail est un lieu décisif de pouvoir, de politisation et de lutte des classes. Selon lui, il faut mettre fin à l’abandon de l’entreprise par la gauche et prendre résolument le parti du travail, afin d’engager la révolution des rapports de production.

Que faire pour lutter efficacement contre la désindustrialisation et pour sauver les centaines de milliers d’emplois menacés en France ? L’économiste Evelyne Ternant, candidate NFP dans le Jura aux dernières élections législatives de 2024, a suivi de près la lutte des salariés de la fonderie MBF contre la fermeture de leur usine de Saint-Claude (actée en 2021). Elle dresse le bilan de cette forte mobilisation, organisée par les syndicats et appuyée par certains partis politiques.