
Afin de dépasser l’opposition entre technosceptiques et tenants du scientisme, Hugo Pompougnac nous invite à analyser le basculement scientifique et technologique induit par la généralisation de l’intelligence artificielle au prisme du marxisme et du matérialisme. Le débat se recentre ainsi sur ses effets sur la division du travail entre travail mort – l’automatisation amenée à dominer – et travail vivant, les forces productives et leur avenir. L’enjeu de la mobilisation de ces innovations technologiques par les exploités ouvre alors de nouvelles perspectives en vue de leur émancipation et d’un changement révolutionnaire.
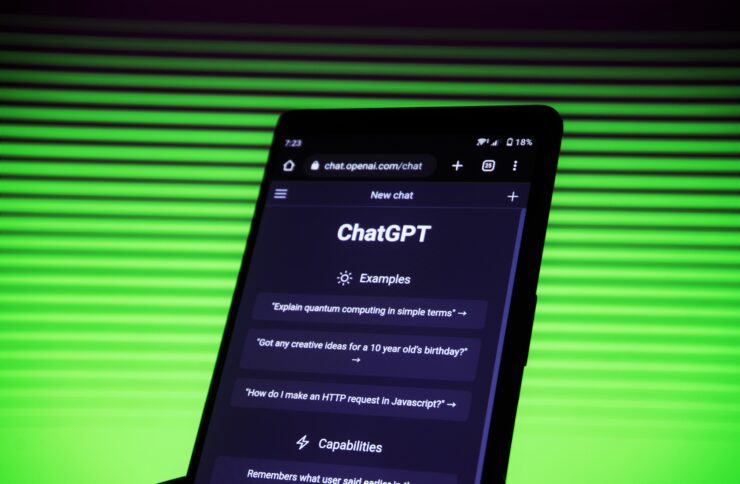
Disponible pour le public depuis fin novembre 2022, le robot conversationnel ChatGPT est rapidement devenu un symbole de la présence chaque jour plus imposante de l’intelligence artificielle dans nos vies. Dans cet article, Aurélie Biancarelli nous invite à interroger notre rapport aux savoirs et à l’apprentissage qui se trouve profondément changé avec l’utilisation de cet outil. Produisant des réponses consensuelles à partir de la collecte de grandes quantités d’informations, l’un de ses dangers réside dans la complexité et l’opacité des technologies de deep learning qu’il met en œuvre et dans l’instrumentalisation à des fins idéologiques que peuvent en faire les classes dominantes. Pour ne pas tomber dans ces écueils, il est ainsi essentiel de replacer la pensée critique et rationnelle au centre des apprentissages et d’assurer la maîtrise démocratique de ces nouveaux outils dont toute interdiction est vaine.
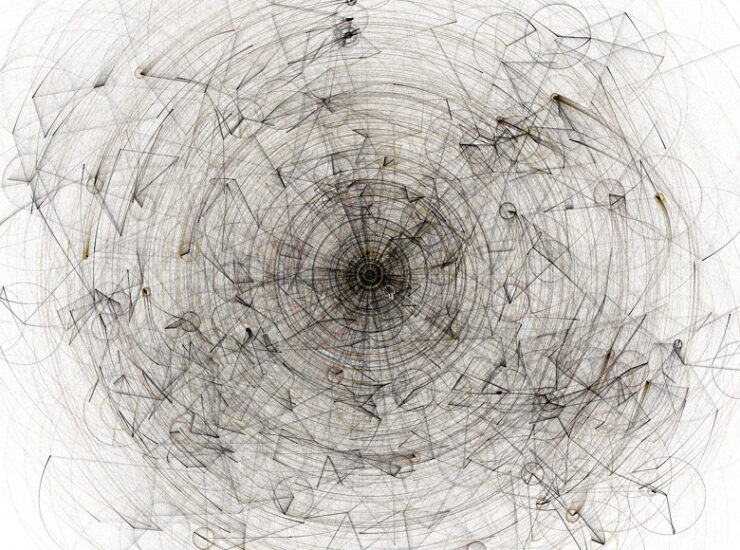
Les méthodes informatiques de calcul – souvent appelées « algorithmes » – alimentent le fonctionnement de dispositifs ordinaires. Moteurs de recherche, réseaux sociaux, systèmes de surveillance, plateforme d’achats en ligne : qu’on le veuille ou non, nous ne cessons d’interagir avec ces systèmes numériques ainsi qu’avec les algorithmes qui fondent leurs mécanismes internes. Comment reprendre la main sur ces entités souvent présentées (à raison) comme opaques, arbitraires et vectrices d’inégalités ? En se basant sur les résultats d’enquêtes ethnographiques récentes, Florian Jaton propose de se focaliser sur les bases de données référentielles – souvent appelées ground truth – qui sont au fondement du travail de construction algorithmique.

Les entreprises détentrices des réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, YouTube, TikTok (pour ne citer que ceux-là) ont de plus en plus recours à des systèmes d’IA pour réguler les contenus en ligne. Cependant, cette délégation de la modération à des outils automatisés semble aller de pair avec l’apparition de nouvelles formes de discriminations en ligne. Ainsi, en plus de faire face aux violences et attaques de groupuscules d’extrême droite, les militant·e·s de gauche et issu·e·s de communautés minorisées sont de plus en plus confronté·e·s à des risques de censure abusive en ligne. Thibaut Grison explique dans cet article pourquoi se saisir des technologies algorithmiques constitue un enjeu politique en particulier pour la gauche.

Le fonctionnement qui nous apparaît souvent mystérieux de l’informatique brasse son lot de représentations fantasmées et éthérées. Quoi de plus nébuleux que le « cloud computing » (informatique en nuage, en québécois) pour susciter une impression flottante d’apesanteur et de légèreté, à distance des mines d’extraction de silicium et des salles de serveurs lourdement climatisées ? Culpabilisés et mal-informés des conséquences d’une consommation de biens et de services numériques qu’ils n’ont pas toujours choisie, les citoyens n’en demeurent pas moins constamment incités à plus de consommation numérique. Fabrice Flipo réoriente notre regard en posant la question du gain réel de cette révolution industrielle. Les profits nouveaux que suscite une gestion plus efficiente des ressources alimentent une offre plus diversifiée de produits, donc de nouveaux besoins, entretenant ainsi une croissance économique néfaste pour la planète.
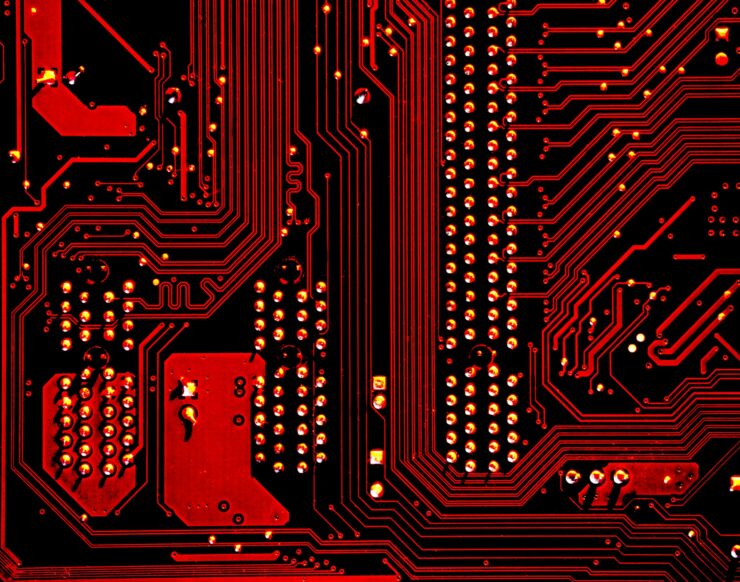
La croissance exponentielle du numérique et de son empreinte carbone nous mène-t-elle dans l’impasse ? Si des avancées technologiques promettent un numérique plus sobre, les applications concrètes sont encore peu nombreuses. Pour Sylvain Delaitre, il est donc urgent de limiter l’inflation des données, la production effrénée et très polluante de matériels électroniques et de replacer les enjeux technologiques et industriels associés dans le cadre de la délibération démocratique. L’implication des salariés, des scientifiques, des usagers citoyens dans les prises de décision stratégique permettrait de reconstruire des filières industrielles de technologies de pointe en phase avec les besoins humains et environnementaux.

Si le marché de la rencontre entre célibataires ne date pas du développement des technologies numériques – en France, les premières agences matrimoniales apparaissent dès le début du 19e siècle –, l’essor d’internet en a généralisé l’accès. La profusion des sites de rencontre permet désormais de consulter, en quelques clics sur son téléphone, des catalogues inépuisables de partenaires potentiels. Philippe Lefebvre souligne ici l’incidence psychique de cet état de fait, où se mêlent réification et addiction aux shoots de renarcissisation.





