Annick Davisse
Auteure d’ouvrages sur les femmes et le sport.
Dix ans après sa première édition, le livre de Geneviève Fraisse, Du consentement (éd. du Seuil, 2017, 160 p.) est réédité dans une version augmentée et dans un contexte où le mot consentement pénètre comme un argument de poids dans l’espace public. Selon Geneviève Fraisse, « partir du mot comme un nœud qu’il faut défaire, c’est une façon d’apprivoiser la dispute ». Annick Davisse revient sur la manière dont elle a « pris ce mot comme une question philosophique (qui) se manifeste comme un objet de discussions que l’on tourne et retourne, sorte de cube où les diverses faces racontent chacune une histoire ».
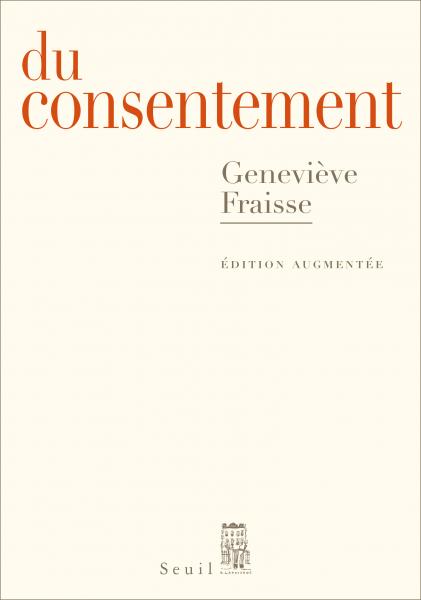 Pourquoi ce « petit » texte, paru il y a dix ans[1], fait-il l’objet d’une reparution ?
Pourquoi ce « petit » texte, paru il y a dix ans[1], fait-il l’objet d’une reparution ?
Parce que, nous indique d’emblée Geneviève Fraisse, « l’éditrice me presse de donner au lecteur et à la lectrice quelques explications personnelles. Consentir : j’ai longtemps pensé que l’acte de consentir relevait de l’intimité la plus grande, mélange de désir et de volonté dont la vérité gisait dans un moi profond. Lorsque j’ai entendu ce mot de consentement dans des enceintes politiques, parlement européen, débats télévisuels, discussions associatives, j’ai compris qu’il pénétrait dans l’espace public comme un argument de poids ».
La logique de la révolte et la logique de l’inscription historique
Or le politique importe pour l’autrice (elle tient à cette forme grammaticale) qui rappelle « avoir accédé abruptement à une fonction politique dans le temps fort de la gauche plurielle » (en 1997, v. infra) et y avoir « fait l’expérience de la “publicité” de cet objet curieux, le féminisme, le droit des femmes, l’égalité des sexes ». On lit ici un retour plus en amont de son itinéraire : « inventer des raisons nouvelles de la liberté des femmes et de l’égalité des sexes et accéder à une époque qui ne pouvait plus ignorer qu’elle avait un passé, une histoire et une mémoire, j’ai voulu poursuivre cette double raison de comprendre, la logique de la révolte et la logique de l’inscription historique » et « plus rien ne m’intéressait que la généalogie de la pensée contemporaine de l’égalité des sexes et, à l’horizon, la reconstruction de la pensée des sexes dans l’histoire philosophique ».
Rappelons en effet combien fut important, pour tous ceux et toutes celles qui voulurent bien y prêter intérêt, l’ouvrage L’Histoire des femmes en Occident, paru en 1991, piloté par Michelle Perrot et Georges Duby, et auquel œuvra Geneviève Fraisse, alors au CNRS. « Je fais partie dit-elle de ces quelques chercheuses, plutôt chanceuses à mes yeux, à qui on reconnut le droit de faire un travail de la pensée qu’aujourd’hui encore j’appellerais “question des sexes”. Tant pis pour le “genre”, trop “cache-sexe” justement »[2].
Ses allers-retours entre recherche et politique sont rappelés avec l’ironie méritée : « les socialistes revenus au pouvoir s’inquiétèrent d’avoir “oublié” les femmes. Ce n’était pas la première fois. Ils résolurent le problème par une demi-mesure, en pêchant une personne de la société civile, féministe, engagée, en me nommant déléguée interministérielle aux Droits des femmes (…). Si j’ai dit « oui », après avoir dit « non », ce fut par souci de cohérence intime et publique(…) c’est une chance, et une fierté d’avoir suivi ces deux chemins du savoir et du faire(…) l’image de l’engagement – ajoute-t-elle – me parait moins intéressante que celle de la dialectique concentrée entre théorie et pratique ». Et l’autrice rappelle son accord lorsque les communistes lui proposèrent d’être « le numéro deux » (femme – féministe – société civile) de leur liste « ouverte » pour les élections européennes de 1999 ».
Le consentement, une question philosophique
Mais, venons-en au consentement, qui « s’est imposé comme un mot clé ». « En matière de liberté ou d’égalité des sexes, il faut clamer son opinion, pour ou contre, pour donner ensuite ses raisons (…) tant l’affect marque l’histoire sexuelle. Je préfère, pour ma part, une autre méthode, mettre de côté mon opinion, sans lâcheté, et trouver la bonne question (…). Au moment de la parité, j’avais ainsi séparé la question du « pouvoir » des femmes (de leur absence de pouvoir) entre les deux concepts de « gouverner » et de « représenter » ; de même dans le débat sur le port du foulard ou sur la vente du sexe, le mot de « consentement » m’est apparu comme l’axe autour duquel tournait le problème. Partir d’un mot comme du nœud qu’il faut défaire, c’est une façon d’apprivoiser la dispute (…). C’est exprès que je mets ensemble deux revendications fondées sur le consentement, et tout à fait opposées, voire contradictoires : voiler ou dévoiler son corps, protéger ou exposer son sexe, (…) rapprocher ces deux débats, c’est déjà éliminer quelques obstacles, la question religieuse et la question morale. Ce travail sur le consentement m’entraîne, désormais, dans la pensée du lien (…) il faut bien reconnaître qu’on s’y perd, dans ce lien, dans la recherche du consentement, d’un “sentir ensemble”. Par-là, commence, ainsi, la construction d’un monde ». « Alors j’ai pris ce mot comme une question philosophique (qui) se manifeste comme un objet de discussion que l’on tourne et retourne, sorte de cube où les diverses faces racontent chacune une histoire ».
Filant la métaphore du cube, Geneviève Fraisse tourne et retourne ces facettes : les vertus du consentement (dont pure liberté et rapport de force), ses défauts (dont « se soumettre » est-ce consentir ?), ses ambitions (l’évolution des femmes de l’hétéronomie à l’autonomie et à « mon corps m’appartient »), sa misère et son refus. Ces analyses sont si complexes que je ne saurai en rendre compte véritablement, mais je retiens évidemment dans la fin du texte : « c’est pourquoi, parce qu’il y a du corps, parce qu’il y a de l’histoire et que la frontière est problématique, je pense qu’aucune politique du consentement ne peut s’énoncer comme tel »[3].
« Quoi de plus estimable que le consentement d’une personne ? », énonce donc le texte de 2008, qui aussitôt précise que le mot peut clore « la discussion politique en la réduisant à une affaire individuelle respectable. Que faire de ce mot qui fait la dignité de l’individu démocratique et dont pourtant la juridiction internationale, à commencer par l’ONU, cherche désormais à se défaire ? Tel est en effet le point de départ de ce livre » Geneviève Fraisse indiquant que, dans la convention internationale de Palerme, le protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, « déclare que le consentement d’une personne est “indifférent”, hors de propos, “irrelevant” dit la langue anglaise, c’est-à-dire sans pertinence ».
L’épilogue du livre, terminé en mai 2017, n’évoque évidemment pas les violentes polémiques actuelles sur les agressions sexuelles, mais on peut lire son opinion dans une interview de Télérama ayant trait à ce livre (01/11/17), sous le titre « les femmes font corps » : « L’affaire Wenstein raconte enfin combien le corps des femmes reste à la disposition des hommes (…) cet acte collectif, qui traverse les continents, rend la domination masculine visible », et Geneviève balaie la question de la galanterie et du puritanisme. « Mais ce sont des cache-sexes pour ne pas parler du fond, et surtout pour faire l’impasse sur la question de l’égalité ! Et puis qui peut croire qu’il n’y aura un jour que de la transparence dans les relations humaines liées à la libido et au désir ? »
« Quand une femme dit non, c’est non »
C’est sur cette histoire du refus de consentir et de la mise en question de la hiérarchie sexuelle que se termine le livre. Sous le rappel du slogan féministe « quand une femme dit non, c’est non », et que la répétition du non ne suffit pas toujours, l’autrice déroule l’histoire du oui et du non au travers de celle du mariage et du divorce, des refus de s’inscrire dans la « loi des hommes » (Louise Michel, Hubertine Auclert), les refus du sexe (de Lysistrata aux Marginales de Virginia Woolf, à Valérie Solanas et la mise en cause de l’hétérosexualité). « Car, ce qui se donne à voir dans la brève lignée indiquée ci-dessus, c’est moins une avancée historique qu’un déplacement dans l’espace ».
Suivons Geneviève Fraisse, si philosopher peut nous aider à « apprivoiser les disputes », il est en effet grand temps de philosopher davantage !
[1] Geneviève Fraisse, Du consentement, Paris, éd. du Seuil, 2007, 144 p.
[2] V. à ce sujet Geneviève Fraisse, À côté du genre, Lormont, éditions Le bord de l’eau, 2010, 400 p.
[3] Cette question du corps est à l’origine de ma rencontre avec Geneviève Fraisse qui a accepté, en 1998, de préfacer Sports, école, société : la différence des sexes (Annick Davisse, Catherine Louveau, éd. L’Harmattan, 1998, 342 p.), ainsi titré en référence à son ouvrage qui, bien que « petit », lui aussi (moins de cent pages), doit être lu et relu.





