Avec Antonio Gramsci, Une pensée révolutionnaire (Connaissances et savoirs, 2016, 593 pages, 26,95 euros), le philosophe Jacques Ducol livre une introduction pédagogique et stimulante aux concepts et combats du théoricien communiste italien.
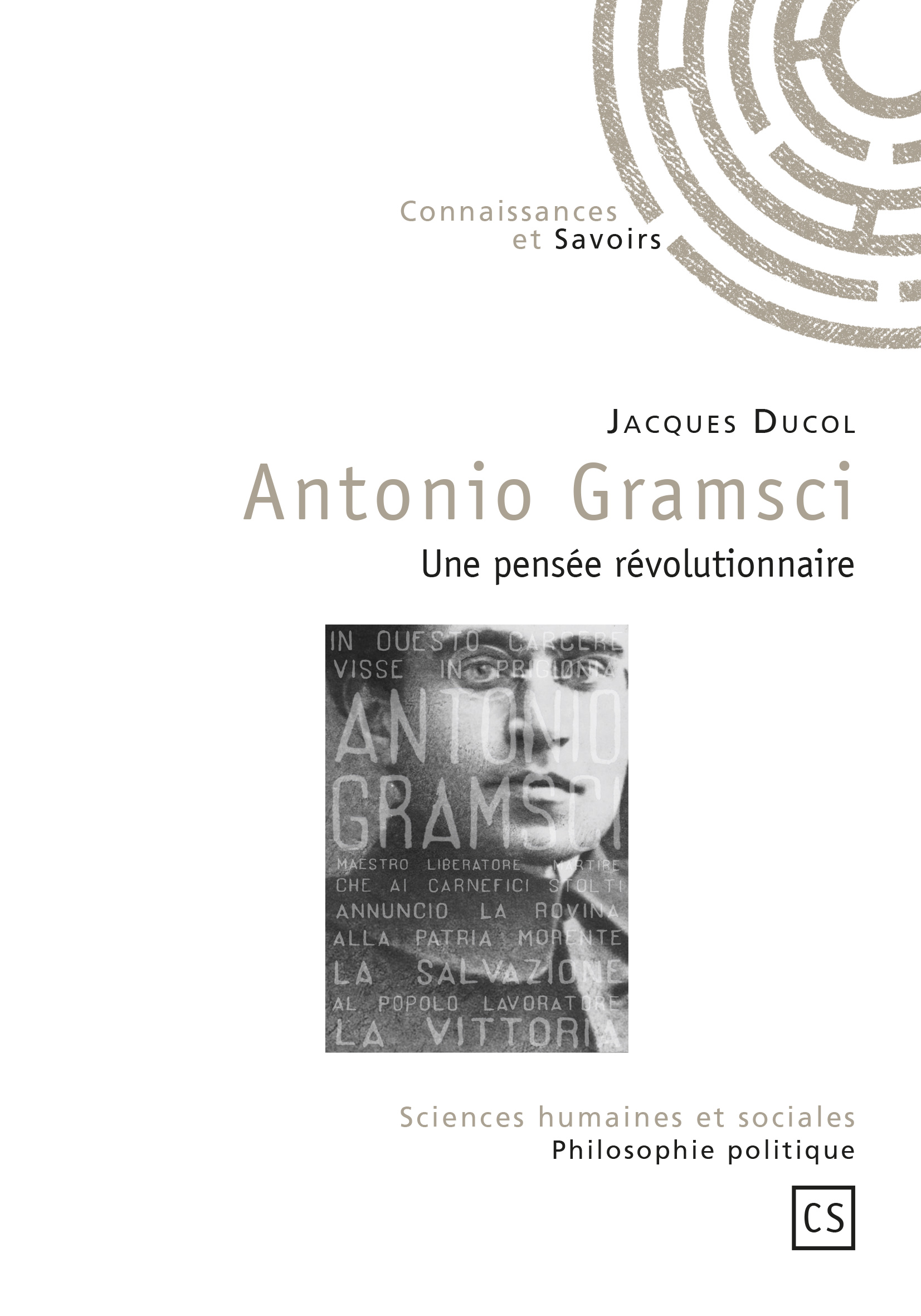 Référence revendiquée de nos jours, entre autres, par Podemos en Espagne ou par l’égérie du « populisme de gauche », Chantal Mouffe, le co-fondateur du Parti communiste italien, Antonio Gramsci (1891-1937), connaît incontestablement un regain d’intérêt
Référence revendiquée de nos jours, entre autres, par Podemos en Espagne ou par l’égérie du « populisme de gauche », Chantal Mouffe, le co-fondateur du Parti communiste italien, Antonio Gramsci (1891-1937), connaît incontestablement un regain d’intérêt
L’ouvrage que lui consacre le philosophe Jacques Ducol n’a certes pas pour objet d’évaluer la légitimité des différents usages qui en sont faits aujourd’hui. Mais il fournit des outils précieux pour une telle entreprise en proposant une excellente synthèse des concepts et des combats de Gramsci. La notion d’« hégémonie du prolétariat » est particulièrement bien explicitée. L’auteur rappelle ce qu’elle doit à Lénine, qui l’utilise pour la première fois dans le contexte de la révolution russe de 1905. C’est en effet dans son essai intitulé Deux tactiques de la social-démocratie dans la révolution démocratique[1], paru cette même année, que le terme d’hégémonie est employé pour la première fois. Jacques Ducol cite le fameux passage : « L’issue de la révolution dépend de ceci : la classe ouvrière jouera-t-elle le rôle d’un auxiliaire de la bourgeoisie, auxiliaire puissant par l’assaut qu’il livre à l’autocratie, mais impuissant politiquement, ou jouera-t-elle un rôle hégémonique dans la révolution populaire ? ».
Autrement dit, la classe ouvrière sera-t-elle en mesure de s’allier d’autres groupes, en l’occurrence, dans l’esprit du Lénine d’alors, la paysannerie ?
La nécessité pour la classe ouvrière d’être «dominante des classes adverses»
Et l’on pressent donc, ici, déjà, ce qui sera le cœur de l’hégémonie gramscienne, à savoir la conscience aigüe de la nécessité, pour la classe ouvrière, d’être autant « dirigeante des classes alliées » que « dominante des classes adverses ».
Aussi, le passage de la notion de « dictature du prolétariat » à celle d’« hégémonie du prolétariat » apparaît bien, non comme un renoncement à penser le moment coercitif de la révolution, mais comme l’insertion de celui-ci dans une approche beaucoup plus large et sophistiquée.
Quoi qu’il en soit, les rappels effectués par l’auteur s’avèrent fort utiles face aux relectures de Gramsci qui, telle celle opérée par le « populisme de gauche » de Mouffe, tendent à relativiser l’importance que le théoricien italien accordait aux classes sociales et à l’exercice du pouvoir politique et, partant, à rabattre l’hégémonie sur la seule dimension culturelle[2].
En lisant le présent ouvrage, on est conduit à considérer que pour Gramsci, loin d’en limiter la portée, la dimension de classe du projet de transformation révolutionnaire de la société est la condition de sa pleine réalisation, contre les tentatives d’annihilation bureaucratique dont elle peut faire l’objet.
C’est du moins ce qui transparaît à travers l’évocation de l’expérience autogestionnaire des conseils d’usine de Turin (1919-1920), auxquels Gramsci prit une part active.
La dictature du prolétariat: dictature d’une classe et non celle d’un parti
« Pour Gramsci, la dictature du prolétariat est la dictature d’une classe, en aucun cas celle d’un parti, quand bien même ce parti représenterait véritablement les intérêts de cette classe. C’est pourquoi il lui semble essentiel que le Conseil d’usine soit élu directement par tous les travailleurs, syndiqués ou non, membres du Parti ou non, afin que les ouvriers, en tant que classe, assument pleinement leur fonction dirigeante et dominante, la fonction historique qui leur incombe en tant que producteurs », analyse Jacques Ducol. Et il poursuit : « Car c’est bien d’abord sur le lieu de production que doit se construire le processus révolutionnaire par lequel tous les ouvriers, tous les employés, tous les techniciens, tous les ingénieurs, ainsi que tous les paysans, à court terme tous les éléments actifs de la société, passeront de l’état de simples exécutants à celui de dirigeants du processus de production, de l’état de simples rouages dociles du système capitaliste à celui de sujets conscients maîtrisant librement leur propre avenir ».
Jacques Ducol établit par ailleurs lui-même quelques liens stimulants avec l’époque actuelle. « Les conseils d’usine nous disent toujours qu’aucune transformation révolutionnaire n’est possible si les producteurs directs ne sont pas maîtres de leurs outils de production, s’ils n’imposent pas l’idée que l’objectif premier de l’entreprise n’est pas le profit privé, mais la satisfaction des besoins qui naissent du développement de la vie sociale », souligne-t-il.
De nombreuses pages sont aussi consacrées à situer le théoricien politique italien par rapport aux débats internes de son parti, en lien avec les orientations de l’Internationale communiste. Alors que celle-ci décide, en 1928-1929, que les partis communistes doivent abandonner la stratégie du front unique, Gramsci, du fond de la prison où le régime mussolinien l’a jeté, n’a de cesse de défendre l’alliance de tous les antifascistes et de porter son mot d’ordre d’une constituante.
On lira également avec beaucoup d’intérêt les développements sur la vision gramscienne de l’éducation, de la liberté et de la discipline. Notamment à travers la correspondance de Gramsci avec sa femme, Julia. Jacques Ducol expose les tenants et aboutissants d’une certaine critique des formes d’éducation « trop permissives », oublieuses du fait que, selon les mots de Gramsci, « l’homme n’est que formation historique », c’est-à-dire une construction, une création supposant discipline.
Voici donc un livre riche, qui permet d’aborder par différentes portes la pensée, pour une large part toujours actuelle, du co-fondateur du Parti communiste italien.





