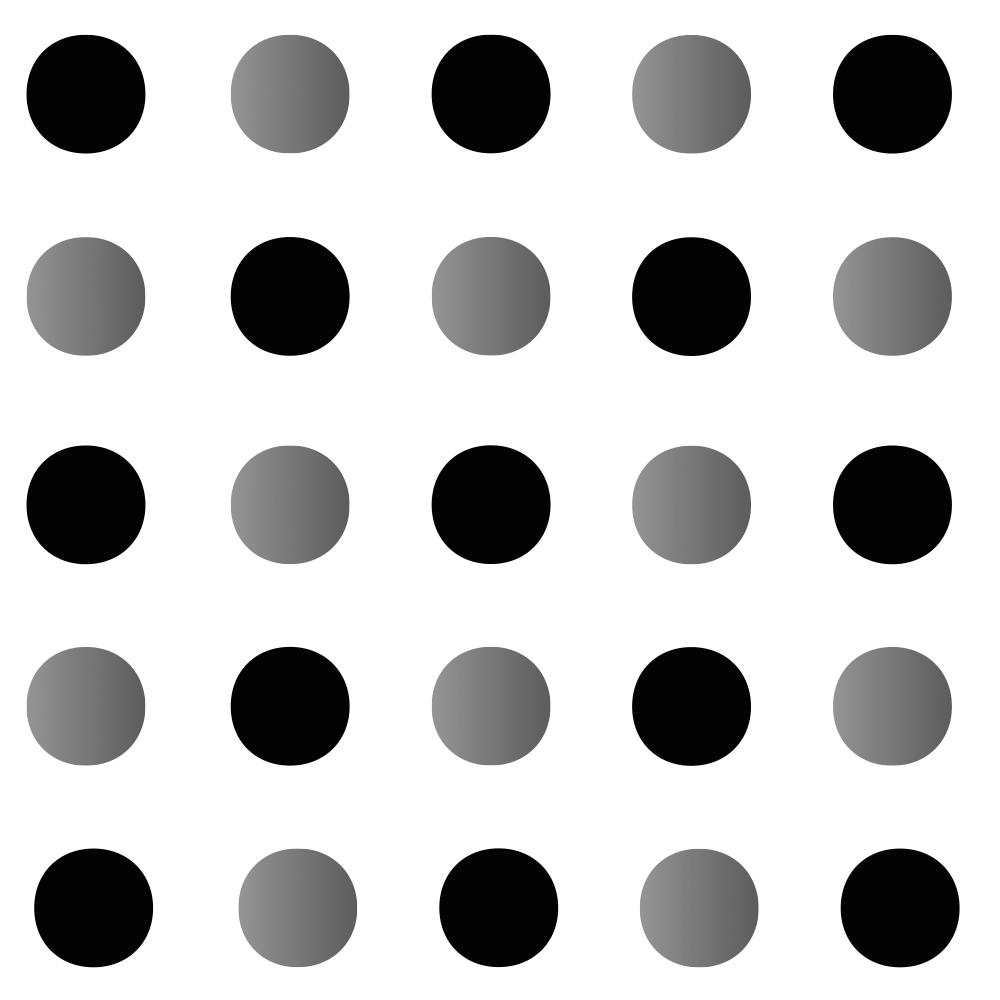Laurent Etre
Rédacteur en chef adjoint de La Pensée et journaliste à l’Humanité
Pour l’heure, l’impact du numérique sur le travail se traduit par une flexibilité accrue pour les salariés. Mais est-ce l’effet des technologies elles-mêmes ou bien plutôt des rapports de production capitalistes, dans le cadre desquels elles sont introduites ? Pour un usage du numérique tourné vers l’émancipation humaine, quelle articulation entre les initiatives citoyennes et les luttes des travailleurs ?
1- Impact du numérique sur le travail
Qu’il faille s’interroger sur les moyens de « réorienter les bouleversements de la révolution numérique vers l’émancipation » suppose que l’on considère les bouleversements en question comme n’allant pas a priori dans le sens de l’émancipation.
De fait, aujourd’hui, l’impact de la révolution numérique sur le travail semble signifier d’abord, une destruction massive d’emplois et une flexibilité accrue.
Une étude des chercheurs britanniques Frey et Osborne estime que 47% des emplois aux États-Unis sont menacés par l’automatisation. Une autre, du cabinet français Roland Berger avance le chiffre de 3 millions d’emplois en France d’ici 2025. Ces chiffres, ou des estimations du même ordre, sont souvent évoqués dans le débat public[1].
Il y a cependant controverse sur l’ampleur du phénomène. Ainsi, l’économiste Michel Husson invoque une étude de l’OCDE divisant par 5 (!) les prévisions de Frey et Osborne[2].
En revanche, les conséquences de l’utilisation actuelle des Technologies de l’information et de la communication (TIC) sur les conditions de travail paraissent évidentes, avec cette flexibilité accrue dans les entreprises et la tendance à vouloir remplacer le salariat par l’auto-entreprenariat (« ubérisation »). « Macron prépare une nouvelle loi à la place des anciennes lois. Elle entérinerait le slogan des DRH dans les entreprises, repris par Mettling dans son rapport sur « le numérique et la vie au travail » :
« Promouvoir l’essaimage digital des salariés ». Essaimage ? Salarié, va-t-en, deviens auto-entrepreneur, toi qui rêves de te lancer dans la grande aventure de « l’entrepreneuriat », résumait, en octobre 2015, la Filpac-CGT dans un quatre pages intitulé « Numérique : affaire en or pour quelques-uns, choc social pour tous les autres »[3].
Dans un ouvrage récent, intitulé « Un monde meilleur? Survivre dans la société numérique »[4], le sociologue du travail Thierry Venin pointe, lui, le rôle des TIC dans le stress des cadres, à partir d’un baromètre créé par le syndicat CFE-CGC en 2001, et auquel il a ajouté un volet TIC. Il en ressort notamment qu’une majorité des cadres interrogés a un « sentiment d’alourdissement des tâches » (74%), et trouve que « les TIC génèrent trop d’informations » (86%)[5].
Pour autant, Thierry Venin relève l’absence de « rejet généralisé des techniques numériques » chez les cadres interrogés, et se défend lui-même de toute technophobie. Son souci semble être essentiellement de rééquilibrer l’appréciation des TIC : « A trop se focaliser sur leurs bénéfices (rapidité, réactivité, conquête de nouveaux marchés, etc.), on mésestime leurs effets « secondaires » néfastes », écrit-il[6].
Sur le fond, il plaide pour que la question des TIC soit abordée « en termes d’hybridation sociale et technique », et non « en termes d’adaptation des hommes aux outils »[7]. « On aurait tort de poser l’homme d’un côté et ses outils numériques de l’autre, comme si ces derniers étaient de simples instruments passifs au service des premiers et comme s’il était suffisant de se former à leur mode d’emploi pour en assurer la maîtrise. (…) Entre les geeks et les luddites [briseurs de machines, ndlr] s’ouvre l’univers de la maîtrise raisonnée des technologies de l’information et de la communication au service de l’homme dans l’entreprise et au-delà », affirme-t-il en conclusion de son ouvrage[8].
Mais cette volonté de maîtrise se heurte au fait qu’actuellement, les innovations des TIC sont appliquées à grande vitesse.
2- La recherche d’un usage des TIC tourné vers l’émancipation
a) aux marges du monde du travail «classique» (emploi)
Le philosophe Bernard Stiegler, dans son dernier ouvrage[9], estime que « la réticulation numérique (réticulation est un terme issu de la chimie, qui désigne ici le développement de réseaux – ndlr) pénètre, envahit, parasite et finalement anéantit les relations sociales à sa vitesse foudroyante, et, ce faisant, les neutralise et les annihile de l’intérieur, en les prenant de vitesse et en les phagocytant »[10]. Cependant, et contrairement à ce que le précédent propos pourrait laisser entendre, Stiegler ne rejette pas la technologie numérique en tant que telle, mais son utilisation par ceux qu’il appelle les « nouveaux barbares », tenants de « l’entreprise ultra-libérale » qui consiste en la poursuite de la révolution conservatrice du début des années 1980, et dont le cœur est la destruction de la chose publique.
Dès lors, l’alternative passerait, pour une large part, par une action avec la puissance publique, comme l’illustre le projet d’économie contributive engagé avec Plaine commune[11], visant à « créer un territoire apprenant dont les habitants ne sont plus seulement consommateurs mais prescripteurs de services numériques »[12].
Est cependant évacuée la question de la technologie numérique dans l’entreprise. Du moins, elle n’est pas traitée spécifiquement, en lien avec l’analyse des rapports sociaux de production.
Bernard Stiegler distingue emploi et travail. « Dans l’emploi d’aujourd’hui, le travailleur est dépossédé de son savoir-faire », explique-t-il[13]. Face à cette réalité, les ressources sont dans le travail, qui « permet de dé-sautomatiser un système automatique ».
Mais, dans cette approche, le travail n’est pas derrière l’emploi, en tension avec lui, ce qui supposerait alors d’investir prioritairement la conflictualité sociale qui se noue dans les rapports de production, tels qu’ils sont massivement déterminés aujourd’hui par la logique de rentabilité capitaliste. L’emploi est réduit à un processus unilatéral de prolétarisation. Et celui-ci, défini précisément par Stiegler comme « perte de savoir », ne relève plus spécifiquement d’un certain rapport social de production, de l’exploitation de la force de travail par le capitaliste. Il a davantage à voir avec le rapport homme – machine, et touche dès lors, autant le consommateur (l’usager de l’outil numérique) que le producteur. Le travail paraît donc ici fondamentalement étranger, extérieur à l’expérience vécue par celui qui occupe un emploi.
Le travail invoqué renvoie plutôt à des expérimentations centrées sur des territoires, comme Plaine commune, en lien avec les pratiques du secteur du logiciel libre[14].
Concrètement, dans cette démarche, rien n’est proposé spécifiquement aux salariés dont les emplois sont menacés de disparition par automatisation. Surtout pas une résistance. Car le phénomène est jugé inévitable. La démarche de Bernard Stiegler s’adresse potentiellement à tout le monde, en ce qu’on est tous pris d’une façon ou d’une autre dans la « réticulation numérique » évoquée ci-dessus, mais à personne en particulier. Dans le Manifeste de l’association Ars industrialis, il est question de « l’homme de la société hyperindustrielle », donc aussi bien le propriétaire des moyens de production que le salarié.
C’est aussi aux marges du monde du travail classique, de l’emploi, qu’un sociologue, Michel Lallement, s’est lancé à la recherche d’expériences de travail émancipatrices directement issues de la culture du logiciel libre : les hackerspaces de la côte ouest américaine, en particulier celui de Noisebridge. Il s’agit de communautés de « bidouilleurs » qui prennent le travail comme une fin en soi (le « faire »), et fabriquent pour leur plaisir de petits objets en utilisant machine-outils et outils numériques derniers cris.
Des expériences riches en enseignements, mais Michel Lallement le reconnaît lui-même : « peu de hackers qui fréquentent Noisebridge ou les autres espaces de la baie peuvent se payer le luxe de vivre et de travailler à plein temps selon le modèle du faire. La grande majorité a un pied fermement posé dans un monde professionnel où pèsent les contraintes habituelles d’un travail hétéronome (projets imposés, pression de la hiérarchie et des clients, demandes fluctuantes, évaluation et concurrence…) »[15].
Autrement dit, ces expériences, qui témoignent de la possibilité d’une maîtrise des technologies orientée vers l’émancipation de leurs usagers, laissent en même temps intacte la structure du monde professionnel dominant, régi par la logique du capital. En tant que « soupape » pour des individus souvent en mal de reconnaissance professionnelle, les hackerspaces participent autant de la reproduction du système que de la recherche d’alternatives.
b- repartir des luttes des travailleurs
D’autres réflexions contemporaines sur la maîtrise des nouvelles technologies maintiennent la question de l’émancipation dans une perspective post-capitaliste elle-même ancrée dans les luttes du monde du travail.
L’historien américain des sciences et techniques, David Noble (1945-2010), inscrit ses pas dans les luttes des luddites. Dans un recueil de textes récemment traduit en français[16], il revient sur une série de luttes et de grèves des années 60-70, aux États-Unis et en Europe, dans les secteurs de l’industrie et du transport. Et il souligne que les directions d’entreprise « ont toujours utilisé le changement comme tactique pour désorienter l’opposition (…). Occupés à essayer de ne pas perdre du terrain et à se tenir à jour (et tenir le rythme) de la modernisation, les syndicats ont été obligés de se concentrer sur ce qui change (la technologie) au détriment de ce qui ne change pas (les relations de pouvoir dominantes) »[17]. Mais, dès lors, l’essentiel de son propos à l’adresse des syndicats de salariés consiste à valoriser une stratégie de résistance à l’introduction de nouvelles technologies dans les entreprises, plus qu’à s’investir dans un effort de réorientation et de maîtrise.
A l’inverse, de nos jours, le sociologue Jean Lojkine insiste sur l’appropriation de la technique par les salariés. Dans une récente tribune de l’Humanité, lui-même et le syndicaliste Jean-Luc Maletras[18] distinguent deux types d’informatisation : l’informatisation-automatisation, qui vise l’élimination du travail vivant pour augmenter les profits, et l’informatisation interactive, où l’opérateur humain reste central, avec pour objectif la qualité de la production ou du service[19].
Par un retour sur les débats et les luttes des années 1980-90 dans le domaine du contrôle aérien, autour de cet enjeu de l’informatisation, les deux auteurs montrent que les usages de la technologie dans le monde du travail, dans l’emploi, relèvent de choix économiques et politiques structurés autour de visions antagoniques de la société. La technologie est donc un enjeu de lutte à part entière pour les travailleurs.
Escamoter ce niveau, et n’aborder la question de la maîtrise de la technologie qu’à celui de la société en général, c’est passer à côté du fait que tout le monde, dans la société, n’est pas affecté de la même manière et au même degré par cette technologie.
Pour schématiser, le grand patron et le salarié le sont tous deux comme consommateurs, usagers. Mais, le salarié l’est aussi comme producteur subissant une flexibilité mise en place par sa direction au nom d’un certain usage de la technologie, présenté comme le seul usage possible alors qu’il relève d’un choix économique.
Mots-clés :
informatisation, automatisation, emploi, travail, flexibilité, bouleversements, émancipation, usages, entreprise, rapports de production, prolétarisation, logiciel libre, hackers, syndicats, luddites, technologies de l’information et de la communication, ubérisation, réticulation numérique, rapport homme-machine, B. Stiegler, J. Lojkine, D. Noble, M. Lallement, M. Husson, Thierry Venin
[1] voir par exemple : http://www.humanite.fr/bernard-stiegler-nous-devons-rendre-aux-gens-le-temps-gagne-par-lautomatisation-609824 ou : http://congres.pcf.fr/81865
[2] http://alencontre.org/laune/le-grand-bluff-de-la-robotisation.html
[3] Ce texte de la Filpac-CGT a été publié sur le blog syndicollectif:
https://syndicollectif.files.wordpress.com/2015/10/numc3a9riquelaffaire-en-or.pdf
[4] Thierry Venin, Un monde meilleur? Survivre dans la société numérique, éditions Desclée de Brouwer, 2015.
[5] Ibid., p. 178-181.
[6] Ibid., p. 323.
[7] Ibid., p. 20.
[8] Ibid., p. 324.
[9] Bernard Stiegler, Dans la disruption, Comment ne pas devenir fou?, éditions Les liens qui libèrent, 2016.
[10] Ibid., p .22-23
[11] http://francestrategie1727.fr/wp-content/uploads/2016/02/projet-plaine-commune-10.03-bernard-stiegler.pdf
[12] Entretien dans l’Humanité des débats du 17 juin : http://www.humanite.fr/bernard-stiegler-nous-devons-rendre-aux-gens-le-temps-gagne-par-lautomatisation-609824
[13] Entretien dans l’Humanité
[14] Secteur en forte croissance en France, mais qui reste tout de même très minoritaire : 50 000 emplois, cf http://www.lesechos.fr/18/11/2015/lesechos.fr/021490018237_le-marche-du-logiciel-libre-pese-4-1-milliards-en-france.htm
[15] Michel Lallement, L’âge du faire, éditions du Seuil, 2016, p. 250.
[16] David Noble ,Le progrès sans le peuple , éditions Agone, 2016.
[17] Ibid., p. 66.
[18] http://www.humanite.fr/la-revolution-scientifique-et-numerique-peut-elle-mener-une-transformation-sociale-607139
[19] Voir par ailleurs le dernier ouvrage de Jean Lojkine, La révolution informationnelle et les nouveaux mouvements sociaux, éditions Le bord de l’eau, p. 20-21.