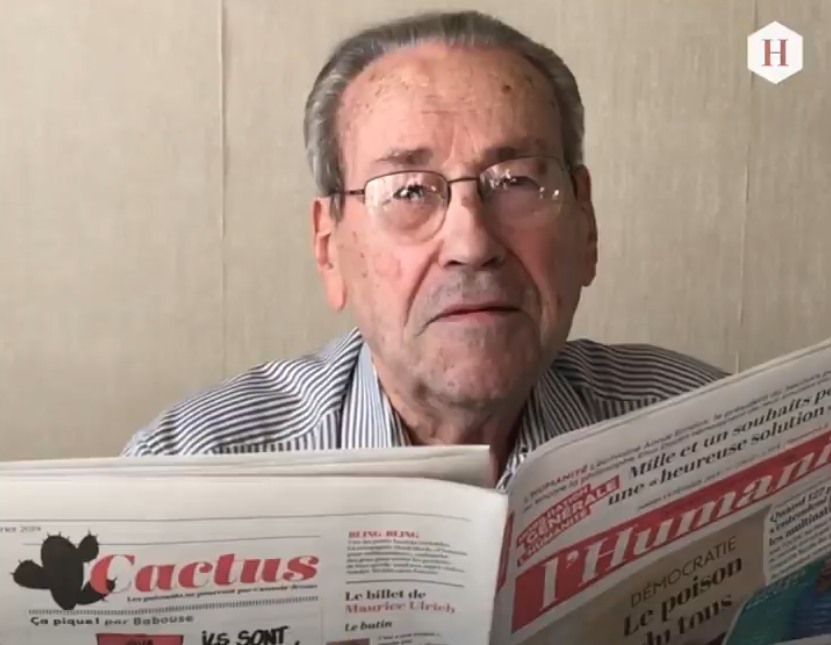Nous reproduisons ici des extraits d’une contribution que le philosophe Lucien Sève livra en novembre 2002 lors d’un colloque organisé par l’OMOS (Observatoire des Mouvements de la Société). Rédigée il y a près d’un quart de siècle, on ne peut qu’être frappé à sa lecture par la pertinence et l’actualité de bien des constats critiques sur l’état des médias et sur la nécessaire, mais défaillante, contre-offensive des forces démocratiques. Les enjeux auxquels nous sommes confrontés ont donc des racines profondes. Lucien Sève propose une étude de l’idéologie dominante par ses médias, et invite les militants à travailler avec les journalistes pour doter le peuple d’outils médiatiques véritablement démocratiques. Merci à Jean Sève d’avoir bien voulu nous autoriser à reproduire cette note.
C’est sans compétence particulière mais avec une motivation intense que, regrettant de ne pouvoir participer à la journée d’étude organisée par l’Observatoire des mouvements de la société samedi 23 novembre, je rédige cette note à la demande de Patrice Leclerc.
(…) Si je parle de motivation intense à dire mon mot dans la réflexion opportunément engagée par l’Observatoire, c’est pour une raison majeure. Cette raison majeure est que la critique de l’idéologie dominante est à la source même de la prise de conscience révolutionnaire. Que dans le cheminement de Marx et d’Engels, le travail sur L’Idéologie allemande prélude directement à la rédaction du Manifeste du parti communiste illustre bien cette logique profonde. Ce disant, je ne veux bien entendu pas rabattre la question des médias sur celle de l’idéologie, ni réciproquement-, mais pour embrouillés que soient leurs rapports, ils m’apparaissent toujours fondamentaux, sans doute même sont-ils plus intimes aujourd’hui qu’ils ne l’ont jamais été. Aussi bien le thème de la journée d’études est-il heureusement intitulé «Représentations mentales et médias»: voilà en effet le point central, je pense. Dans Commencer par les fins – la nouvelle question communiste, j’ai cru devoir consacrer tout un développement à ce que j’y appelle «la décisive bataille de la représentation». Décisive, elle l’est de fondation, si l’on peut dire: nous ne devrions jamais perdre de vue que, dans les grandes désaliénations historiques en quoi consiste le «mouvement réel» du communisme tel que le pense Marx, celle de la conscience sociale a toujours occupé pour lui une place centrale. Je tiens qu’elle l’est bien davantage encore aujourd’hui, pour un ensemble de raisons qu’il importe d’inventorier.
Sur la révolution médiatique
Raisons socio-techniques, naturellement: nous vivons une «révolution informationnelle» où l’irruption au sommet de l’informatique ne doit pas faire perdre de vue celle de l’informatif; une «révolution biographique» aussi, où la force de travail elle-même est largement devenue une force de savoir, et avec le savoir c’est tout l’univers du symbolique qui nous pénètre. Mais aussi et davantage encore, je dis cela de façon certes beaucoup trop rapide, raisons historico-politiques: non seulement la puissance étatique de classe et les réseaux de pouvoir qui irriguent toute la formation sociale, mais la domination du capital dans l’entreprise et les services opèrent de plus en plus sur la représentation, laquelle est devenue pour les forces dominantes plus même qu’un «nouveau domaine de lutte» : le mode privilégié du pouvoir, dans de nouveaux rapports avec les pérennes violences régaliennes– militaire, policière, judiciaire… Irait-on au fond même du formidable développement des médias si on l’analysait en termes purement économico-financiers? Question de portée stratégique pour la réflexion qu’il s’agit d’engager. Quant à moi, ma réponse est négative: on manque le plus essentiel si on n’en vient pas à la signification historique de classe de ce qui sans aucun doute est une gigantesque affaire, mais une affaire riche de sens historico-politique par-delà sa cotation boursière. Découpant depuis des années tout article me tombant sous la main qui traite d’un aspect quelconque de la question, je pourrais faire ici bien des citations instructives. Je me bornerai à celle-ci: porte-parole de l’OTAN, Jamie Shea explique (Le Monde, 10 juin 2000) que depuis la guerre du Kosovo «l’OTAN considère que réussir la campagne de communication est devenu presque plus important que la campagne militaire». Devant des assertions de cette sorte, il me semble flagrant qu’est bien trop courte la dichotomie entre médias considérés comme de simples moyens et contenus idéologiques pris comme fins, les deux choses étant tenues pour indépendantes, sur le modèle de la distinction banalisée entre hardware et software. Ici aussi me parait indispensable la dialectique souvent travaillée par Marx de la fin et du moyen, incluant la détermination réciproque et le renversement des rapports.
Carences des forces de gauche sur leur analyse des médias
L’évident en tout cas est l’importance gigantesque acquise au fil des toutes dernières décennies par la question des médias – j’entends donc par là non point seulement l’ensemble impressionnant des outils de la «communication» mais, inséparablement, celui, non moins impressionnant, des opérations affectant nos manières de nous représenter le monde et nous-mêmes. Et si peu qu’on y prête attention, on ne peut à mon sens qu’être impressionné tout autant, pour le moins, par la fantastique carence – je suis prêt à nuancer le propos, non à le minorer sur le fond – que manifestent à cet égard, prises globalement, les «organisations révolutionnaires», les «forces de radicalité» françaises – j’ai l’impression qu’il ne s’agit pas hélas que des françaises, mais je ne suis pas assez au courant de ce qui se fait ou non dans d’autres pays pour me permettre de les y associer -, carence aussi bien en matière d’étude critique que d’initiative politique (…). Je ne crois pas qu’il y ait beaucoup de domaines où le contraste soit aussi fabuleux entre l’ampleur des transformations historiques qui s’opèrent sous nos yeux, (…) et l’invraisemblable faiblesse de réaction théorique comme pratique manifestée, à bien peu d’exceptions près d’ailleurs limitées elles-mêmes, du côté de celles et ceux qui se flattent de combattre le capitalisme, Je suis foncièrement convaincu que la chose tient à infiniment plus que la modicité – réelle – des moyens d’intervention dont nous disposons. Elle met en cause une passivité théorico-critique profonde et de façon connexe une incapacité non moins profonde à l’initiative stratégique ambitieuse, laquelle est parfaitement possible à une force toute petite – c’est même comme ça qu’on grandit…
[Lucien Sève esquisse alors une réflexion sur l’action nécessaire dans un domaine qu’il juge «essentiellement un domaine de lutte», en espérant qu’il ne s’agisse pas d’objectifs sans lendemain, «l’absence de suivi observable un peu partout tue toute vraie construction», et permette «l’engagement d’un processus susceptible de déboucher à terme raisonnable sur des entreprises culturalo-politiques de réelle ampleur»… «commençant à s’attaquer pour de bon à la totale aliénation de ce pouvoir politique par rapport aux citoyens-usagers qui sont en même temps ses co-financiers»].La publicité est-elle un média ?
Dans la mesure où on est toutefois contraint de sérier un temps les questions pour les considérer en détail, quelques remarques et interrogations d’abord sur le nécessaire effort de connaissance critique (…) Je lis par exemple des articles où l’on énumère cinq grands médias: la presse écrite, l’audiovisuel, le cinéma, la publicité, Internet. Rien qu’à considérer une telle liste, on voit affluer les problèmes de fond. Par exemple: la publicité. Est-elle bien un média au même titre que la presse, la télévision ou Internet? N’est-ce pas plutôt une activité recourant pour une grande part à ces médias? Pour autant, sa présence dans la liste citée n’est-elle pas à maints titres justifiée, quand on songe notamment au rôle proprement capital qu’elle joue dans la métamorphose contemporaine des médias qu’elle investit. Sauf erreur, le budget annuel mondial de la publicité est de l’ordre de mille milliards de dollars, soit un peu plus que le total des budgets militaires annuels de tous les pays: peut-on mieux suggérer que la publicité est aussi à sa façon une guerre poursuivie par d’autres moyens? Et pas seulement une guerre commerciale, comme il est d’usage de dire. Le rôle que la publicité s’est mise à jouer dans le pilotage culturel des représentations (…) qui marque à mes yeux la totale inséparabilité de ces deux aspects des choses: les médias en tant que moyens formels, naïvement supposés neutres, et en tant qu’opérateurs de contenu, si manifestement sous-tendus par ce que Lucien Bonnafé appelle «d’idéologie immensément dominante».
Malheurs de la télévision publique
En même temps que la connaissance factuelle de l’empire des médias, est à mener l’analyse critique aussi pénétrante que possible de leur modus operandi, j’entends par là tout à la fois les formes de leurs contenus et les contenus de leurs formes. J’ai évoqué plus haut l’exemple – je le tiens pour très important, mais il y a bien d’autres activités médiatiques très importantes… – du traitement de l’information par les chaînes de télévision publique. Pour ma part j’ai fait le choix de suivre en permanence les informations de France 2 (parce que je suis, comme beaucoup, très attaché à l’existence même d’une télé publique, et que je trouve donc crucial d’être particulièrement attentif à la manière dont elle s’acquitte ou non de son mandat): or il y aurait un livre à écrire sur ce sujet. Comment par exemple, de façon absolument systématique et d’évidence réfléchie, l’information politique est à la fois renfermée dans la vision la plus étroite du politique, concassée à un point difficilement croyable et parsemée à travers un patchwork de faits divers (un déluge de catastrophes «naturelles», d’accidents, de drames quotidiens), de sujets magazine d’une futilité parfois confondante, et en même temps vicelardement refilée à travers tout ça, mine de rien, sous la forme de commentaires d’«experts», d’interviews choisies, d’images «irréfutables»… En somme, aucune différence de nature avec les chaines privées (…)
Une manipulation de bonne conscience
Et voici qui m’amène à donner mon opinion sur une phrase de l’argumentaire de cette journée d’études. «II ne s’agit pas, lit-on, de “diaboliser” les médias, en attribuant à ceux qui les font une volonté ou un pouvoir de manipulation qu’ils n’ont pas» (…) Est-ce à dire que les médias d’aujourd‘hui n’auraient donc ni volonté ni pouvoir de manipulation? Franchement, cela me semble nier l’évidence. Car on peut parfaitement se comporter en manipulateur avec «bonne conscience», c’est-à-dire avec une conscience de ce qu’on fait de l’intérieur d’une idéologie non critiquée, je pense celui qui pense autrement, comme ne valant pas ce qu’exigerait une éthique intransigeante des médias, scrupuleux respect en toute circonstance du pluralisme critique, de la vigilance épistémologique, du contrôle démocratique… Nous vivons en permanence désormais cette hégémonie à la fois tranquille et brutale en toute impunité de «l’idéologie immensément dominante». Exemples? On n’a que l’embarras du choix. Disons: comment France 2 (avec à peu près tous les médias) a présenté durant des semestres et de manière obsédante le dossier des retraites – une fatalité démographique imposant le tiercé cotisation accrue/départ retardé/prestation réduite. Je dis, faits en main, que cette chaîne publique s’est livrée ã une authentique campagne, d’une rare partialité tant directe que sournoise, en faveur de cette représentation des choses. Autre exemple: l’inflation brutale, systématique, délibérée, sur toutes les chaines – et, fait rare et précieux, attestée par maints journalistes – du traitement médiatique de l’insécurité (…) Des exemples semblables, on en peut donner des dizaines, d’aussi gros ou plus encore, et aussi bien de plus subtils, où le travail sur nos représentations ne paraît avoir aucune visée politique directe mais n’en dessine pas moins jour après jour une fabuleuse manipulation de civilisation, touchant à tous les domaines de notre vie mentale, sociale, morale… II faudrait par exemple analyser systématiquement sous ce rapport les formes de contenus et contenus de formes de l’actuelle pub-télé : effarement garanti.
Absence de contrôle démocratique sur les médias
Soutenir cela, est-ce revenir quoi qu’on en ait au vieux fantasme de personnification de La Bourgeoisie instrumentalisant cyniquement Les Médias avec la complicité de leurs acteurs? Je prétends que pas du tout. C’est, de manière bien différente, prendre au sérieux l’idée que se sont réellement développés dans ces toutes dernières décennies les éléments d’un «quatrième pouvoir», dont la puissance est désormais largement comparable à celle des trois autres; comme l’écrit le sociologue Cyrille Lemieux dans son livre Mauvaise presse (Métailié, Paris, 2000) – un livre pourtant limité à mes yeux dans l’examen vraiment critique -, la «pression susceptible d’être exercée par les médias sur l’ensemble des secteurs sociaux», leur «pouvoir d’immixtion» est devenu «rapidement sans précédent» (p.57 et 60). Or ce pouvoir s’est formé, pour autant que je sache, à travers un mixte d’autonomie: la fameuse indépendance de la presse et du journaliste, que notre vision fantasmée des choses méconnaissait totalement, alors qu’elle demeure une réalité bien vivace, et d’hétéronomie: la fondamentale et fondatrice dépendance envers l’argent – avec un accroissement énorme de cette dépendance dans la formation d’empires médiatiques et son redoublement par une dépendance envers le pouvoir politique avec l’émergence de la télévision. Le résultat de cette histoire, sauf erreur, est que ne s’est jamais formé le moindre contrôle démocratique – et à plus forte raison participatif – du pouvoir médiatique par l’ensemble de ses assujettis: rien d’équivalent au suffrage universel et à l’activité parlementaire dans la vie politique, à l’élection des juges et au jury populaire dans la pratique de la justice, au droit prud’homal et à l’activité syndicale par rapport au pouvoir du capital. Le rapport des médias avec leur public est d’origine un rapport marchand: la vente du journal, rapport qui a pris aujourd’hui la proportion colossale de l’Audimat. Là me semble être la racine de l’aliénation médiatique, directement parente de l’aliénation économique dans la société bourgeoise.
On parait souvent croire que du moins une régulation comme celle par l’Audimat assure un certain pouvoir des usagers, fût-il d’essence marchande, sur la prestation médiatique. C’est là, je pense, le type même de l’illusion aujourd’hui florissante dans le reflux de la culture politico-sociale critique, car l’Audimat met strictement sur le même plan vision critique et consommation aliénée de la prestation télévisuelle. Et voici justement le moment de revenir au rôle profond de la publicité dans l’activité médiatique actuelle. Si le capital pris globalement investit des sommes proprement colossales dans la publicité, la raison majeure va infiniment au-delà de la traditionnelle compétition concurrentielle entre firmes: il s’agit bien davantage de la maximisation du taux de profit pour l’ensemble des marques. Alors que l’activité marchande classique consiste à adapter l’offre à la demande solvable, la publicité n’est-elle pas désormais de plus en plus la formidable entreprise qui consiste à adapter la demande à l’offre rentable? Parfait exemple de cette logique d’inversion si perspicacement diagnostiquée par Marx comme essentielle au capitalisme. Le fameux «Parce que je le vaux bien! » pourrait être la devise de ce formidable renversement, celui même de la personne â la chose.
Et n’est-ce pas cette logique d’inversion qui s’empare progressivement de toute la prestation médiatique elle-même? Comme la pub elle-même, le discours audiovisuel, pour le distinguer ici, ne passe-t-il pas sans cesse impunément, avec son éthique démocratique minimale, du faire-savoir au faire-vouloir? Ainsi entre cent autres les exemples ci-dessus. Retraites? Choisissez les fonds de pension. Délinquance? Votez sécuritaire. Ainsi de suite à longueur d’antenne. Enfermé par construction, sans vrai contrôle ni possibilité de contre, dans l’idéologie immensément dominante – qui est inséparablement représentation et incitation -, il nous la distille en permanence sans qu’il soit besoin d’un chef d’orchestre pour lui en donner consigne – ce qui n’empêche qu’il peut s’en trouver aussi… Au vieux cliché ravageur du complot journalistique, je trouve donc qu’il serait particulièrement inopportun d’en substituer un autre, démobilisateur, celui de médias sans pouvoir ni vouloir propres, cela au moment même où s’instaure une aliénation sans précédent du représentatif et du volitif. Si nous-mêmes ne contribuons pas à le rendre criant, qui le fera jamais
Pour une coopération entre initiative citoyenne et expérience professionnelle
(…) Je suis convaincu que rien de productif ne sera possible qui ne se fasse dans la plus étroite coopération possible entre initiative citoyenne et expérience professionnelle; autrement dit, le rôle des journalistes est nécessairement cardinal. Une exigence immédiate est donc à mon sens de développer les contacts avec le plus grand nombre possible de professionnels des médias – si l’on fait un effort même modeste de recensement de celles et ceux qui partagent en gros nos préoccupations, on en trouvera très aisément, je le crois, en grande abondance. Il nous faut savoir de leur bouche ce qu’ils-elles vivent, souffrent, craignent, refusent, pensent, espèrent, croient possible. Il nous faut une analyse fiable de la conjoncture, média par média. Et quel y est l’état d’esprit général de la profession afin de pouvoir tracer avec quelque pertinence les voies d’initiatives plausibles. Il me semble que des contacts systématiques, si possible même des réunions un peu prolongées d’échanges seraient hautement profitables. En même temps que l’engagement dans les inventaires critiques suggérés plus haut, telle est pour moi la tâche première pour commencer d’aller vers la conception d’une stratégie. Et peut-être serait-il judicieux d’y inscrire en premier la construction d’une véritable offensive pour une télévision publique digne de son nom : rien sans doute n’est plus urgent, et en même temps plus chargé de sens pour ce que nous visons.
Mais naturellement on peut rêver à bien d’autres objectifs, grandioses ou fort modestes. Modestes : ne devrions-nous pas nous mettre rapidement en état de dire un mot authentiquement communiste sur la question actuelle de la violence à la télévision ? (…) Plus ambitieux déjà : je nous voudrais capables de poser avec une vraie force la question du scandaleux traitement/ non-traitement de la science à la télévision; je soutiens avec conviction tous les efforts critiques qui sont faits sur la grande misère de la création (artistique) à cette même télé ; je pense cependant qu’il ne faut jamais perdre de vue ceci : la culture, c’est indissociablement art, science, politique au grand sens du mot. Unissons les forces, ne les morcelons pas. Grandiose enfin? Savoir penser et construire au XXIe siècle une stratégie communiste de désaliénation de la conscience sociale, laquelle passe pour une part déterminante par la bataille de la représentation dans les médias.