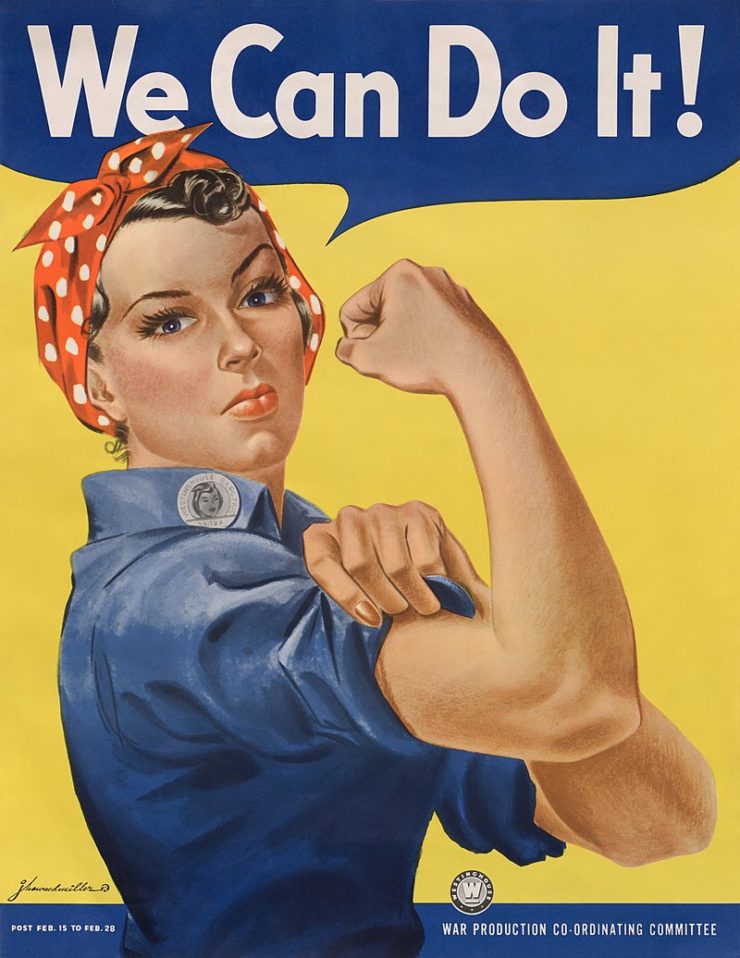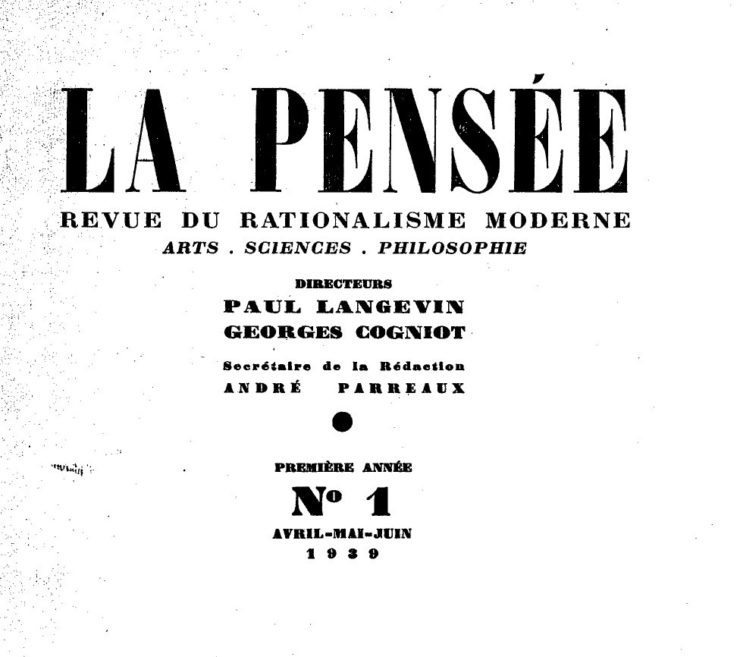émancipation
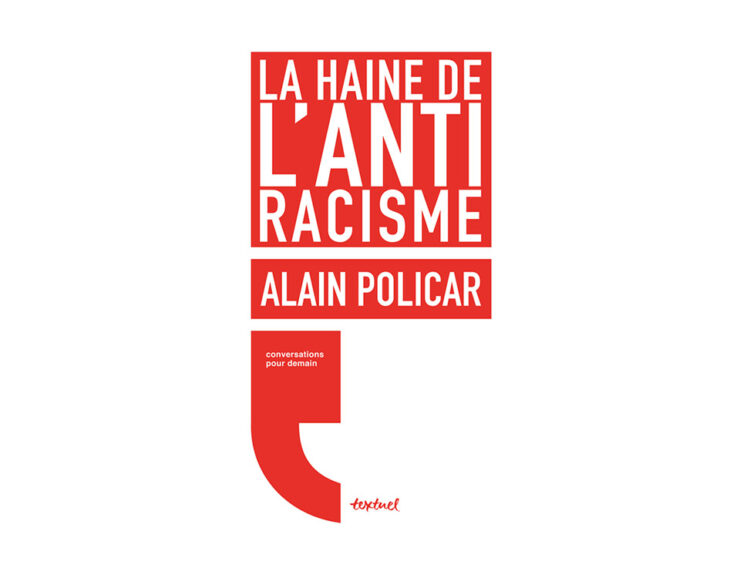
Si la question de l’articulation entre les luttes émancipatrices est aujourd’hui majoritairement posée à partir de leur hiérarchisation, c’est, d’après Alain Policar, parce qu’elle postule qu’autour de chacune de ces luttes se constituent des groupes sociaux homogènes aux intérêts antagoniques à partir d’une seule dimension de notre existence sociale…

La réalité politique nationale et l’espace-temps numérique mondial constituent deux cadres d’existence dans lesquels nous évoluons simultanément et qui entrent en confrontation. Or, si les potentialités émancipatrices existent, la reproduction de formes de domination et d’inégalités est aujourd’hui au cœur de l’information qui prend une place centrale dans ces deux espaces. Julien Chandelier nous invite ainsi à regarder en face la réalité du pouvoir et interroge notre capacité à agir à l’intérieur de ces mondes contradictoires.

S’il existe une propriété d’usage qui est une propriété utile, la propriété dominante est l’un des plus terribles outils de l’asservissement et donc un important obstacle à la démocratisation de la société. Pour conserver la première et abolir la seconde, Emmanuel Dockès a dégagé deux principes directeurs : accorder la propriété à celui ou ceux qui ont l’utilité directe de la chose et imaginer une propriété fondante, c’est-à-dire qui perd constamment un peu de valeur.
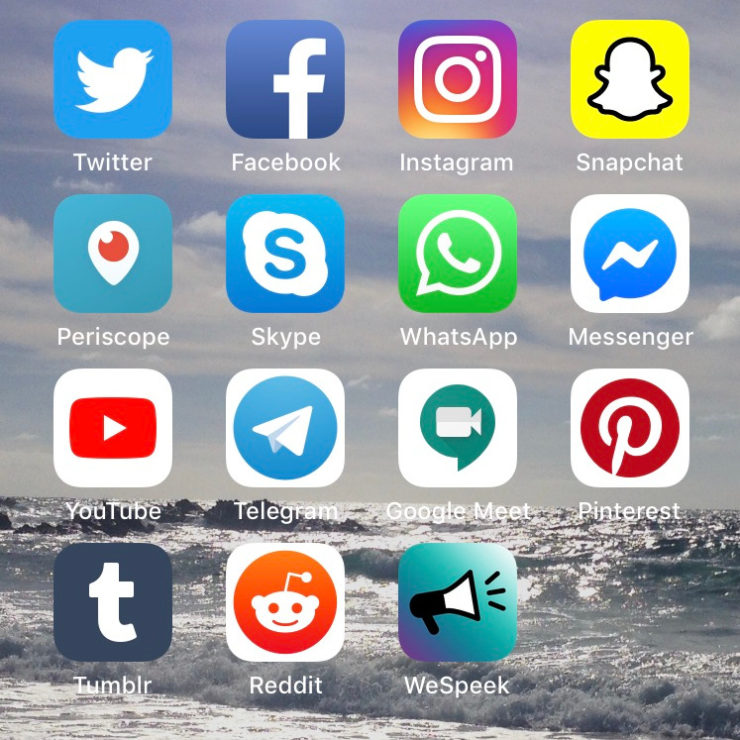
La révolution numérique bouleverse la manière de faire de la politique, les processus et lieux de politisation comme la construction des représentations et des opinions. Yann Le Pollotec revient sur les potentialités démocratiques et politiques des outils numériques tout en soulignant leurs limites à dépasser. Il insiste sur l’importance pour les militants et leur organisation de mener une stratégie numérique globale visant la conquête d’une hégémonie culturelle, condition nécessaire à une prise du pouvoir.

Cherchant à construire un citoyen émancipé et créateur, la pédagogie Freinet place au cœur de sa logique les principes de coopération, de participation et d’esprit critique. Catherine Chabrun revient ici sur le nouveau statut de l’élève et les nouveaux objectifs fixés à l’école qu’une telle pédagogie implique.

Visionnaire mais jamais appliqué, le rapport Langevin-Wallon a présenté un plan global de réforme de l’enseignement en France qui abordait de nombreuses questions toujours actuelles. Serge Wolikow revient sur le contexte de son élaboration, sur ses préconisations les plus importantes et sur les finalités qu’il donne à l’enseignement. Si ses idées-forces sont ancrées dans le monde de l’époque, elles raisonnent encore aujourd’hui et font de ce rapport une référence incontournable.