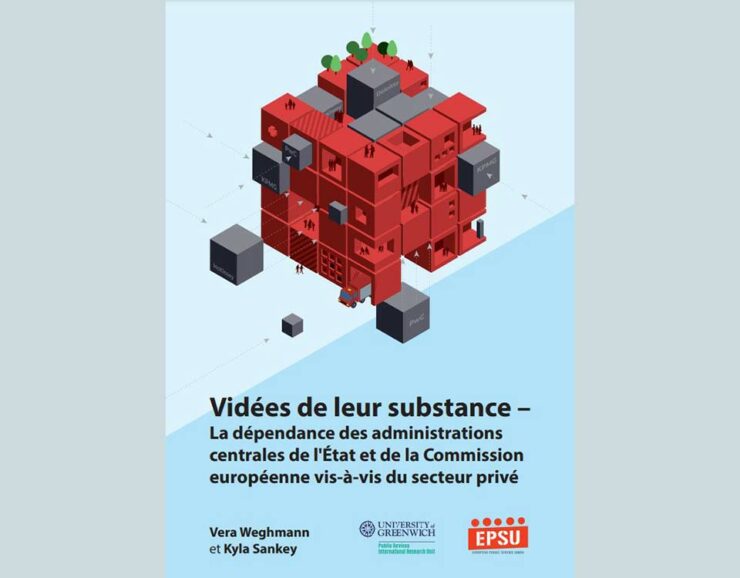Solidarité le mot semble désormais bien creux tant il a été vidé de son sens par des années d’hégémonie culturelle libérale, le réduisant à la simple charité laïque. Roland Gori, psychanalyste, et Marie-José Del Volgo, praticienne hospitalière, essayent ici de déconstruire cette vision et de redonner un sens social à ce signifiant auquel on a enlevé sa substance première.

La flambée des prix de l’énergie est le symbole le plus criant de la crise sociale due à l’inflation que traverse l’Europe. Crise dont la guerre en Ukraine serait la principale cause. Une théorie que s’attelle à démanteler Aurélien Bernier, essayiste et journaliste, spécialiste des politiques énergétiques et environnementales.

Dans cet article qui présente les premiers résultats d’une étude à paraître sur la financiarisation des soins aux personnes âgées dans six pays de l’Union européenne, Cornelia Hildebrandt et Tatiana Moutinho expliquent les mécanismes d’un processus qui a commencé dans les années 1990 et s’est accéléré dans les années 2000 dans un contexte d’absence de réglementation et de stratégie de financement durable du grand âge et de la dépendance à l’échelle européenne. Les soins aux personnes âgées sont devenus la cible de quelques grands groupes cotés en bourse qui ont tiré profit de la directive européenne sur la concurrence concernant la procédure des appels d’offre. Captant les subventions publiques alors que les établissements publics sont plongés dans de multiples difficultés notamment financières, ces sociétés de capital-investissement organisent la précarité des soins pour maximiser leurs profits.