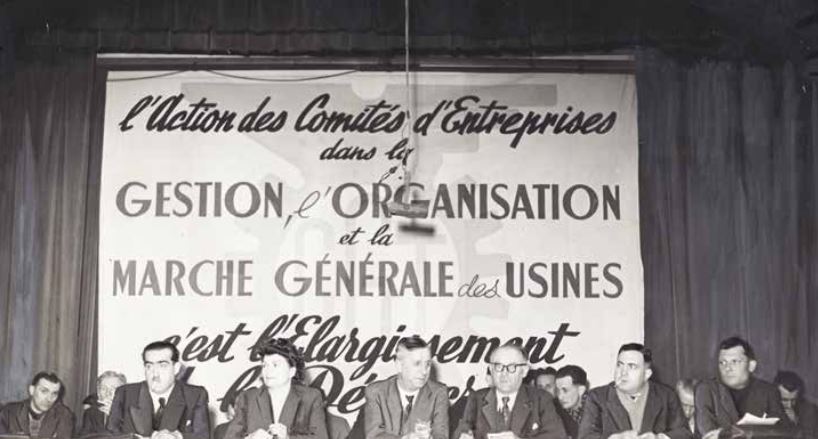syndicalisme

Avec l’essor des technologies numériques de nombreux biens et services sont désormais à portée de clic du consommateur. Dans cet article, Kristin Jesnes et Thiphaine Le Gauyer discutent la spécificité de l’implantation des plateformes numériques sur le marché du travail norvégien en s’appuyant sur le cas des coursiers employés par Foodora et subordonnés à un contrôle algorithmique de leur activité. Si la négociation occupe une place centrale comme mode de régulation des relations de travail entre salariés et employeurs en Norvège, l’arrivée des travailleurs sous statut d’« indépendants », non-soumis aux conventions collectives, déséquilibre ce compromis historique.
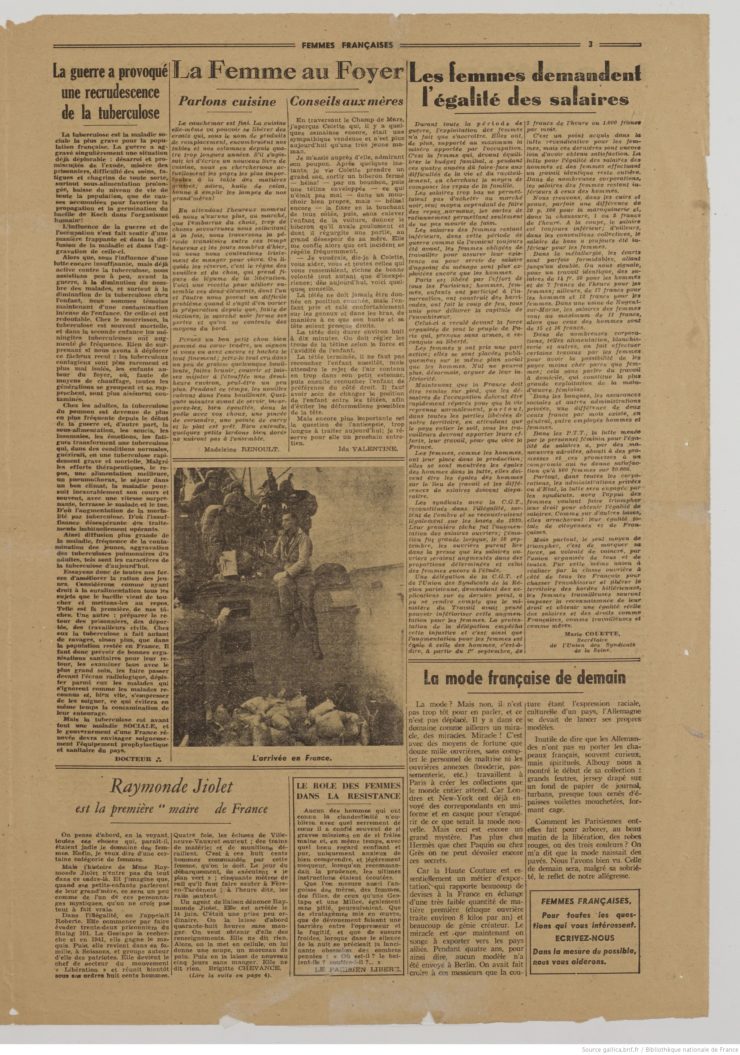
Employée aux PTT, Marie Couette (1898-1974) adhère à la CGTU dès 1924, ainsi qu’au PC, et milite pour l’égalité des salaires féminins et masculins. Résistante communiste, arrêtée en 1943, elle participe à l’Assemblée consultative provisoire (1944-1945) comme déléguée de la CGT et contribue à la création en juin 1945, à l’initiative du PCF, de l’Union des femmes française. Elle est désignée à l’autonome, secrétaire de la commission féminine confédérale, puis élue en avril 1946 au Bureau confédéral de la CGT. Dans cet article publié en 1944, issu du deuxième numéro de la nouvelle série de Femmes françaises, journal qui paraissait clandestinement pendant la guerre, Marie Couette plaide pour l’égalité salariale entre hommes et femmes en se fondant sur leur égale mobilisation dans les luttes pour la libération du pays.