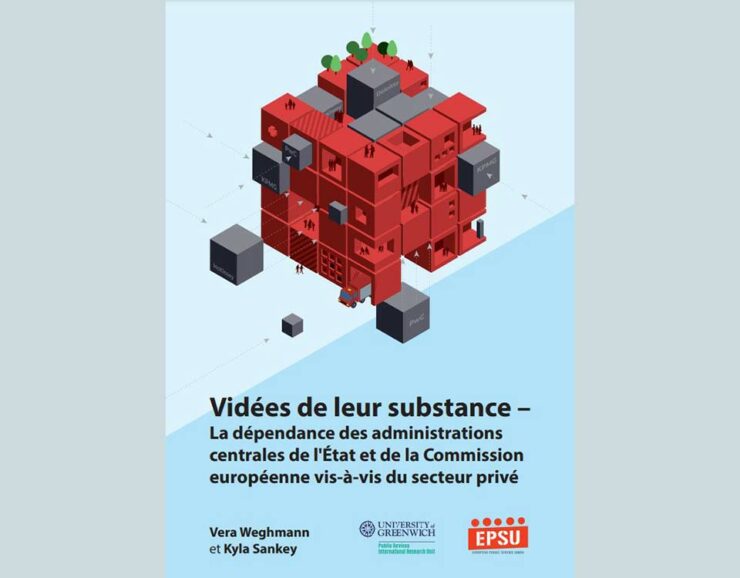Union européenne

La flambée des prix de l’énergie est le symbole le plus criant de la crise sociale due à l’inflation que traverse l’Europe. Crise dont la guerre en Ukraine serait la principale cause. Une théorie que s’attelle à démanteler Aurélien Bernier, essayiste et journaliste, spécialiste des politiques énergétiques et environnementales.

Avec l’essor des technologies numériques de nombreux biens et services sont désormais à portée de clic du consommateur. Dans cet article, Kristin Jesnes et Thiphaine Le Gauyer discutent la spécificité de l’implantation des plateformes numériques sur le marché du travail norvégien en s’appuyant sur le cas des coursiers employés par Foodora et subordonnés à un contrôle algorithmique de leur activité. Si la négociation occupe une place centrale comme mode de régulation des relations de travail entre salariés et employeurs en Norvège, l’arrivée des travailleurs sous statut d’« indépendants », non-soumis aux conventions collectives, déséquilibre ce compromis historique.

L’innovation technologique constitue bien souvent un véritable défi pour le législateur. Pris au dépourvu, il peine couramment à en saisir la complexité technique quand il n’adhère pas pleinement au laissez-faire de l’économie libérale. Dans ce texte, Nayla Glaise fait le point sur les récents textes juridiques européens relatifs à l’économie numérique, plus promptes à protéger le bon fonctionnement du marché que les droits des travailleurs.

Depuis plus d’un an maintenant le terme de Green Deal ou pacte vert est sur toutes les lèvres à Bruxelles au sein des institutions de l’Union européenne, mais il reste, comme c’est souvent le cas, inconnu ou très flou pour une grande majorité des citoyens européens. Alors que les mouvements pour le climat fortement portés par la jeunesse européenne ont amplifié les appels pour l’action climatique et le changement systémique, le Green Deal se présente comme un moment clé de l’histoire européenne. Décryptage de Nessim Achouche.