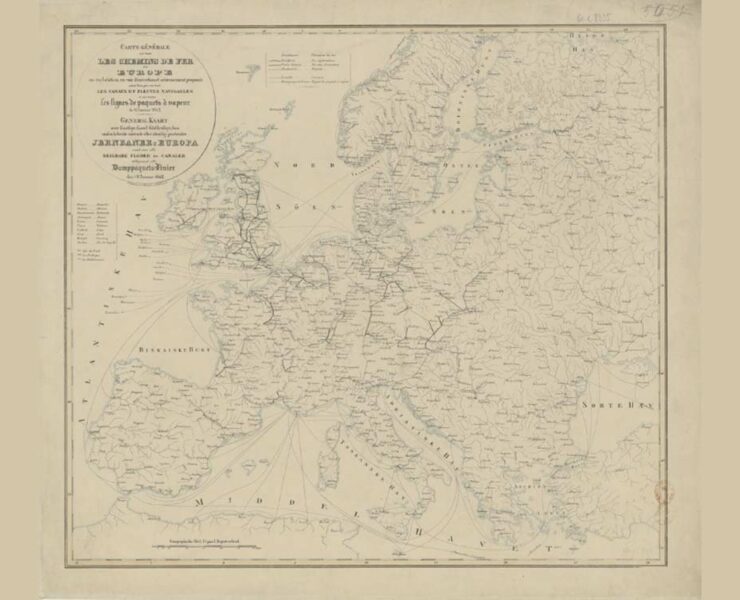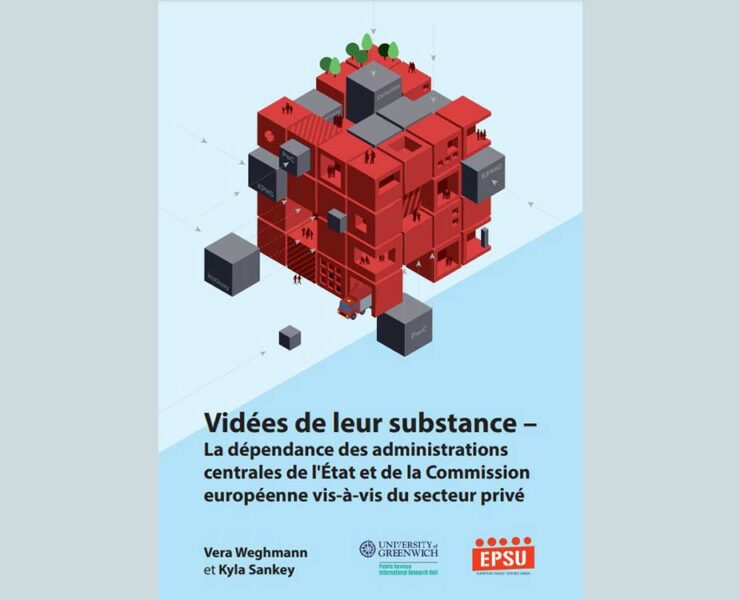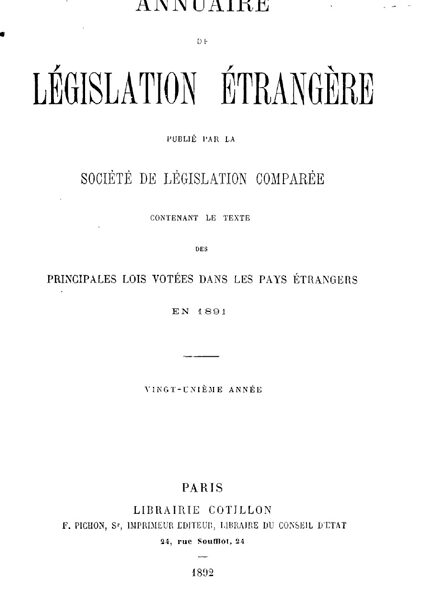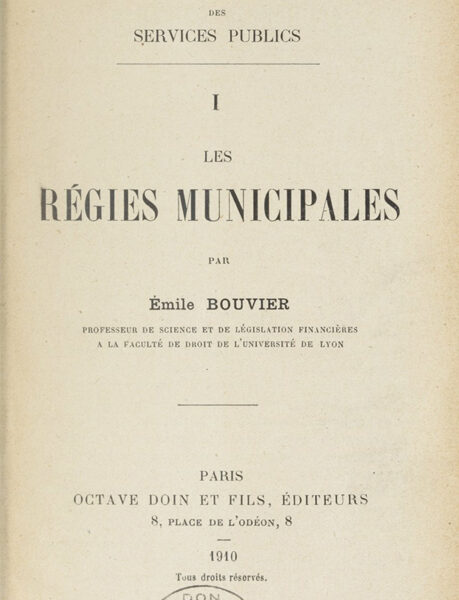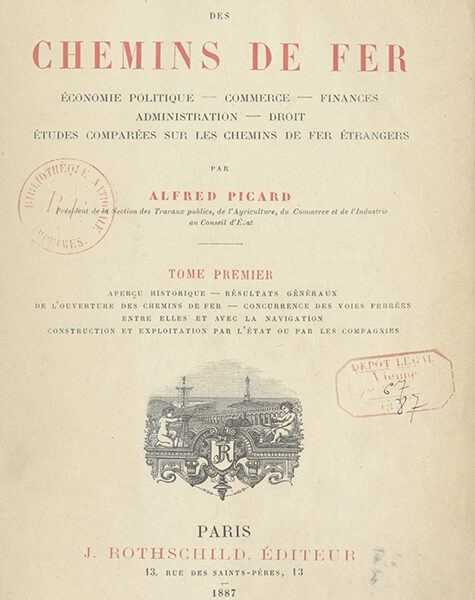Présentation
Les services publics renvoient à l’ensemble des activités qui, d’une part, sont considérées par la société comme étant d’intérêt collectif et devant être accessibles à tous et qui, d’autre part, nécessitent l’intervention des pouvoirs publics ainsi qu’un traitement spécifique pour que les missions et finalités qui leur sont assignées puissent être réalisées en pratique. Le périmètre des activités qualifiées de services publics s’est considérablement étendu depuis la fin du XIXe siècle. Des fonctions dites régaliennes de l’État (armée, police et justice), il s’est élargi à l’assistance, l’enseignement, l’assainissement (réseaux d’égouts, traitements des eaux usées, nettoiement des espaces publics, etc.), le ramassage et le traitement des ordures, les transports en commun, la santé, la culture, la distribution d’eau, de gaz, d’électricité ou encore la poste et les télécommunications. Résultats de décisions politiques, les services publics ont permis, chacun à leur manière, d’améliorer les conditions de vie de la population, d’apporter des solutions aux exigences d’égalité, de justice sociale et de solidarité, de faciliter l’accès du plus grand nombre aux progrès technologiques ou encore d’assurer un meilleur fonctionnement d’activités visant à répondre à des besoins tant sociaux, qu’économiques ou stratégiques…
Les services publics irriguent notre quotidien, façonnent l’organisation de nos sociétés, constituent un puissant moyen de réduire les inégalités. Ils jouent un rôle central dans l’évolution des modes de vie et des attentes de chacun. Bien sûr, après des décennies de développement, il restait beaucoup à faire pour permettre à ce modèle de société de prendre toute son ampleur et d’assurer au mieux possible toutes les missions qui sont assignées aux différents services publics. Mais, au lieu de chercher à en améliorer l’égal accès, au lieu de les transformer pour répondre aux aspirations nouvelles et intégrer pleinement la révolution informationnelle ou encore au lieu de les démocratiser, un autre chemin a été emprunté à la fin des années 1980.
Concurrence, privatisation, compétitivité, rentabilité ou encore parts de marché et centres de profits sont devenus les nouveaux leitmotivs. Les dirigeants économiques et politiques, les institutions financières comme la Banque mondiale et le FMI ou encore l’Union européenne ont pesé de tout leur poids pour imposer la logique néolibérale. Fallacieusement désignée sous le vocable général de « modernisation », cette logique a peu à peu irrigué l’ensemble des services publics, conduisant à une transformation en profondeur de leurs finalités et de leurs missions. Cette « modernisation » par la privatisation et l’ouverture à la concurrence était censée stimuler l’initiative privée afin de faire baisser les prix et d’améliorer la qualité du service comme l’efficacité et la transparence de la gestion. Elle devait également permettre de mieux satisfaire les besoins des usagers devenus consommateurs/clients et de dégager les ressources financières nécessaires sans alourdir les budgets publics. C’est dans cette logique néolibérale que de grandes entreprises de services publics ont été privatisées pour rejoindre les rangs des firmes multinationales. Pour faire place à la concurrence, des secteurs qui échappaient, depuis de nombreuses décennies, à la loi du profit (aérien, télécommunication, transports publics, énergie, etc.), ont dû être totalement réorganisés.
Après trois décennies de transformations néolibérales des services publics dans l’Union européenne, l’objectif de ce Silomag est de faire un bilan de cette politique de « libéralisation des services publics ». Les objectifs invoqués pour justifier ces transformations ont-ils été atteints ? Quels sont les effets de ces dernières sur les missions de solidarité, d’égalité sociale et territoriale ou encore de réponses aux besoins fondamentaux que les services publics sont censés poursuivre ? Les investissements de long terme nécessaires ont-ils été réalisés ? Qu’est-ce qu’a financé l’argent public investi dans ces secteurs ? Comment les services publics sont-ils mis au service du processus de transition écologique ? Quelles sont les conséquences sur les conditions de travail des personnels des services publics ? Quelles réformes envisagées pour permettre aux services publics de pouvoir pleinement répondre aux besoins de ce qu’une société estime devoir à chacune et chacun de ses membres, à titre égal afin de devenir l’un des moteurs de la construction d’un développement émancipateur ? Comment faire des services publics des laboratoires d’expérimentations et d’innovations démocratiques permettant dans le même temps de répondre aux enjeux environnementaux ? Voici quelques-unes des questions auxquelles ce dossier de Silomag souhaite apporter des réponses.
Actualités du débat
Soubassements théoriques et controverses

« Service public » est un terme qui sonne singulièrement à une oreille française portant en lui les luttes ayant amené des conquis sociaux qui rendent la vie de tous et en particulier des plus démunis plus humaine. Bien que ce signifiant revête un sens davantage politique, il est également une construction juridique que nous propose ici de détailler David Charbonnel, maître de conférence en droit public à l’Université de limoges. Une construction française qui s’est heurtée à une autre, celle voulue par l’Union européenne charriant avec elle une conception néolibérale, radicalement opposée aux valeurs de solidarité nationale censées être inhérentes au service public.
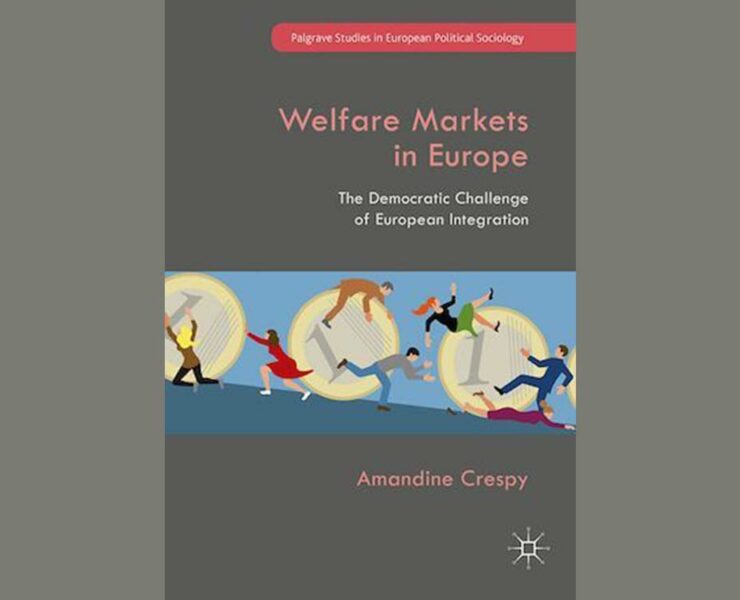
Dans son ouvrage, Welfare Markets in Europe. The democratic Challenge of European Integration, Amandine Crespy montre comment l’Union européenne s’est employée à mettre en œuvre la marchandisation des services considérés comme essentiels au regard de l’intérêt public et de la cohésion sociale, alimentant des contestations et des résistances légitimes.
Quel bilan de l’ouverture à la concurrence?

La flambée des prix de l’énergie est le symbole le plus criant de la crise sociale due à l’inflation que traverse l’Europe. Crise dont la guerre en Ukraine serait la principale cause. Une théorie que s’attelle à démanteler Aurélien Bernier, essayiste et journaliste, spécialiste des politiques énergétiques et environnementales.

Dans cet article qui présente les premiers résultats d’une étude à paraître sur la financiarisation des soins aux personnes âgées dans six pays de l’Union européenne, Cornelia Hildebrandt et Tatiana Moutinho expliquent les mécanismes d’un processus qui a commencé dans les années 1990 et s’est accéléré dans les années 2000 dans un contexte d’absence de réglementation et de stratégie de financement durable du grand âge et de la dépendance à l’échelle européenne. Les soins aux personnes âgées sont devenus la cible de quelques grands groupes cotés en bourse qui ont tiré profit de la directive européenne sur la concurrence concernant la procédure des appels d’offre. Captant les subventions publiques alors que les établissements publics sont plongés dans de multiples difficultés notamment financières, ces sociétés de capital-investissement organisent la précarité des soins pour maximiser leurs profits.
Les alternatives à la libéralisation
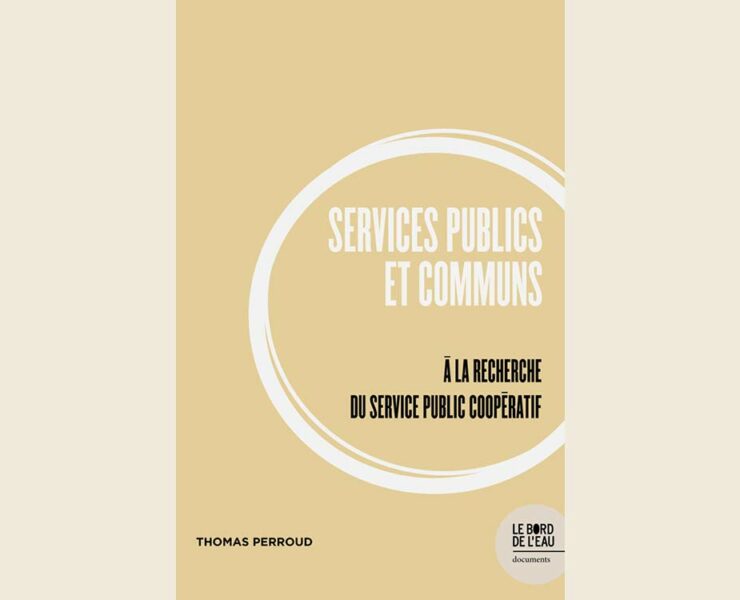
Penser la fourniture des services publics à partir des communs implique de définir une nouvelle gouvernance démocratique et inclusive en phase avec la société. Pour cela, Thomas Perroud nous invite tout d’abord à nous éloigner de la conception historiquement étatiste, bourgeoise et conservatrice de la gestion des services publics en France, et propose de dépasser l’opposition entre public et privé en revenant sur les différentes définitions des communs.

Solidarité le mot semble désormais bien creux tant il a été vidé de son sens par des années d’hégémonie culturelle libérale, le réduisant à la simple charité laïque. Roland Gori, psychanalyste, et Marie-José Del Volgo, praticienne hospitalière, essayent ici de déconstruire cette vision et de redonner un sens social à ce signifiant auquel on a enlevé sa substance première.


 #18
#18