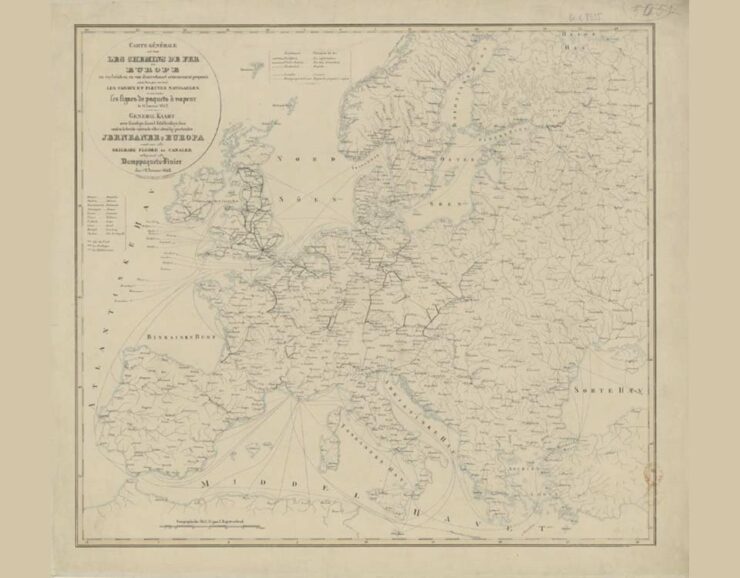Débats et alternatives
Cet espace vise à rendre compte du mouvement et de la confrontation des idées. Les contributions doivent permettre d’approfondir ou de présenter une thématique en lien avec une actualité politique, sociale, économique ou encore scientifique. À titre d’illustration, les contributeurs peuvent présenter une opinion argumentée, un état des lieux d’une question ou d’une recherche scientifique ou encore les enjeux d’une controverse.
Il existe des sous-rubriques qui peuvent varier en fonction des dossiers :
des repères afin de situer et d’éclairer la thématique (focus, chronologie, définitions, chiffres clés, etc.) ;
des pensées et pratiques alternatives car notre ambition ne se résume pas à décrire l’ordre des choses, mais également penser et faire connaitre des transformations progressistes;
des expériences étrangères afin de s’interroger sur les mouvements de convergences et de divergences entre les différents pays.

Comment (re)politiser l’entreprise ? Dans cet article, Aymeric Seassau rappelle que le lieu de travail est un lieu décisif de pouvoir, de politisation et de lutte des classes. Selon lui, il faut mettre fin à l’abandon de l’entreprise par la gauche et prendre résolument le parti du travail, afin d’engager la révolution des rapports de production.
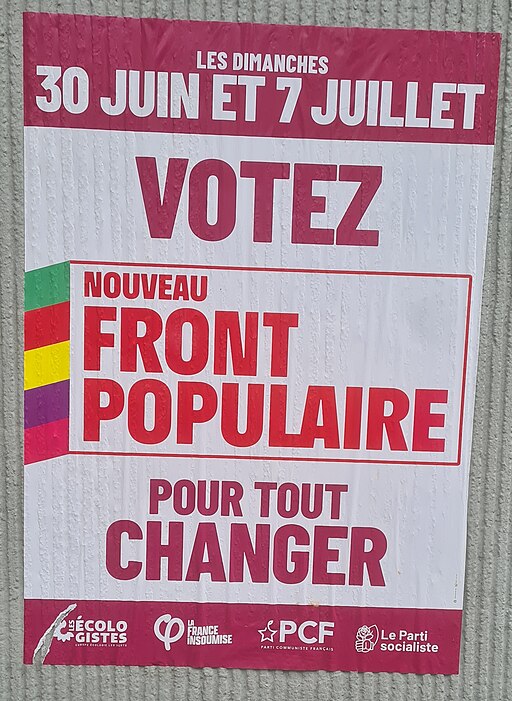
Pour Frédéric Mellier, le mouvement contre la réforme des retraites de 2023 a été un révélateur de l’absence de lien organique entre les dynamiques sociales et le champ politique, privant l’unité syndicale et la mobilisation populaire d’un débouché politique. Il propose dans cet article d’en tirer les enseignements pour co-construire une nouvelle hégémonie au service d’un véritable projet d’émancipation.
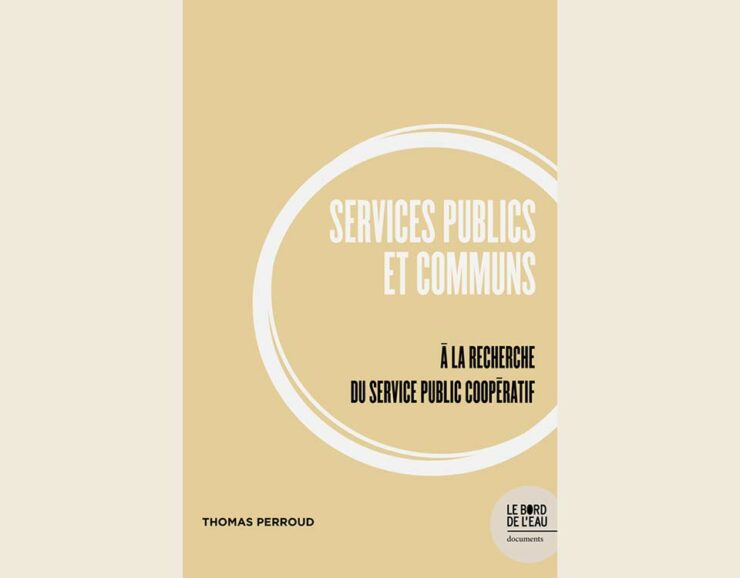
Penser la fourniture des services publics à partir des communs implique de définir une nouvelle gouvernance démocratique et inclusive en phase avec la société. Pour cela, Thomas Perroud nous invite tout d’abord à nous éloigner de la conception historiquement étatiste, bourgeoise et conservatrice de la gestion des services publics en France, et propose de dépasser l’opposition entre public et privé en revenant sur les différentes définitions des communs.

Solidarité le mot semble désormais bien creux tant il a été vidé de son sens par des années d’hégémonie culturelle libérale, le réduisant à la simple charité laïque. Roland Gori, psychanalyste, et Marie-José Del Volgo, praticienne hospitalière, essayent ici de déconstruire cette vision et de redonner un sens social à ce signifiant auquel on a enlevé sa substance première.